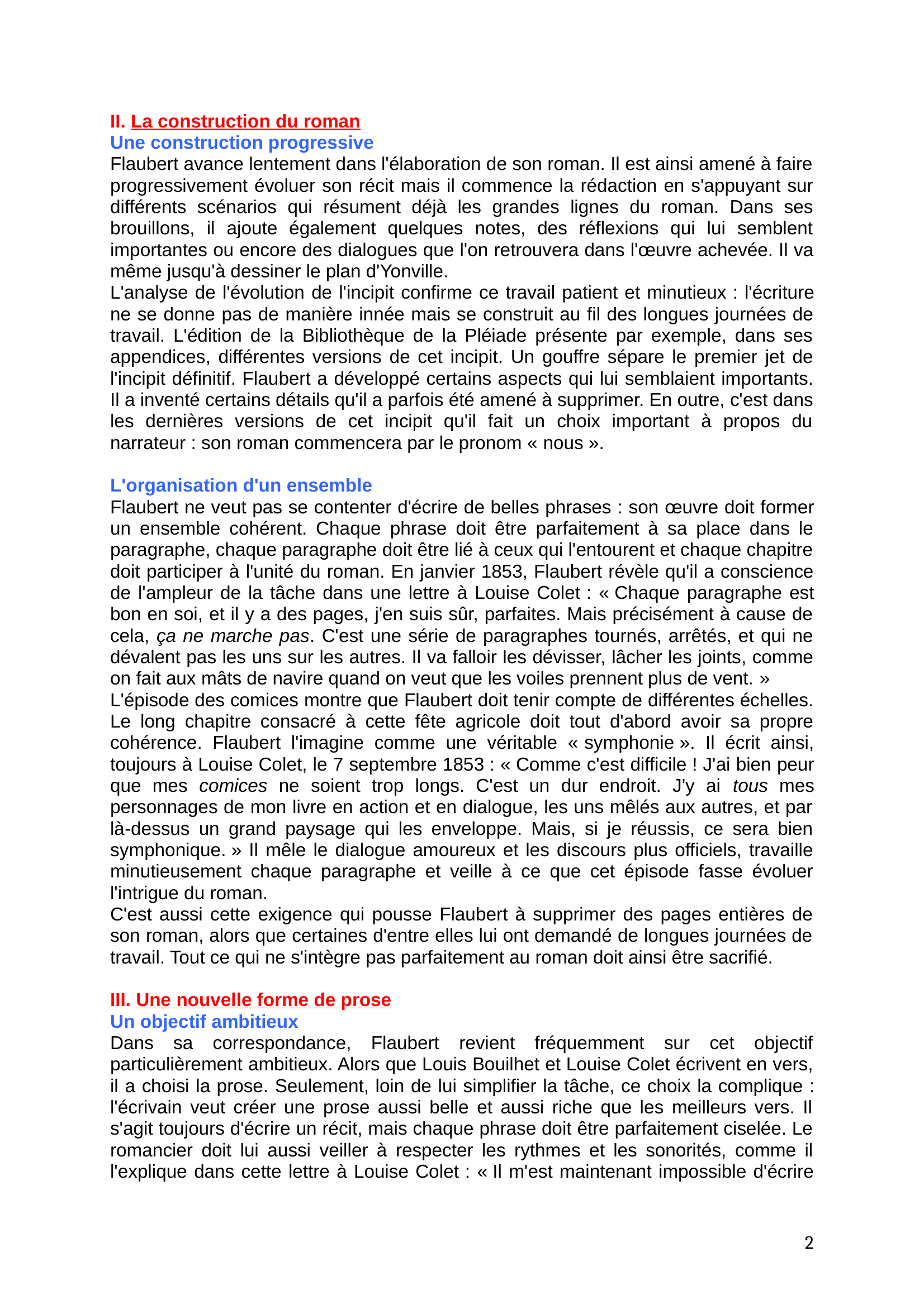Madame Bovary : Les affres de l'art
Publié le 09/12/2015
Extrait du document
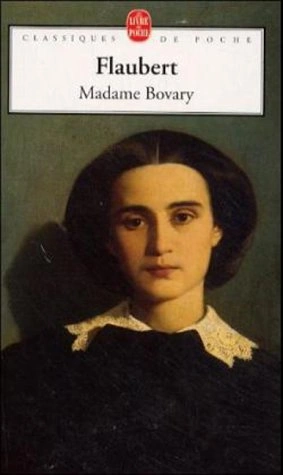
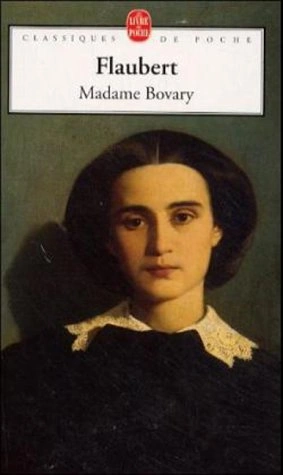
«
II.
La construction du roman
Une construction progressive
Flaubert avance lentement dans l'élaboration de son roman.
Il est ainsi amené à faire
progressivement évoluer son récit mais il commence la rédaction en s'appuyant sur
différents scénarios qui résument déjà les grandes lignes du roman.
Dans ses
brouillons, il ajoute également quelques notes, des réflexions qui lui semblent
importantes ou encore des dialogues que l'on retrouvera dans l'œuvre achevée.
Il va
même jusqu'à dessiner le plan d'Yonville.
L'analyse de l'évolution de l'incipit confirme ce travail patient et minutieux : l'écriture
ne se donne pas de manière innée mais se construit au fil des longues journées de
travail.
L'édition de la Bibliothèque de la Pléiade présente par exemple, dans ses
appendices, différentes versions de cet incipit.
Un gouffre sépare le premier jet de
l'incipit définitif.
Flaubert a développé certains aspects qui lui semblaient importants.
Il a inventé certains détails qu'il a parfois été amené à supprimer.
En outre, c'est dans
les dernières versions de cet incipit qu'il fait un choix important à propos du
narrateur : son roman commencera par le pronom « nous ».
L'organisation d'un ensemble
Flaubert ne veut pas se contenter d'écrire de belles phrases : son œuvre doit former
un ensemble cohérent.
Chaque phrase doit être parfaitement à sa place dans le
paragraphe, chaque paragraphe doit être lié à ceux qui l'entourent et chaque chapitre
doit participer à l'unité du roman.
En janvier 1853, Flaubert révèle qu'il a conscience
de l'ampleur de la tâche dans une lettre à Louise Colet : « Chaque paragraphe est
bon en soi, et il y a des pages, j'en suis sûr, parfaites.
Mais précisément à cause de
cela, ça ne marche pas .
C'est une série de paragraphes tournés, arrêtés, et qui ne
dévalent pas les uns sur les autres.
Il va falloir les dévisser, lâcher les joints, comme
on fait aux mâts de navire quand on veut que les voiles prennent plus de vent.
»
L'épisode des comices montre que Flaubert doit tenir compte de différentes échelles.
Le long chapitre consacré à cette fête agricole doit tout d'abord avoir sa propre
cohérence.
Flaubert l'imagine comme une véritable « symphonie ».
Il écrit ainsi,
toujours à Louise Colet, le 7 septembre 1853 : « Comme c'est difficile ! J'ai bien peur
que mes comices ne soient trop longs.
C'est un dur endroit.
J'y ai tous mes
personnages de mon livre en action et en dialogue, les uns mêlés aux autres, et par
là-dessus un grand paysage qui les enveloppe.
Mais, si je réussis, ce sera bien
symphonique.
» Il mêle le dialogue amoureux et les discours plus officiels, travaille
minutieusement chaque paragraphe et veille à ce que cet épisode fasse évoluer
l'intrigue du roman.
C'est aussi cette exigence qui pousse Flaubert à supprimer des pages entières de
son roman, alors que certaines d'entre elles lui ont demandé de longues journées de
travail.
Tout ce qui ne s'intègre pas parfaitement au roman doit ainsi être sacrifié.
III.
Une nouvelle forme de prose
Un objectif ambitieux
Dans sa correspondance, Flaubert revient fréquemment sur cet objectif
particulièrement ambitieux.
Alors que Louis Bouilhet et Louise Colet écrivent en vers,
il a choisi la prose.
Seulement, loin de lui simplifier la tâche, ce choix la complique :
l'écrivain veut créer une prose aussi belle et aussi riche que les meilleurs vers.
Il
s'agit toujours d'écrire un récit, mais chaque phrase doit être parfaitement ciselée.
Le
romancier doit lui aussi veiller à respecter les rythmes et les sonorités, comme il
l'explique dans cette lettre à Louise Colet : « Il m'est maintenant impossible d'écrire
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame Bovary de Flaubert: Un nouvel art romanesque
- « L'art n'est pas fait pour peindre les exceptions » écrit Gustave Flaubert dans une lettre à George Sand du 5 décembre 1866. En vous appuyant sur votre lecture des oeuvres au programme, vous commenterez et discuterez cette affirmation de l'auteur de Madame Bovary.
- Etudier l'art de Flaubert dans cette description de Madame Bovary
- Explication linéaire n°9 Madame Bovary: Dans quelle mesure cette rencontre amoureuse, bien que classique, est-elle magnifiée par le regard du héros ?
- Madame Bovary et la littérature sentimentale