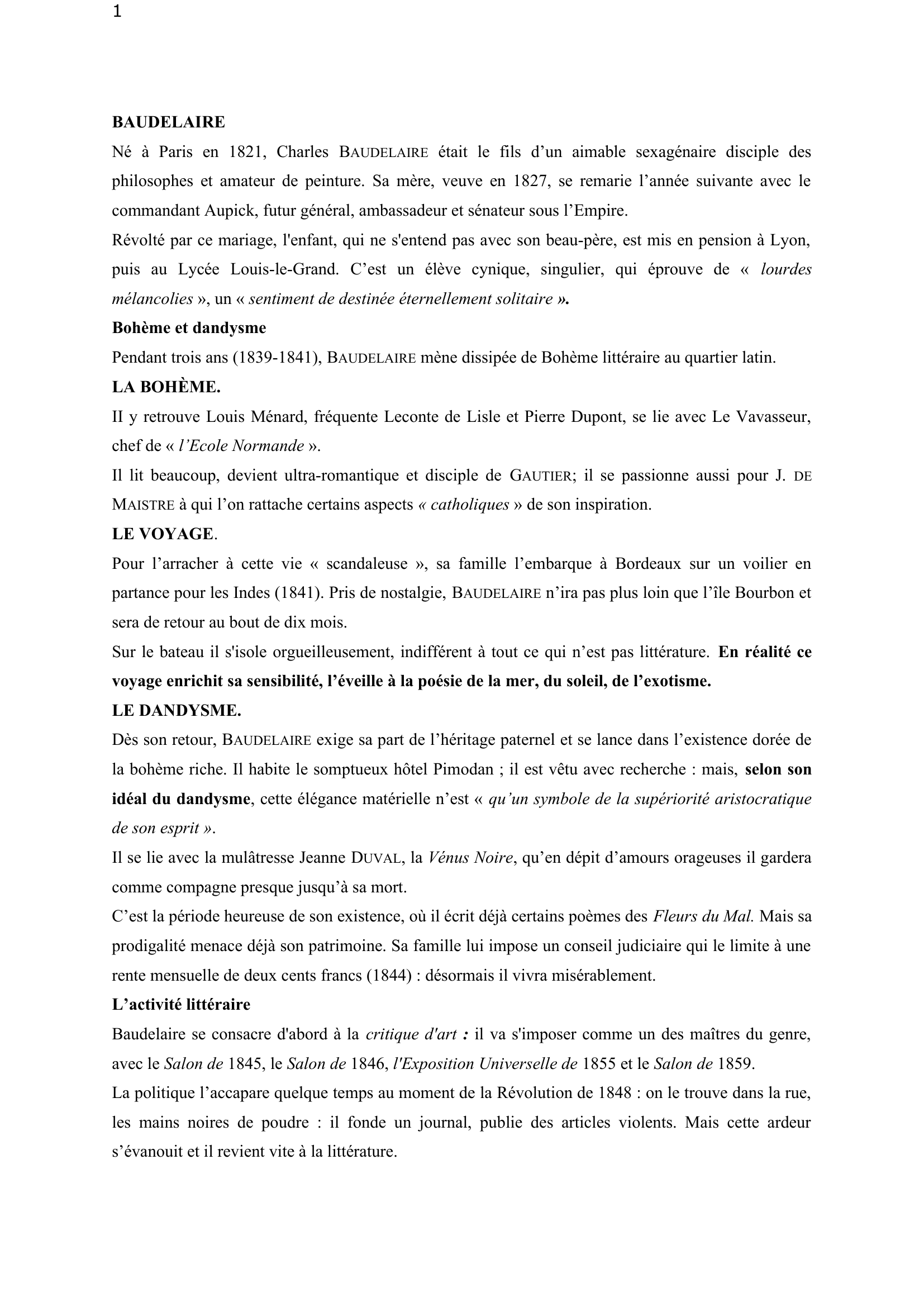L'oeuvre de Baudelaire
Publié le 11/02/2022

Extrait du document
Correspondances, Le sonnet des Correspondances, semble être passé inaperçu des contemporains. Pourtant, on en fait souvent le point de départ du Symbolisme puisque « symboliser »,. au sens étymologique, c’est rapprocher, et qu’un symbole est un signe de reconnaissance : le monde inconnu fait des « signaux » qu’il appartient au poète (ou au savant) d’apercevoir et de traduire à l’usage des noninitiés! On peut y voir du moins une des clefs de la poésie baudelairienne et, par elle, de l’art moderne, de Rimbaud à Breton. Baudelaire y précise les rapports qui existent entre sensations et sentiments, et met l’accent sur leur signification morale et métaphysique : au-delà du monde des apparences, tel que l’homme l’appréhende ou le reconstruit, il y a une autre réalité, l’unique réalité, inaccessible sans doute par les seules voies de l’esprit dans son mouvement logique, mais que des êtres privilégiés peuvent atteindre, ceux qui savent épurer leurs sens, pour qui la vérité est manifestée, les mystiques. ÏK-donne en même temps le modèle d’une poésie nette et mystérieuse. Premier Quatrain. De même que Chateaubriand faisait de la forêt le modèle de la cathédrale, de même nous partons ici de l’idée que la forêt est le temple naturel, c’est-à-dire le lieu où l’homme est le plus proche de Dieu. De ce temple, Baudelaire suggère deux images. L’une, claire, est de veine gréco- latine : le tronc de l’arbre est le pilier de l’édifice, donc de la Nature, vivante et, en un sens panthéiste, Dieu. L’autre serait orientale : les arbres et leurs branches forment une forêt opaque où l’on avance avec inquiétude; ils figurent des divinités aux bras et aux yeux multiples. L’arbre (ou plutôt ce que l’arbre résume, la Nature dans ses manifestations) parle, voit et connaît. L’homme est un privilégié que l’Univers observe. Il peut passer dans une obscurité confuse, mais il peut aussi se faire reconnaître de la Nature, 13 et Ie rejoindre grâce aux symboles qu’elle lui propose et qui ne demandent qu’à être compris. Il faut alors qu’il soit poète, ou conduit par les poètes dont l’âme est pure, et qui sont les traducteurs nés du monde surnaturel au monde sensible, et inversement. — Il s’agit essentiellement ici d’une correspondance « verticale ». La suite du sonnet sera surtout consacré aux correspondances « horizontales ». Second Quatrain. Baudelaire revient à l’impression sonore notée au deuxième vers. Mais les paroles, mal entendues, perdent leur sens jusqu’à n’être plus que les échos de voix éloignées, dont la musique des vers nous dit qu’elles chantent un hymne. Leur unité n’est pas logique, mais symphonique : ténébreuse pour le vulgaire, profonde et essentielle pour le poète qui confond et unifie les sensations reçues de la nuit et de la clarté parce qu’elles donnent également le sentiment de l’immensité {vaste). L’univers est donc rempli jusqu’à la confusion; mais le poète est là pour éprouver, non pour subir : il perçoit ce qui émane des sons, des parfums et des couleurs. Ces sensations se répondent, c’est-à-dire évidemment qu’elles se ressemblent, mais aussi qu’elles sont musicalement accordées, que chaque sensation est une note de l’accord, parce que tout cet univers forme une harmonie. Tercets. Les rimes des tercets ne sont pas disposées selon un schéma traditionnel, ccd, eed, ou ccd, ede, de même que les quatrains n’étaient pas sur deux rimes. Jouant la difficulté, le poète va s’attacher en particulier aux correspondances éveillées par les parfums. C’est un exemple, mais le caractère personnel du choix est apparent (voir Fleurs du Mal, 22, et Petits Poèmes en prose, 17). Il est présenté en deux versions. La première version fait appel à des comparaisons attendues avec la musique (doux comme les hautbois) et avec la couleur (vert comme les prairies), mais il s’y ajoute une correspondance tactile (frais comme des chairs d’enfants) : ainsi apparaît la possibilité d’établir par correspondance un lien entre les sensations et de suggérer les unes en évoquant les autres; noter toutefois que Baudelaire ne donne guère de précisions sur ces divers parfums... La seconde version est complémentaire de la première, dans la mesure où il s’agit de suggestions complexes : c’est essentiellement le domaine moral qu’elle prospecte, un domaine où la corruption rejoint l’abondance et la plénitude triomphante de la vie v. 11 . Les parfums violents (v. 13) éveillent l’âme à i'univers de la luxure et à la perte dans l’infini : 2 l'un par l’autre : Baudelaire est un homme 7 l'un livre obscène « précipite vers les océans mys- •ieu« •> Avec l'inspiration sensuelle (v. 14), et non i e::» d'elle, il v a l'inspiration spirituelle... Conclusion. Fondant ses inquiétudes profondes et ses aspirations esthétiques dans une métaphysique, Baudelaire donne la formule de la poésie moderne : charme et clef du monde, plaisir et connaissance. A la tradition classique de l’expression intelligible de sensations et de sentiments clairs, il substitue une conception complexe de l’obscurité de la conscience et de la richesse des émotions qu’on ne peut ni 14 appréhender directement ni rendre logiquement. Le rôle du poète est de découvrir des affinités nouvelles dans l’infini des correspondances possibles, afin de faire éprouver aux hommes l’unité de l’univers. Il a le droit, et même le devoir, de faire appel à toutes les forces qui portent l’esprit, et d’abord à celles qu’on a voulu enfermer jusqu’alors, celles du mal. Pour le lecteur, ces correspondances seront les éléments d’un langage simple, parce qu’il sollicite directement les sens, et mystérieux, parce qu’il n’y a pas une, mais des traductions qui s’appellent l’une l’autre et se combinent. Correspondances et synesthésies. Le principe de l'analogie universelle_ apparaît, entre beaucoup d’autres, chez Platon, et dans les Epîtres de saint Paul: c’est un postulat de la pensée mystique et de l’idéalisme. Les penseurs et les artistes du début du XIXe siècle l’ont connu surtout à travers Swedenborg, qui a eu une influence considérable sur des esprits aussi différents que ceux de Bernardin de Saint-Pierre et de Ballanche ou de Joseph de Maistre. Swedenborg est un philosophe suédois (1688-1772) dont Balzac parle longuement dans Séraphîta. « Swedenborg [...] nous avait déjà enseigné que le ciel est un très grand homme (Balzac commente cette même phrase dans Séraphîta) ; que tout, forme, mouvement, nombre, couleur, parfum, dans le spirituel comme dans le naturel, est significatif, réciproque, converse, correspondant. [...] Tout est hiéroglyphique, et nous savons que les symboles ne sont obscurs que d’une manière relative, c’est-àdire selon la pureté, la bonne volonté ou la clairvoyance native des âmes. Or qu’est-ce qu’un poète (je prends le mot dans son acception la plus large), si ce n’est un traducteur, un déchiffreur? Chez les excellents poètes, il n’y a pas de métaphore, de comparaison ou d’épithète qui ne soit d’une adaptation mathématiquement exacte dans la circonstance actuelle, parce que ces comparaisons, ces métaphores et ces épithètes sont puisées dans l’inépuisable fonds de l’universelle analogie, et qu’elles ne peuvent être puisées ailleurs. » Mais Baudelaire traite là de deux questions différentes, celle des correspondances qui implique une philosophie de l’unité (dont on sait quelle importance: a eue pour les Romantiques), et celle des synesthésies, qui concerne la sensibilité, même s’ils doivent les justifier a posteriori faisant appel à une médiation. Dès qu’un artiste prouvé des émotions identiques de sources différentes, ou qu’il a dû recourir aux moyens des autres s pour les besoins du sien propre, on aurait pu parler de synesthésie. Ce n’est pourtant qu’au XVIIIe ;le qu’on a pris clairement conscience du problème qu’on a cherché à en préciser les données : Diderot reconnaissait ainsi un « clavecin oculaire ». Au début du XIXe siècle, les analogies n’avaient plus rien de très étonnant. 1843, Théophile Gautier pouvait écrire: « J’entends le bruit des couleurs. Des sons verts, bleus, jaunes arrivaient par ondes parfaitement distinctes. » parlant à Musset, il se fâchait d’être obligé de « soutenir une discussion pour prouver que le fa était ne, le sol rouge, une voix de soprano blonde, une x de contralto brune ». Songer aussi au sonnet des voyelles d’Arthur Rimbaud à « l’orgue à bouche » dont parle Huysmans. Correspondances « verticales » et correspondances « horizontales ». 15 Bachelard, :< Le thème des “ correspondances ” qui devait avoir un si grand rôle dans la poésie baudelairienne un élément fondamental de la cosmologie balzacienne. Mais tandis que chez Baudelaire il s’agit toujours de correspondances sensibles, de correspondances en quelque sorte horizontales où les différents éléments trouvent l’un par l’autre de subtils renforcements, chez Balzac les « correspondances » sont verticales ; elles sont swedenborgiennes. Leur principe essentiellement du règne céleste : “ Le royaume ciel, dit Balzac, citant Swedenborg, est le royaume 5 motifs. L'action se produit dans le ciel, de là dans monde, et par degrés dans les infiniment petits la terre ; les effets terrestres étant liés à leurs uses célestes font que tout y est correspondant et signifiant. L’homme est le moyen d’union entre le naturel et le spirituel. ” Au philosophe de ressentir l’insufflation prophétique des correspondances est ce “ souffle ” qui après avoir “ vanné ” l’homme intérieur le confirme dans son aptitude à la verticalité : “ l’homme seul, dit Balzac, a le sentiment de verticalité placé dans un organe spécial ”. C’est cet axe de verticalité toute dynamisée qu’il faut cueillir toutes les correspondances qui fourmillent dans le texte balzacien. Ces images préparent vraiment les pensées. En les revivant comme Balzac les vécues on reçoit l’extraordinaire leçon d’une imagination qui pense. » ( « Il y a deux points particuliers sur lesquels, en dépit de la publication de travaux dont certains, comme ceux de M. Jean Pommier, sont d’un haut intérêt intrinsèque, je maintiendrai la position que, moins informé, j’avais cru devoir prendre. Je persiste à estimer que l’influence de Poe poète sur Baudelaire poète se réduit à peu de chose. Quant à la théorie des correspondances mystiques et de l’universelle analogie, non seulement j’incline encore à penser qu’elle a surtout intéressé l’imagination de Baudelaire plutôt qu’elle n’aurait conquis durablement son adhésion d’esprit, et qu’au demeurant cette théorie, exposée à plusieurs reprises dans ses articles de critique et la première fois semble-t-il sous l’influence de Delacroix, a surtout joué chez lui le rôle d’un mythe d’esthéticien; mais je reste persuadé — et n’est-ce pas là le point essentiel ? — que la façon dont le poète qu’il était comprit et mania la métaphore doit peu à cette théorie. » « Pour savoir comment Baudelaire s’y est pris pour se tracer un chemin dans le monde des analogies et pour associer et mettre en ordre les matériaux que lui offrait la nature, relisons une fois de plus le sonnet des Correspondances. [...] La tâche du poète sera donc, suivant un sens divinatoire qui est en lui, de percevoir des analogies, des correspondances, qui revêtent l’aspect littéraire de la métaphore, du symbole, de la comparaison ou de l’allégorie. Ces correspondances, à considérer le sonnet en question, semblent se développer sur trois plans : 1. — Il existe des équivalences entre les données des divers sens, les parfums, les couleurs, les sons, etc. Baudelaire fait ici allusion aux phénomènes de la synesthésie, dont les plus connus sont peut-être ceux de “ l’audition colorée ”. Des associations de ce genre peuvent se produire spontanément entre des sensations n’appartenant pas au même registre, et cela probablement grâce à une communauté entre elles, de tonalité affective dont la logique, dans la plupart des cas, est incapable de rendre 16 compte. Vaste champ ouvert au poète, qui ne se croira plus tenu d’identifier une forme à une forme et un son à un autre, mais qui accueillera hardiment des métaphores dont les termes évoqueront des sensations d’ordre différent. On entrevoit en outre une conséquence que les faits se sont chargés maintes fois de mettre en lumière et que Baudelaire lui-même formule ainsi : “ Les arts aspirent, sinon à se suppléer l’un l’autre, du moins à se prêter réciproquement des forces nouvelles. ” De ce que les données des sens sont susceptibles d’avoir “ l’expansion des choses infinies ”, il suit qu’un désir, un regret, une pensée — choses de l’esprit — peuvent éveiller un correspondant dans le monde des images (et réciproquement). Après avoir décrit dans l’Invitation au Voyage (en prose) un pays enchanté, le poète, se tournant vers sa compagne, l’interroge : “ Ne serais-tu pas encadrée dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme les mystiques, dans ta propre correspondance ? ” Un peu plus bas, plus nettement encore : “ Ces trésors, ces meubles, ce luxe; cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. ” Dans la composition de tels “ paysages mentaux ”, il entre avant toute chose ce “ sentiment de la nature ” dont nous avons déjà parlé. Ce que le poète prend au monde sensible, c’est de quoi forger une vision symbolique de lui-même, ou de son rêve; il lui demande le moyen d’exprimer son âme. [...] Des êtres, des choses enfin — c’est là ce qu’affirme le premier quatrain du sonnet — nous ne voyons clairement que l’envers; seul, un esprit doué d’une sorte de seconde vue discerne, au travers des apparences, converties en signes et en symboles, les reflets d’un univers suprasensible. Mais il faut noter tout de suite, si ce que nous avons dit plus haut est vrai, que ce troisième plan sur lequel s’établissent des correspondances se rapproche du second jusqu’à se confondre avec lui. Car il y a moyen pour l’âme de communiquer avec cet au-delà occulte; entre le microcosme et le macrocosme tous deux spirituels en leur essence, il existe un truchement, un langage commun, qui leur permet de se révéler l’un à l’autre et de se reconnaître : le langage des symboles, des métaphores, des analogies. La nature, à quoi peut- elle servir, sinon à offrir à l’âme la possibilité de se voir et au surnaturel la possibilité de se manifester? Au terme de la méditation, c’est la “ ténébreuse et profonde unité ” qui se dévoile au poète; c’est le pressentiment confus de la participation de toutes choses les unes aux autres qui l’envahit, de leurs correspondances et de leur accord fondamental. Ces analogies, quelquefois si étranges, qui s’imposent à lui avec l’accent d’une évidence indiscutable, il les regarde comme des preuves de cette unité originelle. En tous les êtres, il croit apercevoir un signe qui atteste leur parenté et comme l’empreinte secrète du verbe primitif. “ Vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose... ” Que l’on ne s’y trompe pas; il y a là sans doute plus qu’une simple comparaison, qu’une simple identification littéraire. Comment affirmer que le poète n'a pas eu. l’espace d’une seconde peut-être, la révélation d’une essence commune, d’une sorte d’identité magique? S’il se penche sur son esprit comme sur un miroir, s'il essaye d'augmenter à tout prix — et par des artifices même — sa plasticité, son “ agilité ”,sa transparence, c’est que quelque chose en lui espère obscurément y découvrir un jour, et y déchiffrer, l’image de l’univers entier. » Esthétique et mystique. 17 « Toute la réalisation baudelairienne est guidée par cette recherche inquiète et enthousiaste du Beau pur — révélé à l’homme par les arts, entrevu par le poète dans un bref éclair. Comme chez Poe, cette esthétique s’élève à la mystique. M. Bremond dirait qu’elle rejoint la Prière. Elle témoigne en tout cas de tendances spiritualistes. Par elle nous voyons se ranimer et s’enrichir les théories antiques de l’inspiration. Le frémissement du poète c’est, transposés dans la vie moderne, les transes de la Pythonisse ou le délire du Prêtre apollinien. Les mots deviennent les formules d’une “ magie suggestive ” ou d’une “ sorcellerie évocatoire ” — et le poète n’est qu’un “ traducteur, un déchiffreur ”, car “ tout est hiéroglyphique et nous savons que les symboles ne sont obscurs que d’une manière relative c’est-à-dire selon la pureté, la bonne volonté ou la clairvoyance native des âmes ”. Ces métaphores, ces comparaisons, ces épithètes qui sont la langue naturelle de l’interprète sont puisées dans le fonds commun de l’analogie universelle -— et le Poète est le seul qui possède la clef des correspondances. Le monde naturel est la reproduction du monde spirituel. Poe affirme el Baudelaire répète : le monde est une correspondance du ciel. Pour établir la liaison entre ces deux mondes pour lire dans l’énigme de la vie, pour traduire la réalité du monde spirituel exprimée en symboles accessibles au monde naturel, le Poète apporte son génie qui devine, son inspiration, son intuition. Ces idées, Baudelaire les trouve dans l’œuvre de Poe. Pourtant on ne peut dire que c’est Poe qui les lui révéla le premier. Ces correspondances, d’autres les ont pressenties avant Poe — et d’autres peutêtre avant Poe les ont offertes, dans leur mystérieuse séduction, à l’esprit curieux de Baudelaire. On a parlé de Pascal, Malebranche, Spinoza, Hegel Schelling, Novalis, saint Bonaventure, saint Jean de la Croix. Bornons-nous pour qu’on juge en toute vérité la part inspiratrice de Poe, à évoquer des noms plus familiers à notre poète, Baudelaire semble nous inviter à chercher les sources premières de ses vues sur l’analogie universelle, les rapport du monde physique et du monde céleste, la “ ténébreuse et profonde unité ”, dans l’œuvre de Lavater de Swedenborg ou de Joseph de Maistre. [...] La physiognomonie est une forme particulière de grandes idées de l’illuminisme sur l’unité cosmique et le symbolisme universel : l’homme est pour Lava ter “ un miroir aux mille facettes où Dieu se voit lui même et par lequel il peut jouir de son œuvre, la nature ”, et tout l’univers obéit à une loi unique ains formulée : “ il est une seule loi qui traverse toutes le natures, qui les unit toutes en un tout et cependant les sépare les unes des autres et fait de chacune un individu autonome. Chaque rature, par suite, constitue l’idée, le miroir, la copie “sue ou précise de toutes les autres natures... La rature est le grand texte, la révélation essentielle de Dieu... ” " La Nature est un temple ” dira Baudelaire. Et les échos que traversent ces forêts de symboles manifestent des voix divines. Le poète doit voir dans les aspects du monde physique le visage même de Dieu. Swedenborg retint plus longtemps Baudelaire [...] Mais c’est peut-être — encore et toujours — chez Joseph de Maistre qu’il trouve de plus sûrs appuis à son enthousiasme juvénile pour cette mystique qui ouvre des perspectives nouvelles à sa pensée et à son art. Les vues de J. de Maistre, dépouillées d’éléments hétéroclites, s’ordonnent plus logiquement. Baudelaire entend, dans ses 18 affirmations, l’écho orthodoxe de saint Paul: “ Ce monde est un système de choses -invisibles manifestées visiblement... Nous vivons au milieu d’un système de choses invisibles manifestées visiblement... Il n’y a aucune loi sensible qui n’ait une loi spirituelle dont la première n’est je l’expression visible”. Il apprend chez lui que Univers est un reflet de Dieu, que “ le monde physique n’est qu’une image ou une répétition du monde spirituel ” et que l’on peut “ étudier l’un dans l’autre alternativement ”. Et il s’éprend de cette métaphysique cosmique qui entraîne, dans sa spiritualité, les idées platoniciennes et les révélations de la Cabale, joignant des efforts tentés par l’Homme pour recréer le mystère des choses et établir une harmonie, une unité qui apaisent son inquiétude de l’ordre logique. Baudelaire est donc pris par le courant' mystique vers 1820 anime, au beau temps du romantisme, les littérateurs — en même temps que les philosophes. » Les motifs religieux et les motifs esthétiques sont inséparables chez Baudelaire. l ne lui suffisait pas de s’être élevé, de la simple expérience passive a la spéculation sur l’Unité seule existante, dont toutes choses ne sont que les symboles plus ou moins transparents. Il portait en lui “ un culte des .mages, sa grande, son unique, sa primitive passion ” et “ un goût permanent, depuis l’enfance, de toutes les représentations plastiques ”, qui l’orientaient vers la magie poétique. Si toutes les sensations “ se répondent ” et sont les symboles de l’unité totale, le seul moyen que nous avons de rétablir notre communication avec cette Unité, — en dehors des instants où la grâce l’instaure à l’improviste, — c’est le travail du poète en quête des formes : non pas pour elles- mêmes, mais pour ce qu’elles signifient. Le poète, en replaçant les choses dans leur relation originelle, espère recréer dans sa conscience, et recréer pour autrui, l’unité cosmique. A peine Baudelaire entrevoit-il ce sens de l’œuvre qu’il est pris de scrupules. Mais il n’en reste pas moins l’initiateur de cette tentative magique qu’après lui d’autres reprendront. Lui, cependant, désespérant de sortir par ce moyen “ d’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve ”, s’épuisera à chercher la voie d’un progrès moral. Au terme de sa vie, lorsque ne lui échapperont plus que des cris d’angoisse et d’émouvantes oraisons, il reniera le rêve auquel il avait tant demandé, accusant de son naufrage moral son “ penchant à la rêverie ” qui lui a fait perdre vingt années et l’a mis “ au-dessous d’une foule de brutes qui travaillent tous les jours ”, La perte du moi “ dans la grandeur de la rêverie ”, qui lui avait paru si souhaitable jadis, ne sera plus à ses yeux qu’une défaillance devant le travail. » Richard Wagner et « Tannhäuser» « M’est-il permis à moi-même de raconter, de rendre avec des paroles la traduction inévitable que mon imagination fit du même morceau (Lohengrin), lorsque je l’entendis pour la première fois, les yeux fermés, et que je me sentis pour ainsi dire enlevé de terre? Je n’oserais certes pas parler avec complaisance de mes rêveries, s’il n’était pas utile de les joindre ici aux rêveries précédentes. [...] D’ailleurs, il ne serait pas ridicule ici de raisonner a priori, sans analyse et sans comparaisons; car ce qui serait vraiment surprenant, c’est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne 19 pussent pas donner l’idée d’une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées; les choses s’étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité. “ La nature est un temple où de vivants piliers [...] Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. ” « La correspondance baudelairienne est, en même temps qu’une doctrine littéraire, une théorie mystique inspirée par les idées de Swedenborg et de Fourier sur le symbolisme et l’analogie; mais la correspondance peut avoir aussi d’autres origines. On sait que certains excitants, comme le haschich, produisent une hyperesthésie de la sensibilité : des sensations nombreuses et diverses sont ressenties, entre lesquelles le toxicomane perçoit des rapports insoupçonnés. Gautier a laissé, sur les impressions qu’il éprouva un jour que, par curiosité, il absorba du haschich, des pages curieuses (“ Ma vue s’était prodigieusement développée, j’entendais le bruit des couleurs. Des sons verts, rouges, bleus, jaunes, m’arrivaient par ondes parfaitement distinctes ”). Chez Baudelaire, l’excitation réciproque des états de conscience, sans être nettement pathologique comme on l’a affirmé parfois, n’est plus tout à fait normale. Il faut pourtant évité de généraliser de manière abusive, et déceler partout des traces de névroses. » Du rêve éveillé au rêve provoqué. « J’ignore si quelque analogiste a établi solidement une gamme complète des couleurs et des sentiments, mais je me rappelle un passage d’Hoffmann qui exprime parfaitement mon idée, et qui plaira à tous ceux qui aiment sincèrement la nature : “ Ce n’est pas seulement en rêve, et dans le léger délire qui précède le sommeil, c’est encore éveillé, lorsque j’entends de la musique, que je trouve une analogie et une réunion intime entre les couleurs, les sons et les parfums. Il me semble que toutes ces choses ont été engendrées par un même rayon de lumière, et qu’elles doivent se réunir dans un merveilleux concert. L’odeur des soucis bruns et rouges produit surtout un effet magique sur ma personne. Elle me fait tomber dans une profonde rêverie, et j’entends alors comme dans le lointain les sons graves et profonds du hautbois. ” » « Il y a généralement dans l’ivresse du haschich trois phases assez faciles à distinguer [...]. C’est à cette (troisième) période de l’ivresse que se manifeste une finesse nouvelle, une acuité supérieure dans tous les sens. L’odorat, la vue, l’ouïe, le toucher participent également à ce progrès. Les yeux visent l’infini. L’oreille perçoit des sons presque insaisissables au milieu du plus vaste tumulte. C’est alors que commencent les hallucinations. Les objets extérieurs prennent lentement, successivement, des apparences singulières; ils se déforment et se transforment. Puis arrivent les équivoques, les méprises et les transpositions d’idées. Les sons se revêtent de couleurs et les couleurs contiennent une musique. Cela, dira-t-on, n’a rien que de fort naturel, et tout cerveau poétique, dans son état sain et normal, conçoit facilement ces analogies. Mais j’ai déjà averti le lecteur qu’il n’y avait rien de positivement surnaturel dans l’ivresse du haschich; seulement, ces analogies revêtent alors une vivacité inaccoutumée ; elles pénètrent, elles envahissent, elles accablent l’esprit de leur caractère 20 despotique. Les notes musicales deviennent des nombres, et si votre esprit est doué de quelque aptitude mathématique, la mélodie, l’harmonie écoutée, tout en gardant son caractère voluptueux et sensuel, se transforme en une vaste opération arithmétique, où les nombres engendrent les nombres et dont vous suivez les phases et la génération avec une facilité inexplicable et une agilité égale à celle de l’exécutant. » 21 Les Phares Dans une note bio-bibliographique rédigée sans doute en 1861, Baudelaire signale qu’il y a chez lui un « goût permanent depuis l’enfance de toutes les représentations plastiques ». Ce goût, il l’a reçu de son père qui se plaisait au milieu des belles toiles, recherchait la compagnie des artistes et, à l’occasion, peignait lui-même. C’est donc aux peintres qu’il doit sa formation artistique : il a toujours fréquenté leurs ateliers, et son œuvre est jalonnée d’études sur leurs expositions. Composition. Ainsi les « phares », les maîtres sur lesquels il se cuide. sont-ils des peintres, et un sculpteur admiré ce Delacroix. Il présente ici chacun d’eux en quatre vers qui évoquent l’essentiel de son oeuvre, ou du moins de ce que Baudelaire connaît de cette œuvre. Les médaillons ainsi obtenus (v. 1-28), consacrés à Rubens. Vinci. Rembrandt, Michel-Ange, Puget, Watteau. Goya et Delacroix, paraissent disposés dans un ordre qui va du clair au sombre. Une conclusion (v. 29-40) réunit le témoignage des huit artistes en un seul cri, qu’elle interprète. I. Delacroix (v. 25-281. On pourrait étudier d’abord le quatrain consacré à Delacroix, parce qu’il reprend et précise une analyse faite dans un article sur l’Exposition Universelle de 1855 (paru dans Le Pays du 3 juin 1855) et qu’il nous est donc « expliqué » par Baudelaire lui-même. Nous donnons cet article dans sa version définitive. Le passage qui va de « Un poète a essayé... » jusqu’à « les harmonies de sa couleur » est une addition de 1869. « D’abord il faut remarquer, et c’est très important, que, vu à une distance trop grande pour analyser ou même comprendre le sujet, un tableau de Delacroix a déjà produit sur l’âme une impression riche, heureuse ou mélancolique. On dirait que cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. Ce singulier phénomène tient à la puissance du coloriste, à l’accord parfait des tons, et à l’harmonie (préétablie dans le cerveau du peintre) entre la couleur et le sujet. Il semble que cette couleur, qu’on me pardonne ces subterfuges de langage pour exprimer des idées fort délicates, pense par elle-même, indépendamment des objets qu’elle habille. Puis ces admirables accords de sa couleur font souvent rêver d’harmonie et de mélodie, et l’impression qu’on emporte de ses tableaux est souvent quasi musicale. Une poète a essayé d’exprimer ces sensations subtiles dans des vers dont la sincérité peut faire passer la bizarrerie : Delacroix, lac de sang, hanté des mauvais anges, Ombragé par un bois de sapins toujours vert, Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges Passent comme un soupir étouffé de Weber. Lac de sang: le rouge; — hanté des mauvais anges: surnaturalisme; — un bois toujours vert: le vert, complémentaire du rouge; — un ciel chagrin: les fonds tumultueux et orageux de ses tableaux ; -— les fanfarres et Weber: idées de musique romantique que réveillent les harmonies de sa couleur. » 22 Le « surnaturalisme » est défini dans le Salon de 1846 : « Voici quelques lignes de M. Henri Heine qui expliquent assez bien la méthode de Delacroix, méthode qui est, comme chez tous les hommes vigoureusement constitués, le résultat de son tempérament : “ En fait d’art, je suis surnaturaliste. Je crois que l’artiste ne peut trouver dans la nature tous ses types, mais que les plus remarquables lui sont révélés dans son âme, comme la symbolique innée d’idées innées, et au même instant. ” » La question du choix des couleurs (le rouge et le vert en particulier), de leur rôle harmonique et mélodique, de leur résonance affective est étudiée dans le même Salon: « Le vert est le fond de la nature, parce que le vert se marie facilement à tous les autres tons (purs). Ce qui me frappe d’abord, c’est que partout, — coquelicots dans les gazons, pavots, perroquets, etc., — le rouge chante la gloire du vert; le noir, — quand il y en a, — zéro solitaire et insignifiant, intercède le secours du bleu ou du rouge. L’harmonie est la base de la théorie de la couleur. La mélodie est l’unité dans la couleur, ou la couleur générale. La mélodie veut une conclusion; c’est un ensemble où tous les effets concourent à un effet général. Ainsi la mélodie laisse dans l’esprit un souvenir profond. La plupart de nos jeunes coloristes manquent de mélodie. La bonne manière de savoir si un tableau est mélodieux est de le regarder d’assez loin pour n’en comprendre ni le sujet ni les lignes. S’il est mélodieux, il a déjà un sens, et il a pris sa place dans le répertoire des souvenirs. Le style et le sentiment dans la couleur viennent du choix, et le choix vient du tempérament. Il y a des tons gais et folâtres, folâtres et tristes, riches et gais, riches et tristes, de communs et d’originaux. Ainsi la couleur de Véronèse est calme et gaie. La couleur de Delacroix est souvent plaintive [...]. J’ai eu longtemps devant ma fenêtre un cabaret mi-parti de vert et de rouge crus, qui étaient pour mes yeux une douleur délicieuse. [...] Il me reste, pour compléter cette analyse, à noter une dernière qualité chez Delacroix, la plus remarquable de toutes, et qui fait de lui le vrai peintre du XIXe siècle : c’est cette mélancolie singulière et opiniâtre qui s’exhale de toutes ses œuvres, et qui s’exprime et par le choix des sujets, et par l’expression des figures, et par le geste, et par le style de la couleur.» On voit ce qu’a voulu faire Baudelaire : non pas la copie d’un Delacroix, ni celle d’un paysage (celuici est évidemment « surnaturaliste »), mais une synthèse des grands mouvements de l’âme romantique, c’est-à-dire de ce qui est « l’expression la plus récente, la plus actuelle du beau » — mais de mouvements bien éprouvés et clairement étudiés. Cela explique le choix des couleurs, de ce rouge, de « cette sanglante et farouche désolation, à peine compensée par le vert sombre de l’espérance »; le rappel des correspondances : « la mélancolie de Delacroix se lit jusque dans sa couleur, plaintive et profonde comme une mélodie de Weber » ; ce qu’il y a de sombre et d’ardent en même temps dans le rythme; et le sujet lui-même, plein de violence et de tristesse, évocateur d’un destin terrible et beau. II. Les médaillons (v. 1-24). 23 Les huit médaillons (notre édition ne donne pas le septième, consacré à Goya), ne se succèdent pas dans un ordre chronologique. On prendra garde toutefois qu’ils ne sont pas simplement juxtaposés, mais qu’il semble y avoir des rapprochements voulus : ainsi entre la vie des Rubens et le mystère des Vinci, entre l’hôpital des Rembrandt et le cimetière des Michel-Ange, entre la brutalité des Puget et l’élégance des Watteau — mais aussi de la puissance de Michel-Ange avec la puissance de Puget, etc. Il y a d’autre part un éclairage de plus en plus sombre, et la folie du joyeux Watteau ne saurait le corriger, de plus en plus « moderne » par conséquent. Rubens (v. 1-4) est vu par Baudelaire comme un artiste « universel », capable de tout peindre, un « grand coloriste » qui se caractérise par une « abondance prolifique, rayonnante, joviale presque », le véritable prédécesseur de Delacroix (les médaillons sont donc, de ce point de vue, comparables aux éléments d’un collier). Nos contemporains admirent son « énergie vitale », le fait qu’il « pousse jusqu’au lyrisme la transcription de la vie; son œuvre, telle un énorme torrent, la roule sous de multiples formes : chairs féminines ou enfantines, fruits, terrains qui houlent jusqu’à l’horizon, nuées, arcs-en-ciel, déploiement des forces dans la danse et la joie de la Kermesse, dans les chasses et les batailles, dans l’ampleur des épisodes grandioses du mythe païen ou de la religion chrétienne. » (René Huyghe). Mais l’auteur des Fleurs du Mal est arrêté par l’opulence des formes épanouies, par la sensualité saine (qui émane par exemple du Portrait d’Hélène Fourment), et ce bonheur paisible (v. 1) semble lui répugner (v. 2), comme lui répugne en général tout ce qui est naturel Léonard de Vinci (v. 5-8) nous apparaît tel que le musée du Louvre nous a habitués à le connaître : sur un arrière-plan qui représente un paysage des Dolomites (celui de La Vierge aux Rochers) nous situons des anges (comme le saint Gabriel de l’Annonciation, ou le Saint Jean-Baptiste si l’on veut), avec leurs visages énigmatiques, le sourire doux et mystérieux de La Joconde, tout un monde poétique aux couleurs frémissantes dans une lumière de crépuscule. C’est cela qu’évoquent les trois vers descriptifs, avec leur mélodie soutenue sur un rythme effacé. Mais c’est le premier vers du quatrain qui est le plus significatif. On notera en général dans tous ces médaillons, l’importance de la première assimilation : Rubens, fleuve..., Léonard de Vinci, miroir..., Rembrandt, triste hôpital..., On ne regarde pas un Léonard de Vinci directement, mais pour ainsi dire, dans le miroir d’une eau profonde et sombre. La Joconde existe autrement qu’une femme réelle, parce qu’elle a quelque chose d’insondable, de fascinant et d’indéterminé : le peintre a réussi à ne pas immobiliser la vie, à échapper aux servitudes de l’art plastique pour conserver et laisser deviner le monde de l’âme. Rembrandt (v. 9-12) est bien un hôpital (mais aussi l’auteur' de L’Hôpital), c’est-à-dire le peintre de la réalité humaine dans ce qu’elle a de plus misérable, que seule peut consoler la présence de celui qui a voulu souffrir et mourir comme nous. Il est vrai qu’il a composé des toiles moins « tristes » (comme Les Pèlerins d’Emmaüs), mais Baudelaire le caractérise exactement quand il en fait l’homme de la vérité nue, de la misère et de la solitude, que n’idéalisent plus les conventions traditionnelles : « Il secoue des haillons devant nos yeux et nous raconte les souffrances humaines »! (Salon de 1846) Et 24 pourtant, c’est « un puissant idéaliste ». Il exalte l’amour et la fraternité entre les êtres et leur signification religieuse : la prière s’élève au-dessus de la misère qu’éclaire un rayon de lumière. Michel-Ange (v. 13-16) est surtout étudié à travers sa sculpture, probablement parce que le Louvre ne possède pas de toile de lui, mais aussi à travers les fresques de la Sixtine, souvent reproduites : c’est donc la « hardiesse » de son dessin qui compte surtout, son goût du surprenant, son pathétique déjà baroque, bref, “ un art prodigieux comme le rêve ». Au réalisme de Rembrandt s’oppose ainsi le « vague » d’une création individuelle où se projettent les hantises d’une âme déjà moderne. Puget (v. 17-20) est un romantique (bien qu’il ait vécu de 1622 à 1694) : c’est l’homme qui est évoqué plus que l’œuvre, encore que les vers 17 et 18 fassent songer à deux beaux morceaux exposés au Louvre, le Milon de Crotone et le bas-relief d’Alexandre et Diogène. Un corps débile (v. 19) était habité par une grande âme. Sa gloire l’enfonçait dans la mélancolie v. 20 . Et de l’horrible il savait faire naître le beau v. 17-18 . Par lui aussi s’annonçait le XIXe siècle. Il Watteau v. 21-24) paraît interrompre la chaîne des prédécesseurs de Delacroix. La grâce et la fraîcheur de ses sujets, le caractère irréel de ses élégants décors 1“ désignent pour représenter la joie de vivre d’une société favorisée par le sort et qui ne se pose pas de questions. Mais d’abord c’est un moderne, en ceci qu’il ne s’intéresse pas aux « sujets » qu’il traite comme un musicien traite son thème, qu’il subordonne à l’effet d’ensemble, et qu’il est surtout un coloriste (on considère parfois l’Automne exposé au Louvre comme une toile impressionniste). Et puis (c’est cela que retient Baudelaire), l’univers de ses œuvres est un univers de fantaisie, qui rappelle celui de certaines comédies de Shakespeare ou des opéras de Mozart. Michelet, les Goncourt, y ont ................... vu une tristesse profonde, le pressentiment d’une destinée écourtée (Watteau était tuberculeux). Ce qui est évoqué ici, c’est plutôt une fête de la lumière et des couleurs, dont le tournoiement emporte ei détruit des fous dans une danse de mort (on en analysera la traduction sonore). III. « Cet ardent sanglot qui roule d’âge er âge... » (v. 29-40). Deux vers (v. 29-30) renvoient d’abord des médaillons aux sentiments qui les ont inspirés : le malheur y compte beaucoup plus que le bonheur, et le mol de malédictions paraît écraser toute l’énumération. Ils ne sont donc pas le résumé des quatrains, mais le rappel d’une position esthétique fondamentale les grandes œuvres sont, surtout, des « fleurs du mal » et le premier poème du recueil de Baudelaire est unf Bénédiction. Puis (v. 31-36) une série de métaphores souligne l’unité de l’art dans la diversité des œuvres (un s’opposant partout à mille). Elles font des artistes les sentinelles qui veillent sur la patrie (v. 33), les héraut: qui transmettent les commandements de la beauté (v. 34), les phares (v. 35) qui permettent de retrouver l’âme d’un peuple (et citadelles doit être entendre non pas comme un équivalent de villes, mais ave< son sens exact de lieu fortement défendu, comme doit l’être une civilisation). Mais elles disent auss: la démarche incertaine de ceux qui créent, perdu; dans les labyrinthes (v. 31) ou dans les grands boi. (v. 36), donc leur inquiétude, et en même temps h valeur d’apaisement et d’élévation de 25 l’œuvre : w divin opium. Dans la création artistique, ces être: mortels ont tenté d’oublier, pour un temps, leur imperfection, comme on a recours aux paradis artificiels pour s’évader. La dernière strophe peut ainsi ramener le drame de la création artistique à un ardent sanglot dont elle fait le témoignage de notre dignité. L’image finale (v. 39 40) évoque la permanence de ce sanglot (d’âge et âge). Leur nostalgie de la beauté serait la preuve qu< ces artistes se sentent « perdus » icibas, et comme en exil, et qu’ils ont conscience d’avoir une patrie commune hors de l’imperfection du monde terrestre Cette aspiration douloureuse, sans cesse renaissante est « le plus grand témoignage... de notre dignité »: pas l’œuvre d’art, nous nous élevons aussi haut qu’il es possible au-dessus de notre condition mortelle, ave< le sentiment qu’elle ne constitue pas tout notre être Tel est pour André Ferran, le sens du mot dignité « La dignité de l’homme, dit-il, c’est de chercher dans l’Art ce reflet divin. » Cette interprétation s’accorde avec la conception de la poésie et de la création littéraire maintes fois affirmée par Baudelaire à la suite d’Edgar Poe : « C’est cet admirable, cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà, et que révèle la vie, est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C’est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau ; et, quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d’un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d’une mélancolie irritée, d’une postulation des nerfs, d’une nature exilée dans l’imparfait et qui voudrait s’emparer immédiatement, sur cette terre même, d’un paradis révélé. Ainsi, le principe de la poésie est strictement et simplement l’aspiration humaine vers une beauté supérieure, et la manifestation de ce principe est dans un enthousiasme, une excitation de l’âme, — enthousiasme tout à fait indépendant de la passion qui est l’ivresse du coeur, et de la vérité qui est la pâture de la raison. » (Notes nouvelles sur Edgar Poe, 1857). Élargissant cette interprétation, M. Ruff écrit : « Le témoignage qu’elle (l’œuvre d’art) rend est celui de la dignité humaine, c’est-à-dire, comme le montre clairement le mouvement de la strophe, de sa postulation vers Dieu. » Mais on lit chez M. Vivier « Dans cette strophe encore soumise, entendez-vous gronder le premier accent de la rébellion?... A la personne de Dieu, [Baudelaire] oppose la dignité de l’homme. » Et Crépet-Blin, dans leur édition des Fleurs du Mal, p. 304, concluent : « Le lien entre les deux parties de notre poème serait donc le suivant : les grands artistes peignent la misère de l’homme; or cette misère, face à l’inaccessible royauté de Dieu, fait toute notre grandeur [...]. Le mot de dignité dans la bouche de l’homme parlant à Dieu revêt à lui seul un caractère de protestation. » Là encore, c’est l’interprétation métaphysique qui devra conduire la lecture du poème. Conclusion. « Le meilleur compte rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie », lit-on dans le Salon de 1846. Ici, l’œuvre d’un grand peintre est résumée dans un quatrain, ou du moins la partie de cette œuvre que Baudelaire connaît ou qui l’intéresse. Il n’a donc pas voulu montrer, mais évoquer, en sug- 26 gérant des sensations qui « correspondent » à l’atmosphère des grands maîtres. Et ces grands maîtres eux-mêmes ont été choisis en raison des affinités que leur idéal, leur sensibilité ou leur art peuvent avoir avec ceux du poète moderne, Les artistes, dans le langage qui est celui de leur art, celui des formes et des couleurs comme celui des mots, ont pour tâche de traduire les aspirations des hommes, leurs espoirs et leurs inquiétudes, leur conception de l’univers et de la vie. L’ordre dans lequel ils se succèdent n’est pas celui du hasard ou des siècles : chacun d’eux explore « une portion de l’empire » humain. Les meilleures parties ont été bientôt occupées : celles de la clarté et de la douceur, du bonheur d’être ou du rêve. Aux modernes, il ne reste que les parties basses, la violence, la folie, l’horreur, « le drame, le drame naturel et vivant, le drame terrible et mélancolique ». L’art moderne est celui du mal. Mais tous les arts ont le même sens mystique et doivent nous porter vers le haut, vers Dieu, que ce soit pour nous soumettre ou pour nous révolter. Le mouvement du poème. « La valeur de ce poème lui est-elle donnée par les huit “ médaillons ” d’artistes qui en forment la première partie? Nous avons montré que chaque médaillon évoque une œuvre précise de chaque peintre; c’est de belle critique d’art traduite en vers élégants. Mais, pris à part, ces quatrains ne feraient que huit épigrammes — à peine la monnaie d’un poème. Essayons de changer l’ordre, et revenons par exemple à l’ordre chronologique qui placera Léonard et Michel-Ange avant Rubens et Rembrandt : le début en sera faussé; le Rubens, en particulier, mettra dans l’ensemble une note faible et criarde. De plus, cet ordre chronologique rendrait inexplicables des omissions comme celles de Raphaël, de Titien ou de Velasquez. Baudelaire a-t-il, en plaçant ses quatrains, cherché la variété plutôt que l’ordre? Il a fait mieux : il a cherché un crescendo: celui de l’expression; il est allé de la plastique pure à l’âme. Et comme Goya est aussi expressif que Delacroix, il a quelque peu triché: il n’a montré de Goya que l’imagination, le cauchemar, pour donner au seul Delacroix les fanfares spirituelles qui vont amener la conclusion. Et il fallait qu’après l’évocation du dernier artiste le crescendo continuât : une seule image plastique après les “ médaillons ” aurait fait retour en arrière, aurait tout gâté : aussi la seule image visuelle, celle des Phares, n’évoquera que la lumière la plus vive dans l’ombre la plus noire. Toutes les autres images sont empruntées au monde plus émouvant des sons, pour y former un nouveau crescendo qui va de la parole articulée jusqu’à 1’ “ appel de chasseurs perdus dans les grands bois ” et à 1’ “ ardent sanglot ”, qui n’évoquent plus aucune pensée, mais l’émotion la plus nue et la plus troublante. Mais au moment le plus aigu de ce malheur passionné, au moment où cette émotion confuse et vive pourrait vaincre l’harmonie des vers et mettre le désordre en notre âme, une antithèse, la seule du poème, et à peine amorcée par le Te Deum de la neuvième strophe, vient restituer à l’art toute sa solide et pure substance, toute sa valeur qui crée et qui affirme l’homme; en même temps notre émotion perd sa pénible violence, semble sortir de nous, 27 elle déferle et s’étale sur une plage immense, nous amène sans souffrance à l’ordre et à la sérénité universels : Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage Que nous puissions donner de notre dignité Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge Et vient mourir au bord de votre éternité! Exactitude, valeur pittoresque, sont bien peu de chose auprès de cet art de faire grandir, d’ordonner, d’épurer l’émotion du lecteur. Pour nous servir, une fois de plus, de notre comparaison de la danse intérieure, nous dirons : les images plastiques attirent le regard, comme la robe pailletée de la danseuse, mais c’est le rythme du mouvement, la suite harmonieuse des émotions qui sont l’essentiel; c’est pour les servir que sont arborées la robe ou l’image. » (P- 349-35°) • Un art symboliste. « Que l’on prenne la pièce intitulée Les Phares, et, du premier vers de chacune des stances, que l’on retranche le premier mot : il semblera que ce soit le désordre, l’incohérence ou la folie mêmes. En vérité, ne diriez-vous pas de quelque sonnet de M. Mallarmé? Mais, maintenant, rétablissez l’intégrité du texte, et lisez : Rubens, fleuve d’oubli, jardin de la paresse... Léonard de Vinci, miroir profond et sombre... Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures... Vous pourrez bien, encore ici, discuter la juste équivalence de ces transpositions; et, si vous êtes “ du monde ”, vous pourrez bien vous égayer de cette comparaison de Rembrandt avec “ un triste hôpital ”, ou de Rubens avec “ un oreiller de chair fraîche ”, mais vous n’en méconnaîtrez pas au moins la singularité, — ni surtout l’étroite ressemblance avec la définition que nos symbolistes donneraient volontiers de leur art. La poésie n’est point du tout pour eux l’art “ d’exprimer ” ou “ d’idéaliser ” l’objet; et encore moins de le “ généraliser ”, ou même d’en dégager la signification secrète. Non; mais elle est l’art de sentir à l’occasion de l’objet et comme de s’abandonner aux suggestions qu’il provoque, jusqu’à ce qu’ayant pris elles-mêmes quelque chose de l’inconsistance du rêve, elles se traduisent à leur tour par des sensations qui en imitent le caractère flottant, irréel et bizarre. » (p. 139- 141). Delacroix peintre des correspondances. « Dans la moindre ébauche [de Delacroix] comme dans le tableau le plus important, le ciel, le terrain, les arbres, la mer, les fabriques participent à la scene qu'ils entourent; ils sont orageux ou clairs, mis ou tourmentés, sans feuilles ou verdoyants, calmes ou convulsifs, ruinés ou magnifiques, mais ils 'finissent par épouser les colères, les haines, les douleurs et les tristesses des personnages. Il serait impossible de les en détacher. Les figures elles-n ont des costumes, des draperies, des armes et accessoires significatifs. Le but de l’art, on l’a trop oublié de nos n’est pas la reproduction exacte de la nature bien la création au moyen des formes et des couleurs qu’elle nous livre, d’un microcosme où puissent se produire les rêves, les sensations et ce que nous inspire l’aspect du monde. C’est c comprenait instinctivement ou 28 scientifiquement Delacroix, et ce qui donnait à sa peinture un caractère particulier, si neuf et si étrange. » Une esthétique chrétienne ? « On aurait tort de voir seulement dans Les Phares un jeu savant d’évocations indirectes. Il y a là, c’est vrai, une réussite sans égale. Mais l’intérêt profond du poème n’est pas dans les médaillons individuels, pris en eux-mêmes, quelle que soit leur puissance de suggestion. Il est dans la conclusion qui dégage en trois strophes la signification des précédentes, c’est- à-dire qui définit le rôle de l’art. C’est une des clefs de son esthétique que Baudelaire nous propose ici* et peut-être la plus explicite. Chose curieuse, ce texte, pourtant si clair, a été diversement interprété. Certains ont même cru y entendre “ gronder le premier accent de la rébellion ”, C’est tout au contraire une explication qui restitue leur véritable sens aux poèmes de Révolte et les intègre dans ce témoignage où les malédictions et les blasphèmes eux-mêmes s’élèvent vers Dieu comme l’expression la plus haute de la dignité humaine. Ce qu’il faut entendre ici par dignité, c’est le sentiment d’une destinée supérieure, c’est l’aspiration vers l’idéal. Dès la strophe antépénultième, l’association de ces malédictions et blasphèmes aux extases et aux Te Deum montre bien que Baudelaire voit dans les uns et dans les autres le même mouvement de l’âme, et la magnifique amplification qui se développe en six vers cerne dans ses six images différentes le caractère de l’œuvre d’art, écho de l’humanité entière, divin opium des coeurs mortels — et les épithètes ont ici leur sens plein : c’est de Dieu que vient le calmant destiné à ces cœurs qui souffrent de leur condition terrestre et transitoire — cri des sentinelles, ordre, phare, appel de chasseurs perdus : le poète n’est plus le mage solennel ni le pilote des premiers romantiques, son privilège est dépouillé de ce vain orgueil. Si son œuvre reste une lumière, c’est seulement parce qu’il est un témoin exemplaire, plus assoiffé de Dieu et par conséquent plus sensible au mal, car “ le long hurlement qui roule d’âge en âge ” (telle est la version de 1857, moins heureuse que 1’ “ ardent sanglot ” mais qui donne plus de force encore à la pensée de Baudelaire) c’est le refus du Mal, c’est-àdire la “ postulation vers Dieu ”. Il apparaît donc que l’expression du mal est inséparable de l’art ainsi compris, mais que, même sous les formes extrêmes du blasphème et de la révolte, il reste toujours un appel vers Dieu, conscient ou inconscient. On comprend que, dans ses notes écrites vers la même époque, il ait trouvé “ G. Sand inférieure à de Sade ” : c’est que celui-ci fournit un “ meilleur témoignage ” de “ notre dignité ”, précisément dans la mesure où il dénonce notre corruption, que l’autre est tentée de nier. On comprend aussi qu’il ait pu, dans ces mêmes notes sur Les Liaisons dangereuses, rapprocher, en regard l’une de l’autre, ces deux phrases en apparence contradictoires : “ Tous les livres sont immoraux ”, et “ Livre de moraliste aussi haut que les plus élevés ”, La littérature du mal est à la fois un aveu et une plainte, un écho et un appel. Ce poème est tout autre chose qu’un hommage prestigieux rendu à quelques grands artistes. Il contient toute une esthétique, absolument nouvelle, et d’une telle richesse que, même incomplètement comprise, elle n’a cessé de nourrir les générations suivantes. » 29 Une révolte contre Dieu ? « Baudelaire a été élevé dans la religion catholique. La démarche de son esprit ne l’a jamais porté à mettre en doute l’explication catholique du monde. Il insère tout naturellement, dans les cadres et les symboles de cette religion, son idéalisme matérialiste. Le but de son aspiration sera le “ paradis ”. Cette existence limitée et fugace sera 1’ “ enfer ”. Et, si le poète se sent condamné par la fatalité de sa nature à désirer la solution d’un problème dont les termes mêmes sont contradictoires, c’est que Dieu a mis en lui ce désir et cette impossibilité. Il accusera Dieu d’avoir mal arrangé ce monde par rapport à lui, ou de l’avoir mal fait, lui, par rapport à ce monde, — ce qui est tout comme, du point de vue égoïste où il se place. Il dira : Dieu est mauvais pour l’homme. Sans doute, on trouvera tel passage où Baudelaire peut apparaître comme un chrétien plus soumis. Il a essayé de se dire que la douleur est une noblesse une épreuve qui mène à la béatitude : Je sais que la douleur est la noblesse unique... (Bénédiction Cependant, l’aspiration psychique parle trop impérieusement en lui pour qu’il puisse considérer autrement que comme un mal tout ce qui en contrecarre la réalisation. Sa souffrance n’est pas celle d’un homme frappé dans le relatif et qui s’en console en entre voyant la compensation d’une conquête dans l’absolu c’est par le relatif qu’il est frappé, et dans son appétence de l’absolu'. Il voit dans le mal terrestre h preuve que Dieu refuse à l’homme l’infini dont i ressent cependant Je besoin. A la puissance de Dieu il oppose la dignité de l’homme : Et c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage Que nous puissions donner de notre dignité Que cet arâent sanglot qui roule d’âge en âge Et vient mourir au bord de votre éternité. [Les Phares). Dans cette strophe encore soumise, entendez-vous gronder le premier accent de la rébellion? Cette dignité est-elle autre chose que la revendication de l’homme devant la puissance suprême? L’homme se pose en face de Dieu, comme quelqu’un qui sent pour soi le besoin et le désir de tout ce qui se réalise dans la personne divine : perfection, plénitude, éternité. Baudelaire est jaloux des attributs de Dieu, il les revendique comme un prétendant dépossédé : il est Satan. Tout le catholicisme de Baudelaire se concentre dans cette notion du mal, audacieusement attribué à la responsabilité divine. C’est le catholicisme vu par l’envers, par la face sombre, et prenant forcément la forme de la rébellion. Ce catholicisme-là ignore la Rédemption. Il est complet bien avant le Christ, dès la chute d’Adam. » 30 Élévation Baudelaire a souvent décrit la montée vers les cimes à laquelle l’appelait « l’ivresse », et on lira plus loin, à titre d’exemple, ce qu’elle a été lorsqu’il entendit l’ouverture de Lohengrin. De tels mouvements sont ceux des saints — on les trouve « sans exception dans tous les textes mystiques » (Crépet-Blin) — et aussi ceux des artistes de tous les siècles. On les a rencontrés chez Du Bellay (XVIe Siècle, p. 100) : mme chez Pascal XVIIe Siècle, p. 172); chez Cha- --lubnand XIXe Siècle, p. 42) comme chez Lamar- ./.V Siècle, p. 93 et p. 95). On sait que Vigny a écrit des Eléiations (Poèmes Antiques et Modernes, III) et que Banville, dans ses Odes funambulesques, a chanté .' ci qui « parlait bas en langue inconnue », et creva le plafond de toile pour aller « rouler dans les étoiles ». Mais, avant Baudelaire, nul n’avait encore exprimé ce que Banville appellera « l’attrait du gouffre d’en-haut » en lui donnant une telle traduction physique, avec autant de force dramatique. Composition. Dans les éditions de 1861 et de 1868, Elévation vient immédiatement après L’Albatros: le poète qui ne sait pas marcher et que la terre fait souffrir s’envole loin du réel dans un monde idéal. Mais cela ne nous est pas dit sur le mode narratif. Ce que dit le poème, c’est d’abord le vol (strophes 1 et 2), puis xix - 232 l’envol (strophe 3), et enfin l’appel au départ (strophes 4 et 5). 2. Le vol (v. 1-8). Dans la liturgie catholique, l’élévation est la partie de la messe où le prêtre fait adorer l’hostie et le calice consacrés. Dans la littérature religieuse, l’élévation est l’élan d’une âme vers Dieu, et la prière qui la demande (ainsi Bossuet a-t-il écrit des Elévations à Dieu sur les mystères). Le titre est donc chrétien. Mais l’univers auquel le poète aspire est le monde idéal selon le mythe final du Phédon (cf. Document complémentaire). Le vocabulaire va le souligner : Véther (v. 12) est un air « subtil et igné » à la partie supérieure de l’atmosphère; les sphères sont les 26 (ou 33) régions de l’espace céleste que distinguaient les Grecs. Enfin, le souvenir de Lucrèce {De Natura Rerum, V, v. 416-508) n’est sans doute pas absent, v. 1-4. — La première strophe dit la. montée vers ce monde invisible. Elle se fait à larges coups d’ailes (v. 1, v. 3 et premier hémistiche du v. 4), séparés et prolongés par des vols. L’un (v. 2) est indiqué par un ralentissement (coupes et e muets) ; un autre (v. 4) par un changement de rythme qui nous arrête sur le mot essentiel, celui de sphères. Les confins de ces sphères sont les régions placées à la limite de l’espace céleste : le mot appartient à la langue classique, et on notera qu’en général le vocabulaire a une couleur archaïque, : l’onde est l’eau, la liqueur est un liquide, les pensers sont des pensées, ennui a un sens fort. L’impression dominante est celle d’un élan (souligné par les anaphores : au-dessus, des, par-delà) qui mène à des régions de plus en plus élevées. Les contours de la terre s’effacent (v. 1-2), la poésie échappe au monde d’ici-bas pour rejoindre les hauteurs de l’univers (v. 3-4). 31 v. 5-8. — La seconde strophe est d’un rythme moins régulier, et d’un sentiment plus complexe. Le mouvement facile de l’oiseau dans l’éther a sa coires- pondance dans celui du nageur dans l’onde, de même que la profondeur est à la fois au-dessus et au-dessous. Le bonheur est éprouvé physiquement : exprimé en des termes qui conviennent au corps, il est celui de Vesprit (il se meut, il sillonne), agissant gaîment (l’adverbe est souligné). En dépit des dissonances rythmiques, les sonorités de la strophe disent le glissement aisé du bon nageur qui évolue en se jouant et se pâme dans l’onde. Ainsi l’aisance n’exclut-elle pas la force, et le mouvement évoqué n’a rien de décadent : comme le nageur maître de son élément, l’esprit se meut librement dans cet univers supra- terrestre qui est sa conquête. Calme et vigueur, effort et jouissance se mêlent : mâle volupté ! 3. “Envole-toi...” (v. 9-12). La prière a, chez Baudelaire, quelque chose de traditionnel : elle place devant lui l’objet à atteindre, (str. 1 et 2), puis il cherche à l’obtenir. La strophe 3 va exprimer cette volonté par les impératifs détachés en tête de vers, et surtout par les sonorités aiguës qui disent la pensée et le corps tendus jusqu’au cri. Elle s’élargit sur les vers 11 et 12 (aux belles sonorités allitérantes) à mesure qu’apparaissent les perspectives lumineuses. Au centre, le moteur {purifier, v. 10, pure, v. 11), repris par clair et limpide (v. 12). En opposition (v. 9), et pour expliquer les exhortations véhémentes, le dégoût qu’inspire le cloaque de la terre puante (on notera l’allitération miasmes morbides). L’association directe des sensations renouvelle l’expression de boire un feu, On n’oubliera pas que c’est l’esprit qui est ainsi. exhorté. Sa joie est traduite par référence aux sensations du monde matériel. Balzac disait déjà dans Louis Lambert : « Aussi la pensée m’apparaissait-elle comme une puissance toute physique. » Et cette joie est génératrice de poésie, car c’est l’esprit pur qui est poète! 4. L’appel du bonheur (v. 13-20). Il y a maintenant un nouveau repli. Le poète a été celui qui plane (str. 1-2), celui qui veut s’envoler (str. 3). Il devient celui qui rêve d’un envol (str. 5-6). La plus grande faiblesse de Baudelaire a peutêtre été la « procrastination », la peur d’un effort qu’il a toujours différé et qui lui semblait d’autant plus difficile. Quand il lui est arrivé de l’accomplir, il est bientôt retombé : l’idéal lui est apparu comme inaccessible alors qu’il le touchait du doigt. Ce n’est donc pas la volonté de vivre sur les cimes qu’on trouve au départ de ce poème (et des Fleurs du Mal en général), mais le regret de minutes heureuses et fugitives. Le mouvement général reste celui des premières strophes : un appel (v. 13-18) est suivi d’un palier (v. 19-20) légèrement descendant, dans une aurore qui éblouit l’œil et éloigne les choses. Il maintient l’opposition entre la vie brumeuse et pesante et l’idéal lumineux. Les vastes chagrins sont des chagrins infinis et dévorants : le poids étouffant est celui de l’inquiétude plutôt que celui du malheur; on notera l’opposition de lumineux et de brumeux, celle de chagrins et de sereins, et on comparera le rythme des vers 13-14 à celui des vers 15-16. Entre les deux, l’effort (v. 15) qui demande la vigueur de l'alouette au vol vertical (v. 17) et dont Baudelaire, enchaîné par son destin, se sent incapable. 32 Les deux derniers vers, d’une admirable plénitude dans leurs sonorités mélancoliques, disent le rôle du poète, non tel qu’il est, mais tel qu’il souhaiterait être, et qu’il parvient à être quelques fois. Il parle le langage des fleurs (symbolisme banal, que Baudelaire ne refuse d’ailleurs pas) et celui des choses muettes (ce qui suppose qu’il est initié aux correspondances : dans les trois éditions, le sonnet des Correspondances suit Elévation). Ainsi pénètre-t-il avec l’intuition du « voyant » le mystère de la nature. Dominant le monde, obscur, devenu intelligible par son esprit lucide et serein, il est réconcilié avec la vie. Conclusion. A une opposition traditionnelle entre l’idéal et le réel, Baudelaire a donc imposé sa marque, disant le dégoût essentiel de ce qui est, son impuissance à y échapper, et un idéal lucidement conçu. Il l’a exu Les figures eUes-rneme primée dans un symbolisme savant, avec une extraordinaire richesse musicale. Il s’est montré à nous allant vers la poésie comme vers un plaisir physique. Cette poésie est inséparable de l’intelligence lucide du monde : elle engendre une joie de l’esprit pure et sereine, génératrice d’une œuvre « faite de volupté et de connaissance ». Mallarmé reprendra le même thème dans le même sens (voir XIXe Siècle, p. 532). Mais c’est tout autrement que la poésie de Claudel, dont on parle volontiers à propos d'Élévation, absorbera l’univers (voir XXe Siècle, p. 188). Le souffle du poète. J. Prévost, Baudelaire (Mercure de France). « La mesure du souffle est assez courte chez Baudelaire [...]. Une strophe est la mesure habituelle de (ses) élans. [...] Dans ces limites, qui conviennent aux sentiments qu’il exprime, Baudelaire est un très grand maître. Quelques exemples variés vont nous montrer les effets du souffle sur l’émotion. Commençons par des émotions gaies et heureuses. Quand des reprises d’air trop rares ou forcées ne brisent pas le mouvement d’ensemble, l’acteur ou nous-mêmes pouvons dire sans fatigue le poème à pleins poumons : nous en tirons une impression de vigueur, de puissance accrue, d’énergie aisée. Quand, arrivés à ce sommet de l’inspiration physique, nous pouvons continuer de dépenser notre souffle sans l’affaiblir, quand cette puissance acquise joue aisément et librement, c’est la joie : notre sang, animé par le souffle, vient bientôt en renforcer le sentiment de plénitude intérieure. C’est ainsi que nous émeut le poème Elévation. Les deux premières strophes sont liées par la ponctuation et le sens. Les trois premiers vers, bien coupés, où deux 0 procurent dès le début l’aspiration la plus ample, donnent une extrême plénitude, et permettent de dire d’un élan le quatrième vers. Les cinquième et sixième vers, eux aussi coupés, nous rendent assez d’haleine pour les septième et huitième vers, faciles à dire chacun d’un jet, et qui forment comme une nappe étale : Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 33 Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, Par delà le soleil, par delà les éthers, Par delà les confins des sphères étoilées, Mon esprit, tu te meus avec agilité, El. comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde, Tu sillonnes gaîment l’immensité profonde Avec une indicible et mâle volupté. Aux neuvième et dixième vers, le poète n’a ménagé que deux repos plus menus qu’une virgule; malgré - d- notre haleine, nous aurons ici une iinpres5. d'effort le sens la demande. Mais le onzième vers, avec un repos qui précède la troisi et un léger repos à la césure, permet de dii de la strophe avec une large aisance : Envole-toi / bien loin de ces miasmes Va te purifier / dans l’air supérieur, Et bois, comme une pure et divine lique Le feu clair qui remplit les espaces lit Les deux dernières strophes sont unies, 1 lien plus lâche que n’étaient les deux p Elles commencent par les deux vers les plu les moins coupés de la pièce, qui laissent £ mons un peu d’oppression, presque d’angoi: sens le veut aussi. Mais une ample reprise : rée du mot heureux, la demi-virgule à la cé même vers, au vers suivant un repos après sième syllabe, rétablissent l’aisance. La d strophe commence par un vers bien coupé demi-virgules rendent le suivant aussi aisé, bit plus rapide. Enfin, la coupure de Pavant-dernii prépare le vers large, la dépense de souffle u douce qui termine la pièce : Derrière les ennuis et les vastes chagrins Qui chargent de leur poids l’existence brumeu Heureux celui qui peut / d’une aile vigourev S’élancer vers les champs lumineux et sereins Celui dont les pensers, comme des alouettes, Vers les cieux / le matin / prennent un libre esso — Qui plane sur la vie et comprend sans effort Le langage des fleurs et des choses muettes! Ampleur qui ne cherche pas l’éclat, souffle acc qui se dépense sans peine : après l’élan vif des pris d’haleine, c’est le bonheur apaisé d’une respiratic égale, pareil à la joie limpide du coureur après s course. Ce poème, le plus aéré de Baudelaire, n’ besoin que d’être bien dit pour nous inspirer 1; même plénitude, la même griserie, que le vent dti large ou l’atmosphère des hauts lieux. » (p. 290-292). La volupté des « hauts lieux ». Baudelaire, Richard Wagner et Tannhaüser a Paris. « Dès les premières mesures (de l’ouverture de Lohengrin), je subis une de ces impressions heureuses que presque tous les hommes imaginatifs ont connue par le rêve, dans le sommeil. Je me sentis délivré des liens de la pesanteur, et je retrouvai par le souvenir l’extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts [...]. Ensuite, je me peignis involontairement l’état délicieux d’un homme en proie à une grande rêverie dans une solitude absolue, mais une solitude avec un immense horizon et une large lumière diffuse ; l’immensité sans autre décor qu’elle-même. Bientôt j’éprouvai la sensation d’une clarté plus vive, d’une intensité de lumière croissant avec une telle rapidité, que des nuances fournies par le dictionnaire ne suffiraient pas à exprimer ce surcroît toujours renaissant d’ardeur et de blancheur. Alors je conçus pleinement l’idée 34 xix - 234 d’une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d’une extase faite de volupté et de connaissance, et pla- 1 nant au-dessus et bien loin du monde naturel. » Platon, Phédon, 109. « Quant à la terre, en elle-même et toute pure, c’est dans la partie pure du monde qu’elle se trouve, celle où sont les astres et à laquelle le nom d’éther est donné par la foule de ceux qui ont coutume de discourir sur de telles questions. [...] Nous, donc, nous en habitons les creux, mais sans nous en douter; et nous imaginons habiter en haut, sur la surface de la terre. Tel serait le cas d’un homme logé à mi-distance du fond de la pleine mer; il s’imaginerait être logé à la surface de celle-ci, et, comme à travers l’eau il verrait le soleil et le reste des astres, il prendrait en même temps la mer pour du ciel; son indolence et sa faiblesse ne lui auraient encore jamais permis de parvenir au sommet de la mer, ni, une fois qu’il aurait émergé de cette mer et levé la tête au dehors vers cette région-ci, de voir à quel point elle est plus pure et plus belle que celle de ses pareils, dont nul non plus ne l’aurait instruit, faute de l’avoir vue. C’est la même chose, certainement, qui nous arrive à nous aussi : logeant dans un des creux de la terre, nous nous imaginons loger tout en haut de celle-ci; nous appelons ciel l’air, comme s’il était le ciel que parcourent les astres. Et voici en quoi notre cas est bien le même : notre faiblesse et notre indolence nous font incapables de traverser l’air de bout en bout; oui, supposons qu’on en atteigne le sommet, ou bien qu’on prenne des ailes et qu’on s’envole, alors en effet on en aurait le spectacle, parce qu’on élèverait la tête, comme ici-bas les poissons en élevant la tête hors de la mer voient les choses d’ici-bas; oui, c’est ainsi qu’on aurait le spectacle de celles qui sont là-haut. Supposons enfin à notre nature le pouvoir de soutenir cette contemplation : on connaîtrait alors que ce qui en est l’objet est le ciel véritable, et la vraie lumière, et la terre véritablement terre! » (Traduction de L. Robin, éditée aux Belles Lettres). De l’esthétique à la métaphysique. R. Vivier, Critique et métaphysique (RHLF, avril 1967) - « Tout un courant d’idées auquel Baudelaire se trouvait depuis longtemps sensible, et dont un Jean Pommier a mis en lumière l’influence sur lui, tendait à incliner dans le même sens sa spéculation esthétique. Parmi ces guides Edgar Poe fut peut-être l’un des plus persuasifs, et dès 1857 on pouvait lire dans les “ Nouvelles Notes ” sur l’auteur du “ Corbeau ” ces lignes si souvent citées par la suite : “ C’est cet admirable, cet immortel instinct du Beau, qui nous fait considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel [...]. C’est à la fois par la poésie et a travers la poésie, par et à travers la musique, que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. ” L’imagination elle-même n’était pas évoquée, sans doute parce qu’en dépit des termes comme irrésistiblement plastiques de “ spectacles ” et de “ splendeurs ”, il n’était pas question de l’art des peintres. 35 Mais on la retrouve sous un autre nom dans l’étude sur Victor Hugo : “ la certitude morale de l’intuition”. Cependant nous sommes loin ici aussi de l’esthétique, et devant la rêverie métaphysique hugolienne, qu’il évoque à larges touches, le critique s’en tient aux termes prudents de “ conjecture ” et de “ possible ”. Mouvante, ouverte à la profusion du futur, la méditation de Hugo ne pouvait être que saluée de loin par la concentration de Baudelaire, éprise d’une sorte de fini jusque dans l’infini et soucieuse d’assises plutôt que des aventures d’un devenir. Cette tendance à la concentration, devant le tableau, avait tout d’abord exigé l’ordre unitaire de la composition. Mais il n’avait pu lui suffire que l’artiste mît cet ordre dans son tableau en y établissant analogies et correspondances par nécessité opératoire, et elle avait voulu qu’une faculté particulière le conduisît à ressaisir dans cet ordre frais du tableau quelque ordre plus ancien, fondamental. Ainsi la dimension temporelle elle-même s’y trouverait condensée, et l’œuvre suggérerait le retour souhaité à un profond passé, horizon immuable de la ■dispersion et de la fluctuation des apparences. Sur quelle philosophie asseoir une telle vue ? Entre toutes il en existait une qui, pour le romantique qu’il était, offrait une séduction particulière. Elle en avait séduit plus d’un, de Novalis à Coleridge ou Shelley, cette perspective d’un univers substantiellement symbolique où l’esprit pouvait s’ébattre “ comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde ”, Baudelaire la retrouve notamment dans ses lectures américaines, Poe, Emerson... En France même elle s’était propagée dans le prestige d’un demi-secret, et s’y rallier était rejoindre une sorte d’aristocratie spirituelle. Philosophie pour artistes, pour poètes, et qui proposait à la pensée d’un esthéticien-poète une explication à la fois grandiose et facile de ce qu’il y a de plus mystérieusement attirant dans la poésie prise au sens large. Dans ce domaine, tout se passe “ comme si ”, Par une enjambée assez enivrante du comme si à un cela est, il en est venu quelquefois à croire, ou du moins à affirmer lyriquement (tous ces moments de sa critique sont lyriques), que la faculté reine n’imagine pas cet ordre primitif au sens ordinaire du mot imaginer, mais en repère les traces dans le désordre du réel, et, par l’ordre poétique, le révèle. » (p. 420-421). Elévation et ascension, « Je retrouvai par le souvenir l’extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts », écrit Baudelaire dans Richard Wagner. Ces lieux hauts, ce sont les montagnes, et le souvenir est celui d’un voyage dans les Pyrénées fait en compagnie du colonel Aupick en 1838. Les deux voyageurs, partis de Cau- terets, ont sans doute fait une course en direction du Vignemale en passant par le lac de Gaube. Trois textes nous disent « l’enchantement » que 'Ât'Û' 36 XIX - 235 d’une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d’une extase faite de volupté et de connaissance, et pla- 1 nant au-dessus et bien loin du monde naturel. » Platon, Phédon, 109. « Quant à la terre, en elle-même et toute pure, c’est dans la partie pure du monde qu’elle se trouve, celle où sont les astres et à laquelle le nom d’éther est donné par la foule de ceux qui ont coutume de discourir sur de telles questions. [...] Nous, donc, nous en habitons les creux, mais sans nous en douter; et nous imaginons habiter en haut, sur la surface de la terre. Tel serait le cas d’un homme logé à mi-distance du fond de la pleine mer; il s’imaginerait être logé à la surface de celle-ci, et, comme à travers l’eau il verrait le soleil et le reste des astres, il prendrait en même temps la mer pour du ciel; son indolence et sa faiblesse ne lui auraient encore jamais permis de parvenir au sommet de la mer, ni, une fois qu’il aurait émergé de cette mer et levé la tête au dehors vers cette région-ci, de voir à quel point elle est plus pure et plus belle que celle de ses pareils, dont nul non plus ne l’aurait instruit, faute de l’avoir vue. C’est la même chose, certainement, qui nous arrive à nous aussi : logeant dans un des creux de la terre, nous nous imaginons loger tout en haut de celle-ci; nous appelons ciel l’air, comme s’il était le ciel que parcourent les astres. Et voici en quoi notre cas est bien le même : notre faiblesse et notre indolence nous font incapables de traverser l’air de bout en bout; oui, supposons qu’on en atteigne le sommet, ou bien qu’on prenne des ailes et qu’on s’envole, alors en effet on en aurait le spectacle, parce qu’on élèverait la tête, comme ici-bas les poissons en élevant la tête hors de la mer voient les choses d’ici-bas; oui, c’est ainsi qu’on aurait le spectacle de celles qui sont là-haut. Supposons enfin à notre nature le pouvoir de soutenir cette contemplation : on connaîtrait alors que ce qui en est l’objet est le ciel véritable, et la vraie lumière, et la terre véritablement terre! » (Traduction de L. Robin, éditée aux Belles Lettres). De l’esthétique à la métaphysique. R. Vivier, Critique et métaphysique (RHLF, avril 1967) - « Tout un courant d’idées auquel Baudelaire se trouvait depuis longtemps sensible, et dont un Jean Pommier a mis en lumière l’influence sur lui, tendait à incliner dans le même sens sa spéculation esthétique. Parmi ces guides Edgar Poe fut peut-être l’un des plus persuasifs, et dès 1857 on pouvait lire dans les “ Nouvelles Notes ” sur l’auteur du “ Corbeau ” ces lignes si souvent citées par la suite : “ C’est cet admirable, cet immortel instinct du Beau, qui nous fait considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel [...]. C’est à la fois par la poésie et a travers la poésie, par et à travers la musique, que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. ” L’imagination elle-même n’était pas évoquée, sans doute parce qu’en dépit des termes comme irrésistiblement plastiques de “ spectacles ” et de “ splendeurs ”, il n’était pas question de l’art des peintres. 37 Mais on la retrouve sous un autre nom dans l’étude sur Victor Hugo : “ la certitude morale de l’intuition”. Cependant nous sommes loin ici aussi de l’esthétique, et devant la rêverie métaphysique hugolienne, qu’il évoque à larges touches, le critique s’en tient aux termes prudents de “ conjecture ” et de “ possible ”. Mouvante, ouverte à la profusion du futur, la méditation de Hugo ne pouvait être que saluée de loin par la concentration de Baudelaire, éprise d’une sorte de fini jusque dans l’infini et soucieuse d’assises plutôt que des aventures d’un devenir. Cette tendance à la concentration, devant le tableau, avait tout d’abord exigé l’ordre unitaire de la composition. Mais il n’avait pu lui suffire que l’artiste mît cet ordre dans son tableau en y établissant analogies et correspondances par nécessité opératoire, et elle avait voulu qu’une faculté particulière le conduisît à ressaisir dans cet ordre frais du tableau quelque ordre plus ancien, fondamental. Ainsi la dimension temporelle elle-même s’y trouverait condensée, et l’œuvre suggérerait le retour souhaité à un profond passé, horizon immuable de la ■dispersion et de la fluctuation des apparences. Sur quelle philosophie asseoir une telle vue ? Entre toutes il en existait une qui, pour le romantique qu’il était, offrait une séduction particulière. Elle en avait séduit plus d’un, de Novalis à Coleridge ou Shelley, cette perspective d’un univers substantiellement symbolique où l’esprit pouvait s’ébattre “ comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde ”, Baudelaire la retrouve notamment dans ses lectures américaines, Poe, Emerson... En France même elle s’était propagée dans le prestige d’un demi-secret, et s’y rallier était rejoindre une sorte d’aristocratie spirituelle. Philosophie pour artistes, pour poètes, et qui proposait à la pensée d’un esthéticien-poète une explication à la fois grandiose et facile de ce qu’il y a de plus mystérieusement attirant dans la poésie prise au sens large. Dans ce domaine, tout se passe “ comme si ”, Par une enjambée assez enivrante du comme si à un cela est, il en est venu quelquefois à croire, ou du moins à affirmer lyriquement (tous ces moments de sa critique sont lyriques), que la faculté reine n’imagine pas cet ordre primitif au sens ordinaire du mot imaginer, mais en repère les traces dans le désordre du réel, et, par l’ordre poétique, le révèle. » (p. 420-421). Elévation et ascension, « Je retrouvai par le souvenir l’extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts », écrit Baudelaire dans Richard Wagner. Ces lieux hauts, ce sont les montagnes, et le souvenir est celui d’un voyage dans les Pyrénées fait en compagnie du colonel Aupick en 1838. Les deux voyageurs, partis de Cau- terets, ont sans doute fait une course en direction du Vignemale en passant par le lac de Gaube. Trois textes nous disent « l’enchantement » que 'Ât'Û' produisit chez le jeune homme cette initiation à « l’alpinisme ». 38 Le premier est un poème écrit vers 183g, dont voici le début et la fin : Tout là-haut, tout là-haut, loin de la route sûre, Des fermes, des vallons, par delà les coteaux, Par delà les forêts, les tapis de verdure, Loin des derniers gazons foulés par les troupeaux, On rencontre un lac sombre encaissé dans l’abîme Que forment quelques pics désolés et neigeux; L’eau, nuit et jour, y dort dans un repos sublime, Et n’interrompt jamais son silence orageux. [...] On dirait que le ciel, en cette solitude ^Se contemple dans l’onde, et que ces monts, là-bas, Ecoutent, recueillis, dans leur grave attitude, Un mystère divin que l’homme n’entend pas. Et lorsque par hasard une nuée errante Assombrit dans son vol le lac silencieux, On croirait voir la robe ou l’ombre transparente D’un esprit qui voyage et passe dans les cieux. (Éd. Pléiade, p. 193) Le second est Elévation qui, d’une tout autre qualité poétique, reprend en somme le même thème (en le généralisant et en l’enrichissant) et part sur le même mouvement (comparer les strophes initiales) . Le troisième est Le Gâteau (Petits Poèmes en prose. XV) qui juxtapose à 1’ « élévation » un fait divers sordide, et ramène donc de l’idéal au réel — obligeant du même coup à reconsidérer la définition du fait poétique : « Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j’étais placé était d’une grandeur et d’une noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque chose dans mon âme. Mes pensées voltigeaient avec une légèreté égale à celle de l’atmosphère ; les passions vulgaires, telles que la haine et l’amour profane, m’apparaissaient maintenant aussi éloignées que les nuées qui défilaient au fond des abîmes sous mes pieds; mon âme me semblait aussi vaste et'aussi pure que la coupole du ciel dont j’étais enveloppé; le souvenir des choses terrestres n’arrivait à mon cœur qu’affaibli et diminué, comme le son clochette des bestiaux imperceptibles qui pai loin, bien loin, sur le versant d’une autre mon Sur le petit lac immobile, noir de son immens fondeur, passait quelquefois l’ombre d’un i comme le reflet du manteau d’un géant aérien à travers le ciel. Et je me souviens que cette tion solennelle et rare, causée par un grand n ment parfaitement silencieux, me. remplissait joie mêlée de peur. Bref, je me sentais, grâce i thousiasmante beauté dont j’étais environni parfaite paix aveç moi-même et avec l’unive crois même que, dans ma parfaite béatitude et mon total oubli de tout le mal terrestre, j’en venu à ne plus trouver si ridicules les journau prétendent que l’homme est né bon; — quai matière incurable renouvelant ses exigence songeai à réparer la fatigue et à soulager l’af causés par une si longue ascension. Je tirai dt poche un gros morceau de pain, une tasse de et un flacon d’un certain élixir que les pharma vendaient dans ce temps-là aux touristes poi mêler à l’occasion avec de l’eau de neige. Je découpais tranquillement mon pain, quani bruit très léger me fit lever les yeux. Devant m tenait un petit être déguenillé, noir, ébouriffé, les yeux creux, farouches et comme suppliants, d raient le morceau de pain. Et je l’entendis soup d’une voix basse et rauque, le mot : gâteau! Ji pus m’empêcher 39 de rire en entendant l’appella dont il voulait bien honorer mon pain presque bl et j’en coupai pour lui une belle tranche que je offris. Lentement il se rapprocha, ne quittant des yeux l’objet de sa convoitise; puis, happai morceau avec sa main, se recula vivement, con s’il eût craint que mon offre ne fût pas sincère ou je m’en repentisse déjà. » Mais un second enfant survient, et les deux frère. battent férocement pour le « gâteau ». « Ce spectacle m’avait embrumé le paysage, la joie calme où s’ébaudissait mon âme avant d’a\ vu ces petits hommes avait totalement disparu; j restai triste assez longtemps, me répétant sans ces “ Il y a donc un pays superbe où le pain s’appf du gâteau, friandise si rare qu’elle suffit pour eng drer une guerre parfaitement fratricide! ”. » L’Albatros Deux témoignages précis, circonstanciés, d’amis de jeunesse font de L’Albatros un souvenir de voyage de 1841 : Baudelaire serait intervenu avec violence contre des matelots qui avaient pris un albatros et lui brûlaient les yeux avec leurs pipes. Mais le poème n’a été publié qu’en février 1859. Il n’avait alors que douze vers, et une autre strophe, la troisième du texte actuel, a été ajoutée à la demande d’Asselineau Page 434 pour « faire tableau de l’embarras » de l’oiseau, donner ainsi plus de force à la comparaison. M. Je: Pommier pense que l’œuvre a pu être compost dans l’hiver de 1858-1859. Elle pourrait bien êt: née en effet à la fois de l’aventure vécue et des le tures de Baudelaire, celles des Récits de Cook c de Poe, celle de la Mystique de Gôrres, traduite e 1854, qui montre les élus de Dieu « plus accoutumes xix - 236 évoqué dans sa gaucherie : maladroits et honteux dès qu’ils reposent sur cet élément pour lesquels ils ne sont pas faits, et l’adverbe piteusement se détache par sa lourdeur et par sa place. Les grandes ailes blanches qui lui assuraient — et avec quelle grâce ! — la maîtrise des airs sont désormais des obstacles, des avirons parfaitement inutiles — et gênants — pour se déplacer sur les planches. On croit entendre la grosse raillerie des matelots devant cette déchéance. Baudelaire donne ici une précision que les artistes acceptent rarement : le génie est la marque d’une supériorité, mais il entraîne en contre-partie une inadaptation aux réalités de la vie ordinaire et devient ridicule aux yeux du vulgaire. Le contraste entre l’univers éthéré du poète et le monde matériel est suggéré par des oppositions significatives : azur- planches, ailes-avirons. Strophe III. L’adjonction d’une strophe ne pouvait rien apporter à l’anecdote, mais elle a ménagé une pause, occupée par un commentaire qui fait mieux voir le caractère dramatique de la scène. Ce commentaire porte d’abord sur l’oiseau, qui perd sa beauté dès qu’il touche terre : le rythme souligne les mots essentiels, ailé-veule, beau-laid. En cela, il ressemble au poète, le voyageur par excellence qu’on jalouse pour sa supériorité et qu’on se plaît à mépriser, à rabaisser. Les matelots font assaut de vulgarité : le rire est « impur », toujours, mais en outre la trivialité des gestes, l’emploi d’un terme vulgaire (brûle-gueule) 40 succédant à celui de nobles périphrases, accusent l’effet. Ils sont cruels (le rythme souligne leurs gestes), sans méchanceté voulue. La strophe s’achève sur une expression magnifique et riche de résonances. L'infirme qui volait doit être mis dans la bouche de l’auteur comme une suprême protestation, plutôt que dans celle des matelots; mais l’expression ne peut-elle être entendue de l’un et de l’autre, simultanément, et en des sens différents? voler qu’à marcher [...} Semblables à des oiseaux assaillis par la tempête », et incompris du vulgaire. Peut-être faut-il noter aussi l’influence du milieu (Baudelaire rat alors à Honfleur) et des préoccupations domkfantes du poète (il écrit Le Voyage). L’isolement de l’homme de génie est un des grands thèmes littéraires : on le rencontre chez les poètes de la Pléiade, chez Rousseau, chez les Romantiques, chez Vigny surtout (voir XIXe Siècle, p. 125, 152, 259). Les Parnassiens l’ont repris (voir XIXe Siècle, p. 261), et d’autre part Leconte de Lisle a écrit un Albatros. Souvent cette solitude nous est rendue sensible par le biais d’une comparaison : avec le mage ou le prophète, l’aigle ou le condor, le loup chassé dans les bois ou le pin dressé dans la lande. Le sujet est toujours le même, mais le choix et la présentation des personnages lui donne sa valeur dramatique, — et la façon pittoresque, morale ou symbolique dont l’analogie est présentée, sa valeur poétique. Strophes I et II. v. 1 -4. — C’est une anecdote que raconte Baudelaire, mais de l’anecdote il passe au cas général (souvent) : il lui donne une valeur morale et prépare ainsi le symbole. On l’interprétera en pensant à la grossièreté d’esprit et de mœurs des équipages de l’époque (voir Poe : Aventures d’A.-G. Pym ou 'Melville : Moby Dick) et à la distinction que suppose un ennui aristocratique. Ces hommes d'équipage représentent la foule qui, avec une cruauté inconsciente (pour s'amuser), fait souffrir le poète, parce qu’elle ne le comprend pas. L’auteur ne se laisse pas détourner de l’essentiel par le souci du pittoresque : on serait pourtant curieux de savoir comment les matelots prennent les albatros. L’apposition « vastes oiseaux des mers », médiocrement documentaire, complète certes le tableau, mais doit surtout annoncer le drame : en face de l’individu le plus misérable, l’envergure de Voiseau qui lui permet de braver l’immensité des mers ; en face de ce qui marche, ce qui vole et s’éloigne jusqu’à l’infini. Or l’homme ne veut pas accepter ce qui est grand ou ce qui s’élève : il s’en moque et cherche à le détruire! Le. rythme du vers 3 (2 + muette ^3+3+3) détache pourtant une première image : celle de l’oiseau « suivant » le navire dans un mouvement balancé, calme et régulier, évoqué avec noblesse par la périphrase du vers 4. L’ensemble crée une impression d’aisance souveraine. Cette image a aussi une valeur morale : le poète et la foule sont unis dans le douloureux voyage de la vie, mais la foule ne voit ni la Beauté, ni le danger qui lui est lié. Le génie est du reste trop indolent (le mot est souligné par les sonorités et par la césure), trop rêveur, pour se mêler à la vie active. Le poète avait d’abord écrit : « curieux compagnons... »; ce qui était sans doute bien observé; le choix de l’adjectif indolents nous éclaire sur la valeur symbolique du v. 3. v. 5-8. — Après la capture, on ne voit plus les marins, mais 41 l’oiseau. Par une ample périphrase, le captif est montré dans sa grandeur, physique et morale : il est le roi de l'azur, qui « se meut avec agilité » dans les régions supérieures (cf. Elévation). Mais il est aussi XIX Strophe IV. La leçon vient après l’anecdote, qu’elle complète et dont elle se détache. L’albatros ne se distingue du poète qu’au vers 13 : de la comparaison implicite, on passe à la métaphore. Mais cet oiseau n’est plus tout à fait « l’indolent compagnon de voyage », et l’on pense à l’aigle plutôt qu’à l’albatros, la noblesse du mot archer conduisant elle aussi à détacher la leçon de l’anecdote (v. 14). Il est celui qui, comme René, vit habituellement dans les tempêtes et qui brave les dangers qu’il connaît ; les grandes aventures intellectuelles comportent aussi leurs risques : on songe à Baudelaire, à Rimbaud, à Mallarmé. Il est aussi l’exilé, et l’anacoluthe (il faut entendre : lorsqu’il est exilé) provoque un rapprochement de grand effet. On ne se borne plus à le railler, on l’insulte, parce qu’il n’est pas comme les autres. Le dernier vers, très beau, rassemble les deux images dans une dernière interprétation : le poète, prisonnier des contingences matérielles, est incapable de " marcher, cette chose si simple aux yeux des hommes du commun, mais c’est parce qu’il a des ailes de géant ; et cette considération qui rétablit la perspective dans sa vérité, lui rend, sa grandeur et sa dignité. Conclusion. Thibaudet voit dans L'Albatros une ébauche de Bénédiction, « ce Chatterton à la troisième puissance ». Historiquement, c’est probablement inexact, mais il est vrai qu’on assiste bien ici à une des scènes de la Comédie poétique, de la Divine comédie que donne la première partie des Fleurs du Mal, ouverte par Bénédiction, et souvent inspirée par Vigny. Elle n’est pas, à beaucoup près, la plus originale, et M. Ruff a sans doute raison d’en trouver le début « médiocre » Elle nous permet, sinon de pénétrer dans l’univers baudelairien, du moins d’en ouvrir une des portes. L’exécution n’est pas sans mérites. Si l’inspiration et la forme sont traditionnelles, si la description a surtout une valeur morale, le rythme traduit fort heureusement les mouvements, et le finale atteint à la grandeur. Mais c’est le symbolisme de l’œuvre qu’on doit surtout faire valoir. Son écriture, surtout l’usage des épithètes et des périphrases, vise à dégager immédiatement le sens du thème. Une comparaison avec Le Pin des Landes de Th. Gautier (XIXe Siècle, p. 265) permettra de bien saisir ce qu’un tel système apporte à la poésie. Le poète et la foule. Baudelaire, Bénédiction (Fleurs du Mal, I). Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, Le Poète apparaît en ce monde ennuyé, Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié. [...] Tous ceux qu’il veut aimer l’observent avec crainte, Ou bien, s’enhardissant de sa tranquillité, Cherchent à qui saura lui tirer une plainte, Et font sur lui l’essai de leur férocité. Dans le pain et le vin destinés à sa bouche 42 Ils mêlent de la cendre avec d’impurs crachats; Avec hypocrisie ils jettent ce qu’il touche, Et s’accusent d’avoir mis leurs pieds dans ses pas. [...] Vers le ciel, où son œil voit un trône splendide, Le Poète serein lève ses bras pieux, Et les vastes éclairs de son esprit lucide Lui dérobent l’aspect des peuples furieux : — « Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance Comme un divin remède à nos impuretés Et comme la meilleure et la plus pure essence Qui prépare les forts aux saintes voluptés! [...] Baudelaire, Mon cœur mis à nu (XXXII). « C’est par le loisir que j’ai, en partie, grandi. A mon grand détriment; car le loisir, sans fortune, augmente les dettes, les avanies résultant des dettes. Mais à mon grand profit, relativement à la sensibilité, à la méditation, et à la faculté du dandysme et du dilettantisme. Les autres hommes de lettres sont, pour la plupart, de vils piocheurs très ignorants. » Baudelaire, Lettre du 5 juin 1863. « Ce livre tant rêvé (Mon cœur mis à nu) sera un libre de rancunes [...]; je veux faire sentir sans cesse que je me sens étranger au monde et à ses cultes. Je tournerai contre la France entière mon réel talent d’impertinence. J’ai un besoin de vengeance comme un homme fatigué a besoin d’un bain. » Flaubert, Correspondance. Baudelaire a envoyé un « placard » de L’Albatros à certains de ses amis, à Gustave Flaubert notamment, qui l’a remercié de ce « diamant » mais Va classé dans les dossiers de Bouvard et Pécuchet. On s'en est étonné, à tort, selon nous: ce roman est une autobiographie caricaturale, et, sur le fond du problème, la position de Flaubert est comparable à celle de Baudelaire. « L’artiste, selon moi, est une monstruosité, quelque chose hors nature. Tous les malheurs dont la Providence’l’accable lui viennent de l’entêtement qu’il qu’il a à nier cet axiome. » (15 décembre 1850). « L’humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-nous donc en l'Art comme les mystiques s’aiment en Dieu et que tout pâlisse devant cet amour. Que toutes les autres chandelles de la vie (qui toutes puent) disparaissent devant ce grand soleil. » (14. août 1853). Hymne à la beauté 1 Page 435 Immédiatement avant le cycle de l’amour, il y une série esthétique. On ne doit sans doute pas y a, dans Les Fleurs du Mal, un groupe de cinq poèmes chercher l’exposé d’une doctrine, mais plutôt les (17-21 dans l’édition de 1861) qui paraissent former résultats, contradictoires parfois, d’une quête diffi- 43 xix - 238 cile dans le monde de l’inexprimable. Notre XIXe Siècle en donne le début (La Beauté) et la fin (Hymne à la Beauté). 6. La Beauté. Ce sonnet fait parler une statue grecque dont on voit en même temps le modèle (le rêve) et la réalisation (la pierre). En voici les tercets : Les poètes, devant mes grandes attitudes, Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments, Consumeront leurs jours en d’austères études; Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants, De purs miroirs qui font toutes choses plus belles, Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles! On rapprochera ces vers des poèmes où les Parnassiens traitent le même sujet : L’Art (XIXe Siècle, p. 270) et La Vénus de Milo (XIXe Siècle, p. 4 I0)> e t on notera que, par la netteté de la forme comme par la conception d’un art plastique, La Beauté leur ressemble. Mais on observera aussi que Baudelaire met l’accent sur des idées qui lui sont chères : le rêve est inaccessible et le poète souffre en vain pour l’atteindre (v. 2, v. 5, v. 8) ; l’univers des sentiments et celui de la matière sont un (v. ' 3-4) ; le Beau est donc inexprimable et mystérieux (v. 4-5) : « Il a la forme sculpturale d’un rêve qui prendrait corps dans une statue, mais garde le caractère immatériel d’une statue qu’un rêve imaginerait » (André Ferran). On a parfois fait de ce sonnet une œuvre de jeunesse, mais les vues esthétiques de Baudelaire se sont formées très tôt. On doit en tous cas constater qu’en beaucoup d’autres textes, il a pris des positions entièrement différentes. Il a vu dans la sculpture un moyen d’expression « barbare et enfantin », il a admiré la grâce et l’harmonie des mouvements, il a affirmé que la beauté n’était ni sereine (voir p. 435, note 2), ni pure (Hymne à la Beauté, v. 14 et passim). 7. Hymne à la Beauté. Le second poème, écrit après 1857, nous mène plus avant à la recherche des origines et du sens de l’émotion esthétique. Notre édition en donne les vers 1-16 et 21-28. Dans Le Masque (F. du M., 20), Baudelaire a contemplé la beauté d’une nouvelle statue, moderne celle-là : c’est celle d’une femme à qui un masque donne un visage souriant, image et promesse du bonheur. Sous le masque, « décor suborneur », la tête véritable se crispe et pleure : Elle pleure, insensé, parce qu’elle a vécu ! Et parce qu’elle vit ! Mais ce qu’elle déplore Surtout, ce qui la fait frémir jusqu’aux genoux, C’est que demain, hélas ! il faudra vivre encore, Demain, après-demain et toujours ! — comme nous ! Il lui reste à s’interroger sur l’origine du Beau : c’est ce qu’il fait dans Y Hymne à la Beauté (F. du M., 21). Deux fois (v. 1, v. g), le poète s’interroge sur la provenance du Beau, en des termes comparables. Mais sa présence (v. 2-8, v. 10-16), est de moins en moins équivoque, et plus satanique assurément que divine. 44 C’est aux images et aux allégories qu’il demande d’exprimer plus clairement ce que sont les relations entre l’artiste et sa « reine ». Elle est par exemple un soir orageux et parfumé (v. 6), parfumé parce qu’il est orageux : de même que la beauté ne se sépare pas du malheur, le plaisir ne se sépare pas de la douleur, et le plaisir, c’est d’abord un parfum (voir XIXe siècle, p. 431. p‘ 437, p. 439, etc., suivi de ses « correspondances »). Elle est (v. 10) la maîtresse du Destin (c’est-à-dire de l’univers que le destin gouverne), mais elle conduit sensuellement un monde privé de volonté, semblable à une bête ignoble, etc... La ressemblance de la beauté avec la femme est constante : elle est un œil (v. 2, v. 5) et un baiser (v. 7), une courtisane (v. 9-12) et une danseuse (v. 13-16). L’assimilation est, en elle-même, banale, mais le sens qu’elle donne au mot amour ne l’est pas : sensuel (le poème est d’une sensualité très précise : voir v. 6-7, v. 15-16, et la strophe écartée), ou esthétique, cet amour ignore l’idéalisation habituelle. Il peut conduire au bien (v. 3) ou au courage (v. 8), mais il s’identifie de plus en plus au mal et au crime (v. 3, v. 8, v. 11, v. 15...); il n’est pas un progrès vers la perfection, mais un mouvement désordonné (v. 11-12) vers la perdition (str. 4) et vers la mort. Cette idée est sensible dans la strophe écartée après le v. 16 : L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, Crépite, flambe, et dit : Bénissons ce flambeau ! L’amoureux pantelant incliné sur sa belle A l’air d’un moribond caressant son tombeau. Deux fois (v. 17, v. 21), le poète renonce à chercher une réponse. Faut-il comprendre qu’elle est impossible? N’est-ce pas plutôt qu’un même élan porte vers le ciel et vers l’enfer, né des « deux postulations simultanées » (voir XIXe Siècle, p. 430) ? L’art qui rend la vie tolérable (v. 24) reste bien un « divin opium » (voir Les Phares, v. 32). Mais l’infini auquel il devrait mener est devenu inaccessible (v.20) ! Dans les derniers vers (v. 18-22), l’image de la femme-beauté, Ange ou Sirène se reflète dans un jeu de miroirs où la monstruosité sourit à la gentillesse (v. 18) et où l’effroi conduit le désir (v. 18-19). L’appel à l’amour et à l’art est devenu un appel à la mort, comparable à celui qui termine Le Voyage (voir XIXe Siècle, p. 453, v. 33-37). Balzac avait déjà écrit dans Louis Lambert: « Il y aurait en nous deux créatures distinctes. Selon Swedenborg, l’ange serait l’individu chez lequel l’être intérieur réussit à triompher de l’être extérieur [...]. Quand leur séparation arrive sous cette forme que nous appelons la Mort, l’ange, assez puissant pour se dégager de son enveloppe, demeure et commence sa vraie vie. » Qu’est-ce donc que la « vie » pour Baudelaire? xix - 239 Conclusion. L’image du beau, presque immobile de la Renaissance au Romantisme, se déplace et se brise maintenant. L’influence du romantisme frénétique est sensible dans ce poème (str. 4, par exemple) : cette forme du romantisme n’a pas été une excentricité, mais le prélude aux grands mouvements de la fin du siècle. La Beauté n’est plus une douce figure de jeune fille, souriant ou versant des larmes « pour s’embellir », elle est « bizarre », dissonante, et, on l’aurait du moins dit naguère, laide au physique 45 comme au moral. On n’attend plus d’elle de tendres émotions de sympathie, mais un choc qui provoque « une douleur délicieuse ». Elle ne ressemble plus au rêve ou à l’idéal, elle les crée à son gré. L’art contemporain aborde au nouveau monde ! « Mon Beau... » Baudelaire s’est souvent interrogé sur la nature du Beau. Voici les plus célèbres de ses réponses : « Le Beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire qu’il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu’il contient toujours un peu de bizarrerie, de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c’est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le Beau. C’est son immatriculation, sa caractéristique. Renversez la proposition et tâchez de concevoir un beau banal! [...] Cette dose de bizarrerie [...] joue dans l’art (que l’exactitude de cette proposition en fasse pardonner la trivialité) le rôle du goût ou de l’assaisonnement dans les mets, les mets ne différant les uns des autres, abstraction faite de leur utilité ou de la quantité de substance nutritive qu’ils contiennent, que par l’idée qu’ils révèlent à la langue. » (Exposition universelle, 1855.) « Parce que le Beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. Or notre public, qui est singulièrement impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l’admiration (signe des petites âmes), veut être étonné par des moyens étrangers à l’art, et ses artistes obéissants se conforment à son goût; ils veulent le frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, parce qu’ils le savent incapable de s’extasier devant la tactique naturelle de l’art véritable. » (Salon de 1859). « Le Beau est toujours, inévitablement, d’une composition double, bien que l’impression qu’il produit soit une; car la difficulté de discerner les éléments variables du Beau dans l’unité de l’impression n’infirme en rien la nécessité de la variété dans sa composition. Le Beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. » (Le Peintre de la Vie moderne, 1863.) « J’ai trouvé la définition du Beau, de mon Beau. C’est quelque chose d’ardent et de triste, quelque chose d’un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Je vais, si l’on veut, appliquer mes idées à un objet sensible, à l’objet, çar exemple le plus intéressant dans la société, à un visage de femme. Une tête séduisante et belle, une tête de femme veux-je dire, c’est une tête qui fait rêver à la fois, — mais d’une manière confuse, — de volupté et de tristesse; qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété, — soit une idée contraire, c’est-à- dire une ardeur, un désir de vivre, associé avec une amertume refluante, comme venant de privation ou de désespérance. Le mystère, le regret sont aussi des caractères du Beau [...]. « Je ne prétends pas que la Joie ne puisse pas s’associer avec la Beauté, mais je dis que la Joie en est un des ornements les plus vulgaires; — tandis que la Mélancolie en est pour ainsi dire l’illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé?) un type de 46 Beauté où il n’y ait du Malheur. Appuyé sur — d’autres diraient : obsédé par — ces idées, on conçoit qu’il me serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de Beauté virile est Satan, — à la manière de Mil ton. » (Fusées.) Ambivalence de la Beauté. M.-A. Ruff, Baudelaire (Hatier). « Hymne à la Beauté [...] lie l’esthétique, non plus à l’éthique humaine, mais à la destinée surnaturelle de l’homme. La Beauté n’est pas faite seulement de la souffrance, mais du Mal proprement dit : Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques; De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant, Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques, Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. Le problème est donc troublant, s’il s’agit de déterminer l’origine, divine ou satanique, de la Beauté. Sur le fond de la pensée baudelairienne, il y a peu de doute. Nous avons vu qu’il ne conçoit pas l’art sans une “ aspiration vers l’infini ” : “ C’est cet admirable, cet immortel instinct du beau qüi nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel. ” Mais, quand il a cherché “ la définition du Beau, — de son Beau ”, il est arrivé à cette constatation “ que la mélancolie en est pour ainsi dire l’illustre compagne, à ce point que je rie conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé?) un type de Beauté où il n’y ait du Malheur ”, si bien qu’il lui ’“ serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de beauté virile est Satan, — à la manière de Milton. ” On voit donc que l’ambivalence de la Beauté n’est pas pour lui un simple thème poétique. De même que la postulation humaine est double, de même l’art tire ses ressources de Satan aussi bien que de Dieu. C’est là une position esthétique très nouvelle. Jusque-là les deux doctrines de l’artiste se ramènent à l’un de ces deux postulats : l’art est xix - 240 îoral — ou bien étranger à toute notion morale. )n attribue à Crébillon le Tragique une boutade *lon laquelle le Ciel ayant été pris par Corneille t la Terre par Racine, il ne lui restait que PEnfer, rgument analogue à celui que Sainte-Beuve avait >ufflé à Baudelaire au moment de son procès. Mais ; point de vue ressemble encore à celui du peintre la recherche du “ motif ” et prenant celui qu’il ouve disponible, sans préoccupation morale. Pour audelaire, c’est la nature même de la Beauté qui >t en cause. Sa théorie se rattache plutôt à celle u marquis de Sade, selon qui le Mal est le moteur : plus puissant du plaisir. Du plaisir à l’émotion sthétique, le pas n’est pas grand, surtout si, comme audelaire, on adopte la définition de Stendhal : Le Beau n’est que la promesse du bonheur. ” Il a là u«e notion complexe. Baudelaire ne fait pas e l’artiste un “ suppôt de Satan ”, ni de la Beauté I I un produit exclusif de l’Enflr. Mais sur ce sujet pas plus que sur les autres il nfe se pèrmet d’illusions. La nature de l’homme étant ce qu’elle est, l’art, comme toute autre activité' humaine se nourrit nécessairement du Mal tout autapt que du Bien et même davantage peut-être. Sur l’origine de la Beauté, Baudelaire ne donne pas' de réponse à sa question. Il l’accepte telle qu’elle est mais les deux 47 dernières strophes et leur “ qu’importe ” n’expriment pas l’indifférence de l’auteur dans le choix du Ciel ou de l’Enfer. Si le pouvoir de la Beauté reste bienfaisant, et lui ouvrira la porte D’un infini que j’aime et n’ai jamais connu, il importe peu en effet que Satan ait une part à sa naissance. Cependant le poème a le grand intérêt de reconnaître cette part sans hypocrisie et de jeter une lumière franche sur un sujet qu’on a souvent laissé dans une ombre équivoque. » (p. 106-107). La Vie antérieure Cette évocation pourrait n’être qu’une molle :verie, un songe banal, l’envie de régner en maître ir une peuplade orientale ; mais le sentiment « sur- ituraliste » que la vérité est dans le monde des ées, non dans la réalité perçue, et que l’âme y teint à la faveur de l’ivresse mieux que l’esprit ir le raisonnement, lui donne une force déchirante, ’est une ivresse qui a pu naître dans un paradis ■tificiel ou, comme on le dit parfois, de l’audition ; Lohengrin. Ce qui est désiré existe réellement et •ésentement ainsi que ce qui est regretté : rêves souvenirs du voyages aux îles, de Jeanne Du val..., présentent comme l’actualisation d’un passé qui 5 explique. La Vie antérieure est celle du souvenir d’un au-delà du souvenir, comme les rêves qui (chantaient Nerval, le « pythagoricien » moderne, mé et admiré de Baudelaire. uatrains I et II. Les premières images sont celles d’un coucher de leil au bord de la mer. Elles forment deux tableaux : m, dans le goût classique de Claude Gelée . 1-4), l’autre (v. 5-8) d’un mouvement romantique. ; premier est inspiré des « ports de mer au soleil uchant » (voir, au Louvre, Ulysse remet Chryséïs a 1 père, cf. XVIIe Siècle, pl. 48), si caractéristiques : la manière du Lorrain : une architecture de songe, itie de colonnades et de portiques immenses, dont > lignes, hormis les verticales classiques (v. 3), ient vers l’horizon (v. 1). Tout ici est vaste, luxu- mt, majestueux. Le soleil éblouit la toile (v. 2) et fait un poème de la lumière, de la pierre et de :au. Ce n’est pas un lieu où l’homme ordinaire ibite, mais une fiction pure où se retrouve l’idéal thétique (comparer au Rêve parisien, F. du M., 103) Page 436 | d’un artiste qui déteste ce qui est et se dirige vers une réalité nouvelle, intuitivement rejointe, plus vraie que l’autre. On glisse ainsi du classicisme vers le surréalisme, de Claude Gelée vers Chirico, dont les paysabes urbains, déserts, font naître eux aussi un sentiment d’attente, l’angoisse de l’irrémédiable qui va se produire. Puis, le soir (v. 4), le port est envahi par l’ombre : thème cher à Baudelaire (voir Le Crépuscule du Soir des Poèmes en prose). Le rythme rend sensible le mystère de ce basalte noir et sonore (on notera le progrès des sonorités dans les vers 3 et 4), qui paraît avoir été le matériau des dieux et des géants bâtisseurs des grottes prophétiques. La marine romantique (v. 5-8) est d’une peinture moins précise, moins pittoresque. C’est un poèmemiroir du ciel dans la mer (v. 5) et du soleil dans les yeux (v. 8). Dans cette composition « en abîme » on voit se multiplier les formes et les couleurs qui font et défont des images, riches (v. 7) et étranges, mêlées (v. 6) à la musique des vagues. On peut dire qu’alors les correspondances sont plus 48 immédiates qu’ailleurs et font toucher le mystère de l’unité (v. 6), mystère divin, origine et fin du rêve. Tercets I et II. Le mouvement narratif esquissé au premier vers reprend plus fermement : on appréciera le tour C’est là que j’ai vécu en le comparant à celui qu’utilise Nerval à la fin de Fantaisie pour dire que, peut-être, il a déjà vu la dame aux yeux noirs. Il engendre un autre tableau, chaque image existant pour ellemême, mais toutes servant à montrer le poète; c’est un tableau assez comparable à un Gauguin, à ceux du moins de la dernière période, au charme noble xix - 241 plutôt que barbare, à la composition presque classique, mais dans une harmonie plus interprétative que descriptive. On étudiera le rythme et la mélodie du vers 10, dont la rédaction primitive était : Au milieu de l’azur, des flots et des splendeurs. Calme (v. g) et régulier, le mouvement berceur est indiqué par les vagues et par les palmes. Une nouvelle volupté y est suggérée, celle du parfum poivré d’une peau noire, qui s’ajoute à celles des couleurs et des sons : elle est la plus forte de toutes, et il est possible qu’elle ait donné naissance au poème (voir plus loin Parfum exotique). Le thème de la puissance royale, apparu dans la première strophe devient celui d’un despotisme oriental qui s’exerce sans contrainte (v. 9), par les sens (v. 1 1 ) , et qui aboutit à une sorte d’anéantissement, la langueur (v. 14). Les derniers vers (v. 13-14) en proposent d’abord une explication romantique : la nostalgie d’un bonheur dont celui de la terre n’est qu’une pauvre illusion. Mais le poète s’est gardé de lever le voile : qu’est-ce donc que cette douleur secrète que la volupté approfondit, c’est-à-dire enfonce plus profondément? Selon André Ferran, « même au milieu de ces voluptés, le Poète garde sa douleur — et son secret c’est peut-être de se sentir même là l’exilé d’une autre vie antérieure dont il éprouve une obscure nostalgie »; Peut-être même ce « roi sans divertissement », comme dirait Pascal, est-il d’autant plus sensible au mal de l’infini qui avive cette nostalgie. Conclusion. Ce poème a été publié dans la Revue des Deux- Mondes du I er juin 1855. A cette époque, la métempsychose était à la mode. On affirmait volontiers, comme les pythagoriciens, que tout être recommence, à périodes déterminées, son existence antérieure et que, les âmes passant de l’un à l’autre, tous les êtres animés sont congénères. Gérard de Nerval (mort en janvier 1855) l’avait cru. Victor Hugo, dans Ce que dit la Bouche d'ombre (daté de 1855) le répétait à sa façon. Mais La Vie antérieure est autre chose que l’illustration d’une philosophie ancienne; elle est la vie de la poésie, celle du rêve dont les éléments sont fournis par toutes les expériences de l’homme, conscientes et inconscientes, antérieures même peut-être à la naissance, antérieures en tous cas à toute reconstruction logique. L’unité mystique fondamentale y est retrouvée, mère des correspondances, c’est-à-dire de l’art. 49 Ambiguïté et poésie. J.-D. Hubert, L’Esthétique des Fleurs du Alal (Genève, P. Cailler). « Quand on considère les différentes fonctions de l’ambiguïté, on constate qu’elle tend d’une part à enrichir le poème en lui donnant une polyphonie de significations, et d’autre part à nier le caractère trop réel ou immédiat de certains sentiments ou événements, c’est-à-dire à introduire dans le poème un instant de réflexion ou d’arrêt. Grâce surtout à l’ambiguïté (dans le sëns le plus étendu qu’on puisse donner à ce terme), il apparaît que la poésie est au sentiment ce que l’être des métaphysiciens est à la réalité : quoiqu’elle doive se fonder dans l’immédiat, il faut absolument qu’elle s’en détache jusqu’à un certain point pour qu’il y ait création artistique et non pas seulement reportage ou confession lyrique, car il y a autant de différence entre un sentiment immédiat et la poésie qu’entre un fait divers et une tragédie. [...] Le titre de La Vie antérieure lui-même contient une ambiguïté — s’agit-il d’une existence antérieure, d’une karma à la manière hindoue, ou, plus simplement, du souvenir? Ce doute persiste à travers tout le sonnet et lui communique une atmosphère mystérieuse et presque sacrée. L’ambiguïté entre le souvenir et cette incarnation antérieure impose automatiquement l’ordre poétique. [...] Les vastes portiques évoquent quelque palais royal grâce à leurs “ piliers droits et majestueux ”, mais suggèrent néanmoins l’imminence d’une découverte, comme si ces piliers marquaient l’entrée d’un univers inconnu. Les grottes basaltiques ne renferment pas moins de mystère que les portiques, car, comme l’indique l’éty- mologie (crypte) du mot grotte, elles peuvent recéler des secrets et des souvenirs. La grotte est le symbole parfait de l’intuition romantique. L’atmosphère reste tout aussi mystérieuse au cours du second quatrain où nous avons l’impression d’assister à quelque rite liturgique : il y a une correspondance, ou plutôt une synesthésie verbale dans l’accord entre le bruit de la houle et la réflexion du ciel. Les images des deux sont à la fois des nuages reflétés et les symboles de la création divine. Les tout- puissants accords suggèrent la rumeur immense de la mer tout en évoquant l’idée de son créateur, le Tout- Puissant. Et cette musique ne semble riche qu’à cause de la synesthésie. L’atmosphère se fait plus intime dans les tercets [...]. Le verbe approfondir est ambigu au possible : il peut signifier que le poète avait envie d’augmenter la douleur qui le faisait languir, pousser son secret encore plus loin dans le passé — jusqu’au péché originel! — ou, enfin, l’examiner à fond afin de le comprendre. Ce secret douloureux marque un retour au présent, au secret qui fait souffrir le poète maintenant, ou qui existe depuis toujours dans la nature humaine. Nous pouvons considérer ce sonnet comme la transposition dans un univers apparemment mystique d’un sentiment présent se rapportant peut- être à quelque souvenir douloureux. L’expression approfondir, métaphore spatiale, évoque une dernière fois la mer et ses abîmes ainsi que l’intérieur mystérieux des grottes basaltiques : son sens métaphorique se rapporte aux souvenirs, dépôt unique des secrets. Il se pourrait que ce secret, existant, semble-t-il, en dehors du temps, correspondît à la création poétique. Le thème caché de ce 50 sonnet serait alors la persistance et l’identité fondamentale de la création poétique à travers tous ses avatars. » (p. 149-157). xix - 242 « Le secret douloureux... » J.-B. Barrère, En marge d’un Baudelaire de poche (RHLF, avril 1967). « Le sens du verbe approfondir, qui paraît aller de soi, n’est pas sans ambiguïté. Il peut être plus abstrait ou plus concret : élucider pour résoudre, et donc guérir, ou rendre plus profond, c’est-à-dire incurable. L’unique soin de ces esclaves devrait être le premier, s’ils en sont capables, mais j’ai toujours compris qu’il avait le second pour effet, à la manière dont pour calmer une souffrance on l’excite, fait saigner un prurit, creuse une plaie, où l’on rejoint l’aveu des vers à Sainte-Beuve : L’art cruel qu’un démon, en naissant, m’a donné, — De la douleur pour faire une volupté vraie — IJ’ensanglanter son mal et de gratter sa plaie. Une “ volupté vraie ”, ce n’est pas nécessairement les “ voluptés calmes ”. Mais de la caresse à l’incision, la transition se fait par l’égratignure, le griffe- ment, jusqu’au coup de couteau : “ la guérison au bout d’une lame ” (Mlle Bistouri). Le cadre est déjà le “ bercement des houles ” et les “ lourds loisirs d’un jour caniculaire ” [■••]• L’ambiguïté, sans doute voulue, vient du reflet du sens concret sur l’abstrait, et vice versa, c’est-à-dire de la plus ou moins grande distance métaphorique. L’expression secret douloureux se retrouve à propos des femmes de Delacroix, mais il affleure au lieu d’être déjà à une certaine profondeur : “ On dirait qu’elles portent dans les yeux un secret douloureux, impossible à enfouir dans les profondeurs de la dissimulation : [...] ces femmes [...] ont [...] dans le le regard l’intensité du surnaturalisme Ces derniers mots donnent peut-être la clef : comblée de beauté et de satisfaction terrestre, l’âme du poète regrette au-delà de cette vie antérieure une autre vie, plus-queparfaite ou pré-antérieure dont la vie antérieure, malgré sa splendeur, n’est qu’un pâle reflet. Les attentions des esclaves, en le libérant de toute activité, accentuent son oisiveté et le rendent à lui seul. C’est l’ennui, si l’on veut, car l’ennui est le manque de finalité (purpose). Ainsi donnent-ils plus de profondeur au mal qui est une nostalgie. » Parfum exotique Page 437 De Jeanne Duval, la principale inspiratrice des Fleurs du Mal, qui a tenu tant de place dans une vie et dans une œuvre, nous ne savons à peu près rien: ni son origine, ni son âge exact, ni'même son nom véritable. Elle rencontre Baudelaire en 1842. En 1866, Mme Aupick s’indigne qu’elle poursuive encore un grand malade de ses demandes de secours! Mais le poète, de son côté, n’a jamais pu se détacher de « (sa) seule distraction, (son) seul plaisir, (son) seul camarade ». Il la quitte en 1852, la reprend en 1854. En 1856, c’est elle qui veut rompre. Il est furieux et désespéré, mais elle ne tarde pas à lui revenir. En 1860, il l’installe à Neuilly, mais il doit s’enfuir devant une conduite « monstrueuse ». Elle n’est plus, depuis longtemps, qu’une « vieille beauté transformée en infirme ». 51 Elle a toujours été sournoise et débauchée, menteuse et dépensière. A-t-elle été belle dans sa jeunesse ? Ses amis ne s’accordent pas sur ce point, et les portraits se contredisent : les dessins de Baudelaire sont faits de mémoire, et très différents les uns des autres; le tableau de Manet conservé au musée de Budapest représente une Jeanne vieillie, d’une laideur effrayante. C’était une métisse au teint cuivré, avec de grands yeux bruns, de fortes lèvres, quelque chose de divin et de bestial dans l’allure (au témoignage de Banville) et surtout de beaux cheveux d’un noir bleu, largement ondulés. Quoi qu’il en soit de tares et de fautes trop réelles, on ne peut oublier d’abord que Baudelaire luimême n’est pas à l’abri des reproches pour la vie qu’il a fait mener à une femme incapable de le comprendre et pour sa responsabilité probable dans l’état de santé de sa compagne, d’autre part qu’il a vécu vingt ans « avec et pour » elle, et qu’il lui doit, que nous lui devons, de merveilleux poèmes d’amour, dont Parfum exotique est le premier. C’est un des quatre sonnets régulier^ des Fleurs du Mal. Quatrains I et II. v. 1-2. —Le mouvement musical s’installe progressivement dans un premier vers prosaïque de rythme et de sonorités, et dans un second vers harmonieux. Le tableau qu’ils offrent est banal. On en distinguera les éléments : le soir, Vautomne, les yeux fermés, c’est l’heure, la saison, l’attitude de la rêverie; la chaleur (notation essentielle des vers 1 et 2) qui appellera le souvenir vers les pays du soleil (v. 3-4) ; Vodeur de la femme qui imposera finalement (v. 9-14) sa présence et ses suggestions. v. 3-8. — Une image se forme (v. 3-4), imprécise : elle est celle de rivages (le sens classique de « contrées » et le pluriel en font un terme vague) qu’un soleil éblouissant efface ou uniformise. L’impression naît d’un terme abstrait : heureux, et surtout d’un rythme noble et de belles sonorités (rimes riches, voyelles claires se détachant sur des graves et se faisant écho). Puis les contours se dessinent : c’est une île, singulière (v. 6), propice à la paresse (v. 5). Elle offre les prexix - 243 miers caractères de la beauté (voir plus haut). Les habitants y mènent une existence primitive, celle que Rousseau ou Bernardin de Saint-Pierre ont imaginée, mais on n’oubliera pas que, pour Baudelaire, la Nature « a quelque chose d’affligeant, de dur, de cruel ». Resté naturel et vivant de la nature (v. 5), l’homme ne souffre pas des conséquences du péché, ni dans son corps (v. 7) qui n’est pas déformé par le travail (v. 5) ni dans son âme (v. 8) demeurée simple, même l’âme féminine qui, chose incroyable (étonne) a gardé la franchise de la nature. Tercets I et II. Une seconde série d’images, plus précises et pourtant plus larges, plus spécifiquement baudelairiennes, est appelée par l’émotion principale dont l’origine est enfin identifiée (v. g). Elle reste un moment arrêtée (.climats a le sens classique de contrées, et rien n’indique encore la valeur magique du charme), puis le rythme du vers 10, qui ressemble fort à un trimètre, souligne la surprise de la découverte. 52 Le thème du port, cher à l’auteur, est illustré avec précision : voiles, mâts, chants, brise de terre — mais sans réalisme véritable, ni dans le dessin, ni dans le vocabulaire, qui reste noble : vague marine, marine, mariniers... Le bonheur est fait d’éléments moins naturels et très divers : la paix du soir enfin venu après les fatigues de la journée (v. 11), la plénitude d’une vie de labeur, les analogies qui ravissent les sens et l’esprit, celles des parfums (v. 9, v. 12), des couleurs (v. 12), des sons (v. 14) qui « se répondent ». Mais des suggestions plus subtiles élargissent l’ouverture vers l’idéal et effacent ce que le tableau aurait encore de trop précis : celles qui naissent de la vision des ports et des îles, celles de la musique dont les échos deviennent obsédants, en particulier dans les rimes, et dont le mouvement se renforce au dernier tercet. Conclusion. A la présence de la femme s’associe le souvenir, dans sa forme baudelairienne, faite du plaisir de l’insatisfaction et de l’absence autant que du désir de la possession. Les yeux fermés, le poète retrouve les paradis de ses rêves et de son voyage, grâce à celle qui ne peut être une compagne au plein sens du terme, mais qui est plus qu’un objet ou qu’un moyen : l’océan qui berce l’âme, l’Océan qui relie la terre au ciel. On retrouvera ce thème, amplement développé dans La Chevelure et dans le poème en prose intitulé Un hémisphère dans une chevelure (cf. Document complémentaire). Du vers à la prose. Baudelaire, Petits poèmes en prose, 17. Un hémisphère dans une chevelure « Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l’eau d’une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l’air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois ! tout ce que je sens! tout ce que j’entends dans tes cheveux! Mon âme voyage sur le parfum comme l’âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures, ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l’espace est plus bleu et plus profond, où l’atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l’océan de ta chevelure, j’entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d’hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l’éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d’un beau navire, bercées par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l’ardent foyer de ta chevelure, je respire l’odeur du tabac mêlé à l’opium et au sucre; dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l’infini de l’azur tropical; sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m’enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l’huile de coco. 53 Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordille tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. » Un « monde d’harmonies nouvelles ». Baudelaire, Exposition Universelle, 1855. « Si, au lieu d’un pédagogue, je prends un homme du monde, un intelligent, et si je le transporte dans une contrée lointaine, je suis sûr que, si les étonnements du débarquement sont grands, si l’accoutumance est plus ou moins longue, plus ou moins laborieuse, la sympathie sera tôt ou tard si vive, si pénétrante, qu’elle créera en lui un monde nouveau d’idées, monde qui fera partie intégrante de luimême, et qui l’accompagnera, sous la forme de souvenirs, jusqu’à la mort. Ces formes de bâtiments, qui contrariaient d’abord son œil académique(tout peuple est académique en jugeant les autres, tout peuple est barbare quand il est jugé), ces végétaux inquiétants pour sa mémoire chargée des souvenirs natals, ces femmes et ces hommes dont les muscles ne vibrent pas suivant l’allure classique de son pays, dont la démarche n’est pas cadencée selon le rythme xix - 244 accoutumé, dont le regard n’est pas projeté avec le même magnétisme, ces odeurs qui ne sont plus celles du boudoir maternel, ces fleurs mystérieuses dont la couleur profonde entre dans l’oeil despotiquement, pendant que leur forme taquine le regard, ces fruits dont le goût trompe et déplace les sens, et révèle au palais des idées qui appartiennent à l’odorat, tout ce monde d’harmonies nouvelles entrera lentement en lui; le pénétrera patiemment, comme la vapeur d’une étuve aromatisée; toute cette vitalité inconnue sera ajoutée à sa vitalité propre; quelques milliers d’idées et de sensations enrichiront son dictionnaire de mortel, et même il est possible que, dépassant la mesure et transformant la justice en révolte, il fasse comme le Sicambre converti, qu’il brûle ce qu’il avait adoré, et qu’il adore ce qu’il avait brûlé. » L’odorat : le plus « animal » de nos sens... F. Brunetière, Nouveaux Essais sur la Littérature contemporaine (Calmann-Lévy). « Baudelaire a certainement “ ajouté des forces à la poésie française ”; il en a, selon son expression, “ agrandi le répertoire ”; et, par exemple, s’il n’a pas inventé la poésie des odeurs, il a su du moins lui donner une place et une importance toute nouvelle, 8. une importance légitime et une place durable, — dans l’art encore alors tout musical, plastique, ou pittoresque des Lamartine, des Hugo, des Gautier : En ouvrant un coffret venu de l’Orient, Dont la serrure grince, et rechigne en criant... [...] Si la forme, si la facture de ces vers n’a rien de très original, ou si peut-être encore cette poésie de la sensation n’était pas absolument nouvelle aux environs de 1858, cependant on ne l’avait pas demandée jusqu’alors au plus suggestif peut-être, mais le plus “ animal ” aussi de tous nos sens : j’en - tends le seul dont les plaisirs n’aient jamais en soi rien d’intellectuel, le plus grossier par conséquent; et, pour cette raison peut-être, le seul dont aucun poète, avant Baudelaire, ne se fût avisé de se faire un 54 art, une “ manière ”, ou un procédé, de noter les impressions. Il était d’ailleurs naturel ou plutôt inévitable que la poésie, que le roman même fissent du procédé d’autant plus d’emploi qu’ils se matérialiseraient davantage; et c’est effectivement ce qui est arrivé. Les “ symphonies ” d’odeurs où se complaisait naguère M. Zola, celles qui “ chantent ” quelquefois encore dans les romans de M. Huysmans ou dans les vers de M. Verlaine, tout cela, c’est du “ bau- delairisme ”; et, possible que depuis lors on en ait abusé jusqu’à la ridiculiser, mais ce n’en est pas moins là l’une de ses trouvailles ou de ses “ notes ” originales. Ajoutons que, par cela même qu’il est le moins “ spirituel ” de tous, l’odorat est le sens dont les impressions s’échangent le plus aisément avec celles des autres. Disons mieux encore: il les sollicite ou il les provoque; et tandis que les couleurs ou les formes limitent pour ainsi dire la liberté du rêve [...] les odeurs au contraire l’émancipent, la favorisent, l’exaltent. » (p. 136-138). ... ou le moyen d’appréhender une absence ? J.-P. Richard, Poésie et Prodondeur (Seuil). « Si Baudelaire a tant aimé les parfums, c’est que l’objet se vaporise en eux avec une sorte de perfection. Point ici de dessous, de splendeurs, ni d’inconcevable mariage entre des contraires ennemis : l’objet existe tout entier en chaque parcelle odorante, mais cette présence se saisit comme une absence. Le parfum est un frôlement d’être. Comme l’écrit excellemment Sartre, c’est un “ corps désincarné, vaporisé, resté certes tout entier en lui-même, mais devenu esprit volatil ”, Cette volatilisation, ou, comme dit mieux Baudelaire, cette subtilité, ce pouvoir que le parfum possède d’éparpiller sa substance en une infinité de molécules impalpables, font de lui un messager idéal parce qu’absolument insaisissable. “ Ces parfums ont pour lui ce pouvoir particulier, tout en se donnant sans réserves, d’évoquer un audelà inaccessible. Il sont à la fois les corps et une négation des corps. Il y a en eux quelque chose d’insatisfait qui se fond avec le désir qu’a Baudelaire d’être perpétuellement ailleurs. ” Ils n’existent même sans doute que pour signaler cet ailleurs: ce sont de pures allusions. Au même titre que tiédeurs, murmures ou lumières, mais avec plus de perfection, ils témoignent de la fécondité vaporisante de l’objet. [...] C’est que le rapport du parfum à sa source ressemble fort à celui qui unit un signe à son objet; le parfum renvoie à son origine, non pas comme un contenu qui trahirait l’existence d’un contenant, mais plutôt à la manière dont une musique entendue peut suggérer un sens : “ musique, écrit Baudelaire, série de memoranda qui suggère des idées, mais ne les contient pas ”, Le parfum appartient à ce monde léger des memoranda', il procède lui aussi par suggestion. Sa discrétion énergétique explique sans doute la place privilégiée que lui réserve la rêverie baude- lairienne. » (p. 107-iog). La Vénus noire. P. Flottes, Baudelaire (Perrini. « Moralement, (Jeanne Duval était ignoble. Nous « 55 ne parlons pas de la facilité de ses moeurs [...] mais de sa sécheresse de cœur, de sa méchanceté calculée qui, par éclairs, l’égalait aux coquettes de nos climats. Sans doute, Baudelaire se flattait de ne pas être un tendre; pourtant, si charnelle que fût cette liaison à son origine, des éléments spirituels ne tardèrent pas à y prendre place. L'àme qu’il opprimait lui-même, selon la profonde formule de Veuillot, eut sa furtive revanche sur les appétits du corps; il aima Jeanne Duval avec dévouement. [...] “ La Vénus noire, écrira un jour Mme Aupick, l’a tourmenté de toutes les manières. Oh ! si vous saviez ! Et que d’argent elle lui a dévoré! Dans ses lettres 9. j’en ai une masse — je ne vois jamais un mot d’amour. Si elle l’avait aimé, je lui pardonnerais, je l’aimerais peut-être, mais ce sont d’incessantes demandes d’argent. ” xix - 245 Telle est la femme avec qui il vécut vingt ans, jusqu’à son départ pour la Belgique, jusqu’à sa mort. {...] Et c’est de ce “ vil animal ” que fut “ pétri ” le génie du poète. » (p. m-113). Th. Gautier, Rapport sur le progrès des Lettres, 1868. « Si les artifices de la coquetterie parisienne plaisent au poète raffiné des Fleurs du Mal, il ressent une vraie passion pour la singularité exotique. Dans ses vers dominant les caprices, les infidélités et les dépits, reparaît opiniâtrement une figure étrange, une Vénus coulée en bronze d’Afrique, fauve, mais belle, nigra sed formosa, espèce de Madone noire dont la niche est toujours ornée de soleils en cristal et de bouquets en perle; c’est vers elle qu’il revient après ses voyages dans l’horreur, lui demandant sinon le bonheur, du moins l’assoupissement et l’oubli. Cette sauvage maîtresse, muette et sombre comme un sphinx, avec ses parfums endormeurs et ses caresses de torpille, semble un symbole de la nature ou de la vie primitive à laquelle retournent les aspirations de l’homme las des complications de la vie civilisée dont il ne pourrait se passer peut-être. » (p. 106). J. Crépet, Propos sur Baudelaire (Mercure de France). « Tout à la fin des Œuvres posthumes de 1908 (p. 412), parmi des notes fragmentaires, se rencontrent quelques lignes auxquelles, sans doute en raison de la place qu’elles occupent, on ne semble pas avoir prêté l’intérêt qu’elles méritent. Ce sont les suivantes : “ Le voluptueux, ayant oscillé longtemps, est tiré de la férocité dans la charité. Quel genre de malheur peut opérer sa conversion ? La maladie de son ancienne complice. Lutte entre l’égoïsme, la pitié et le remords. Sa maîtresse (devenue sa fille) lui fait connaître les sentiments de paternité — Remords : qui sait s’il n’est pas l’auteur du mal? ” [...] Ainsi donc — on n’en saurait douter après tant de recoupements — la note des Œuvres posthumes offre un caractère autobiographique, et elle semble bien ne nous restituer rien de moins que l’histoire en raccourci des amours de son auteur avec Jeanne, telle que, mieux placé que personne pour en dégager le sens supérieur, il se la représentait sur le tard de sa vie. 56 Cependant ce raccourci, si bien qu’il s’accorde avec tant de cris et d’adjurations à soi-même que montrent les Journaux intimes: “ Sans la charité, je ne suis qu’une cymbale retentissante! — Ma santé, par charité, par devoir! — Maladies de Jeanne! — Mes humiliations ont été des grâces de Dieu! ”, etc. — correspond-il à l’idée qu’on se fait en général de la liaison qu’il résume? Évidemment non, même dans la moindre mesure. [-] . , Le curieux de la chose, c’est que ces deux interprétations si différentes du rôle que Jeanne joua dans la vie de Baudelaire ne paraissent pas, quand on veut bien y réfléchir, moins vraisemblables l’une que l’autre et même s’expliquent réciproquement : Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. » (p. 143- 147)- Remords bosthume X Page 437 Plus souvent que l’amour, le cycle de Jeanne Duval dit le désespoir et la malédiction de la passion torturée. D’un poème à l’autre, les deux amants qui ne peuvent ni se joindre ni se séparer apparaissent mieux dans leur misère et dans leur effrayante beauté. Remords posthume les montre dans une scène mélodramatique dont l’outrance pourrait choquer, ou faire rire, si l’on n’y reconnaissait la sincérité emphatique et la violence mal contenue de la jeunesse. Composition. Cette femme qui refuse de renoncer aux aventures pour vivre dans une seule maison, cette libertine qui confond les caprices du cœur et l’amour dont elle n’éprouve plus la chaleur, le poète qui l’aime et qui la hait l’imagine d’avance dans le tombeau (v. 1-8 où la poursuivent des reproches (v. g-13) qu’elle ne sentira, dans ses remords, que quand il sera trop tard (v. 14). Quatrains I et II. La première strophe est un nocturne, où la couleur et le mystère de la femme s’accordent avec ceux de la nuit et de la mort. Baudelaire a souvent joué sur ces correspondances pour exprimer le charme étrange de Jeanne Duval : « Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne, ô vase de tristesse, ô grande taciturne », ou encore « Bizarre déité, brune comme les nuits... Sorcière au flanc d’ébène, enfant des noirs minuits... ». L’idée est présentée en deux mouvements. Le premier mouvement (v. 1-2), un chant grave, lentement scandé, débute comme un madrigal (v. 1) qui, aussitôt, devient triste bien que la mort soit évoquée au v. 2 sous forme du repos, de la beauté, de la richesse (on songe au refrain de L’Invitation au Voyage). XTX - 246 jeté dans les bras de sa coupable amie pour y retrouver le pardon qu’il lui accordait. » « Un sonnet composé sur des rimes. » J. Prévost, Baudelaire (Mercure de France). « Il existe un artifice qui permet de donner mouvement et unité à un sonnet composé sur des rimes. Il est fort probable que le poète a trouvé d’abord les deux premiers vers et les mieux venus du sonnet : 57 Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, Au fond d’un monument construit en marbre noir... Il avait sans doute trouvé aussi d’avance le vers final : Et le ver rongera ta peau comme un remords. mais, pour faire rimer ce dernier vers avec la rime » la plus naturelle, et qui s’imposait, il fallait mettre morts au pluriel... Menu problème... Pour les quatrains, les rimes en oir et euse ne manquent pas. Comme le sonnet rappelle Ronsard, le poète reprend la rime noir-manoir qu’il avait employée dans son sonnet ronsardisant A une dame créole; un autre mot archaïque, nonchaloir, donnera une rime et un vers heureux; de même ce beau mot d’aventureuse, qu’offre le dictionnaire de rimes, offrira un beau vers qui finira bien les quatrains. Mais le poète, cette fois, s’est soucié de la structure de la pièce, de son mouvement. En même temps qu’il cherchait des images selon les rimes, il bâtissait sur ce cadre rhétorique et grammatical fort simple, mille fois employé, toujours efficace : d’abord les circonstancielles, à chacune deux vers : lorsque... lorsque... puis un quatrain : quand... Une dernière au début des tercets, mais plus courte pour ne pas surcharger : L’Auhe A la différence de Jeanne Duval, Aglaé Sabatier nous est bien connue. Celle que ses amis nommaient la « Présidente » en raison de son port et de son aisance souveraine a servi de modèle à Ricard, à Meissonnier, à Clésinger surtout. Parmi les familiers de son salon, il y avait beaucoup d’hommes de lettres : Du Camp, Musset, Dumas père, Bouilhet et Flaubert, Théophile Gautier (dont les Lettres à la Présidente ne laissent rien dans l’ombre). Au moment où Baudelaire lui fut présenté, en 1851, c’était un financier, Mosselman, qui lui assurait l’existence plus que confortable dont d’autres lui avaient donné l’habitude, mais tout le monde aimait bien cette « bonne fille » au teint clair, aux cheveux soyeux, toujours gaie, simple et bonne. Le poète lui voua bientôt un véritable culte et, pendant deux ans (1852-1854), lui adressa des décla durant... La liaison des quatrains aux tercets est faite ainsi sans peine; le sujet de la phrase peut arriver au dixième vers : le tombeau et le verbe commencera le dernier tercet : te dira... Il reste un trou à combler à la fin du premier tercet, place importante; entre ce sujet et ce verbe on ne peut plus loger qu’une parenthèse : ici se montrent les belles ressources de l’artiste : pour faire parler le tombeau (et pour dire les morts au pluriel, et moraliser à l’oreille de la morte, il fallait que le tombeau parlât), le poète l’a pris pour complice et pour confident : la parenthèse développera cette pensée, en un vers qui n’a guère de sens. Mais ce vers, pour reprendre une expression de Valéry, forme un bel accord de deux mots importants : ... Car le tombeau toujours comprendra le poète... Ce remplissage réussi a donc fait naître un vers assez beau pour laisser le poète indulgent sur la faiblesse de la rime avec imparfaite. Mais la fin donne lieu à un bel effet de mouvement, à une trouvaille de la dernière heure, qui change tout le rythme des tercets. Le dernier vers : 58 Et le ver rongera ta peau comme un remords... pouvait très bien faire partie de la phrase unique du sonnet : il suffisait de prêter ce vers au tombeau... Mais ce dernier vers, d’une dureté si mordante, comme il se dégage mieux si on fait cesser juste avant lui une phrase de treize vers, si l’on en fait une reprise, un mouvement de la pensée qui rebondit, rejaillit sur la longue phrase précédente... Vite un changement du vouvoiement au tutoiement, un tiret qui montre aux yeux la coupure : le vers brille au sommet de la pièce comme un diamant noir... Et si ce vers rend inutile et faible tout le discours du tombeau, qu’importe ? Il y a progression d’effet. » (p. 324-326). spirituelle Page 438 rations anonymes et des vers d’une inspiration sublime — qui durent grandement l’étonner. Il rêvait d’une créature superbe, devant laquelle il serait comme un enfant adorant et tremblant. Mme Sabatier était peu faite pour le rôle, et l’aventure ne dura jusqu’en 1857 que grâce à l’anonymat initial, puis à la discrétion de Baudelaire. Composition. Si les plus belles des neuf pièces du « cycle angélique » ont été composées loin de la femme à laquelle elles étaient destinées, d’autres paraissent nées de rapports plus humains, comme celle-ci qui parvint à Mme Sabatier accompagnée de ces mots : « After a night of pleasure and désolation, ail my soul belongs to you. » A la fin d’une de ces fêtes qu’elle prolongeait xix - 248 volontiers jusqu’au matin, la Présidente est apparue toujours aussi fraîche, aussi divine, à un invité qui, lui, éprouvait l’amertume de la débauche dans son corps et dans son âme. Il est naturellement possible que les deux impressions initiales, celle de l’inaltérable fraîcheur de la déesse et celle de la fatigue du débauché, aient été liées par le seul « souvenir » à la fin d’une fête à laquelle Mme Sabatier ne participait pas : en tous cas, le poète est tenu de le faire croire ! Deux comparaisons (v. 1-7 et 8-11; v. 12 et 13-14 vont dire cette opposition de la « nuit » et de la « lumière ». Première comparaison. C’est d’abord une formule d’expérience : à propos de sa propre passion, Baudelaire devient l’interprète de la condition humaine. v. 1-4. — On part d’une allégorie : l'aube s’associe , à l'idéal (v. 1-2). En même temps qu’une représentation picturale, l’aube a, on le devinera peu à peu, une valeur symbolique. Elle est le renouveau et contraste, par sa pureté, avec la turpitude et la débauche. Par un mécanisme présenté comme inéluctable, avec le retour de l’aube, l'idéal, son compagnon inséparable, reprend le dessus. Ce n’est pas lui qui « ronge », c’est l’inquiétude de l’homme qui cherche à l’atteindre; en fait, dira-ton, par le raccourci saisissant de l'idéal rongeur, le poète nous présente l’idéal non pas comme l’objet lointain et passif de nos aspirations, mais comme une force attirante, tyrannique, qui nous tracasse et nous torture. La chose sera indiquée plus nettement dans la strophe suivante. 59 Un deuxième groupe (v. 3-4), dont les personnages sont l'Ange et la bête, encore confus et se détachant mal l’un de l’autre, nous introduit dans la mystique avec cette opposition pascalienne. La lutte entre l’âme et la chair se poursuit, inlassable, et l’aube qui surprend la brute dans l’anéantissement aide l’âme à prendre sa revanche; par un paradoxe surprenant — c’est là le mystère —, de cet être accablé par la débauche va surgir l’aspiration vers la pureté. Au v. 4, par le jeu de l’inversion, Baudelaire crée, Comme dans Elévation, une impression d’aisance et d’ascension vertigineuse. Le sens initial est simple : la débauche laisse un sentiment de honte et de dégoût. Mais par ces rap - prochements (entre les différentes valeurs du mot aube, entre l’Ange et l’idéal, entre le débauché et la brute) et par les symboles, le poète suggère des idées multiples. L’homme est de nature double, ange et bête (« brute » exprime mieux le dégoût devant l’être dégradé, avili, prisonnier de la matière) ; le mal paraît plus fort, mais c’est ici qu’ « intervient le mystère, qui est la nuit, le frère de la mystique, qui est la lumière ». Du mal, l’homme rebondit vers le bien car il est soumis à la « double postulation » : plus il plonge, plus il doit peser pour vaincre l’appel vers le haut. v. 5-7. — Une deuxième figuration de l’idéal atti rant et désespérant paraît plus simple. Exemple de l’analogie universelle, l’azur du jour naissant « correspond » à l’azur des deux spirituels, à la pureté de l’idéal. Mais c’est l’inaccessible azur, termes mis en relief par l’inversion, et à la rime. Là commence le tourment de l’homme : il tend vers l’idéal inaccessible, qui le hante, puis c’est la chute vers le spleen. Mallarmé parlera de la sereine ironie de cet Azur (cf. XIXe Siècle, p. 533). En contraste, en bas, le débauché, qui est un vaincu, l’homme terrassé, encore prisonnier, et pourtant hanté de nouveau par l’idéal et repris par son rêve de pureté. L’azur s’ouvre et s’enfonce; les deux verbes, en rejet pittoresque et expressif, créent une impression de progression. Le gouffre est insondable et d’une attirance irrésistible : la comparaison, qui s’applique d’ordinaire aux dangers, traduit ici la puissance de l’idéal. v. 8-11. — Le second volet de la comparaison identifie le poète au débauché, la Déesse (plus immatérielle que toute Forme) à l’idéal qui est lumière et pureté, beauté et intelligence (v. 8). Avant l’élan spirituel, pour souligner le contraste, Baudelaire accumule les termes de dégoût et d’amertume, exprimant ainsi le néant des amours physiques : il n’en reste plus que débris, fumées et stupeur (au sens étymologique) . Le souvenir est clair et rose comme l’aube, mais après les stupides orgies il apparaît encore « plus clair, plus rose » : par contraste, la débauche confère à ce souvenir un charme supérieur qui sera toujours vainqueur (v. 13). La ferveur du sentiment est rendue plus sensible dans la rédaction définitive du v. 10; le v. 11 exprime l’extase (« à mes yeux agrandis ») devant une vision qui s’impose avec la force d’une obsession (incessamment). Cette oscillation entre la débauche et l’amour spirituel, qui correspond à la dualité du spleen et de l’idéal, peut être considérée comme une vérité sur l’âme humaine, s’il est vrai du moins que l’homme est double. Seconde comparaison. v. 12-14. — Éclipsées par le soleil, les bougies qui éclairaient de leur lueur trompeuse les stupides orgies ne sont plus, par contraste, qu’une flamme noircie : l’aube dissipe les illusions de la débauche 60 et dénonce les mensonges de l’amour charnel. Ainsi le souvenir radieux de la femme aimée triomphe des illusions charnelles et cet amour de l’âme, immatériel, porte en lui la garantie de son immortalité semblable à celle du Soleil. Cette seconde comparaison traduit exactement l’impression que produisait Mme Sabatier : « Son air triomphant mettait autour d’elle comme de la lumière et du bonheur » a écrit Judith Gautier dans le Second rang du collier. Elle fait disparaître à peu près complètement les formes, et ne garde que l’essentiel, les jeux de la lumière et de l’ombre. Conclusion. « Dans certains états de l’âme presque surnaturels, la profondeur de la vie se révèle tout entière dans le xix - 249 spectacle, si ordinaire qu’il soit, qu’on a sous les yeux. Il en devient le symbole », lit-on dans les Fusées (XI). C’est une certaine ivresse cette fois encore, celle de la fatigue, qui a ouvert au poète les portes de l’univers. «Je vous dirai que quand mon être est roulé dans le noir de sa méchanceté et de sa sottise naturelles, il rêve profondément de vous », a écrit Baudelaire à Mme Sabatier. Tel est bien en effet le sens de l’amour qu’il a conçu pour elle (ou, plus exactement, qu’il a porté sur elle) : il s’y est jeté comme dans une foi (il écrira plus tard « une superstition») rédemptrice à un moment où il a senti que tout allait être fini. Elle devait donc être 1’ « Ange » dont les prières le sauveraient! Mais une telle rédemption est impossible: devant une femme parfaite et pure, l’amant éprouve plus fortement encore son indignité, et se torture en « se regardant lui-même. En chantant cette aube spirituelle, ne reconnaît-il pas aussi son incapacité à rejeter l’amour physique et même la débauche? Plus haut il élève ses désirs, plus profond est le gouffre qu’il creuse. L’espoir le rend finalement à la réalité d’un monde où il n’y a plus que l’essentiel, le bien et le mal, aussi loin l’un de l’autre que le soleil de la terre. Et il est sur la terre, condamné à y rester, ébloui et torturé par la lumière. * * ; « Descendre en soi-même... » G. Poulet, Trois Essais de Mythologie romantique (Corti). « Descendre en soi-même, ce n’est donc pas descendre dans un vide; c’est prendre contact, au contraire, avec la plénitude opaque de l’être. Si le monde souterrain paraît effrayant à l’homme, c’est qu’il se sent bouleversé en présence du caractère ténébreux de son immensité intérieure. Vertige de se découvrir penché sur cette Babel renversée, univers inconnu, enseveli dans l’ombre. Telle est la sorte d’horreur religieuse qui secoue Victor Hugo, toujours terrifié par l’ampleur, profondeur et épaisseur de son propre moi. Mais combien, d’autre part, cette horreur devient plus grande, lorsque le moi ainsi découvert se révèle être tout entier constitué par la substance la plus hideuse, la plus répugnante possible; de telle manière qu’alors descendre en soi- même, ce n’est pas seulement descendre dans les 61 ténèbres et se perdre dans l’amplitude; c’est s’aventurer dans un cloaque, prendre conscience de son identité totale avec ce qu’il y a de plus immonde sur terre et sous terre. Une telle horreur n’appartient pas au monde de Hugo. Elle appartient à celui de Baudelaire. Lui aussi a ses escaliers s’enfonçant dans la profondeur : ce sont les perspectives échelonnées dans la vision du Tasse, Mesurant d’un regard que la terreur enflamme L’escalier de vertige où s’abîme son âme; c’est l’escalier tournant que descendent les femmes damnées, prisonnières de leur monde clos : Descendez, descendez, lamentables victimes Descendez le chemin de l’enfer éternel; et c’est surtout celui qui, dans l’irrémédiable nous montre Un damné descendant sans lampe, Au bord d’un gouffre dont l’odeur Trahit l’humide profondeur, D’éternels escaliers sans rampe. Prisonniers d’eux-mêmes, de leurs vices, de leur honte, les damnés baudelairiens tournent sur euxmêmes dans une spirale qui se resserre et les rapproche graduellement de leur identification enfin absolue avec le mal. Personne, pas même de Quincey, n’a donc donné au thème piranésien une signification plus spécifiquement morale. S’enfoncer en soi-même, c’est prendre connaissance de ce qu’il y a de fondamentalement mauvais en soi-même. L’enfer est le point terminal dans cette descente que l’on fait d’un bout à l’autre à l’intérieur de soi. » (p. 180-182). Le sonnet, Baudelaire, Lettre du 19 février 1860. « Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense. Tout va bien au sonnet : la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique. Il y a, là, la beauté du métal et du minerai bien travaillés. Avez-vous observé qu’un morceau de ciel, aperçu par un soupirail ou entre deux cheminées, deux rochers, ou par une arcade, donnait une idée plus profonde de l’infini que le grand panorama vu du haut d’une montagne? » Th. Gautier, Notice à Baudelaire (Calmann-Lévy). « La jeune école se permet un grand nombre de sonnets libertins, et, nous l’avouons, cela nous est particulièrement désagréable. Pourquoi, si l’on veut être libre et arranger les rimes à sa guise, aller chercher une forme rigoureuse qui n’admet aucun écart, aucun caprice? L’irrégulier dans le régulier, le manque de correspondance dans la symétrie, quoi de plus illogique et de plus contrariant? » (p. 44). A. Cassagne, Versification et métrique de Baudelaire (Hachette). « Illogique ou non, l’irrégulier dans le régulier, le manque de correspondance dans la symétrie était justement ce qui plaisait à Baudelaire. [...] C’était presque sa formule de composition poétique, la loi de ses combinaisons métriques. Mais en ce qui concerne spécialement le sonnet, quelle est donc la raison de cette irrégularité? La raison en est certainement dans son goût de l’indépendance, dans son inaptitude à se plier à une forme régulière, même dans la courte étendue d’un sonnet, et dans son ingéniosité de chercheur; mais 62 xix - 250 elle est aussi dans la conception qu’il se faisait du sonnet, et elle est surtout dans sa technique particulière. En effet, ici, comme souvent chez Baudelaire, on s’aperçoit vite que la question de la rime est dominante. Une simple observation le démontre. La plupart des sonnets de Baudelaire, soit 47, sont écrits sur 5 rimes, comme le veut la règle. Mais Baudelaire, médiocre rimeur, ne l’oublions pas, s’est trouvé porté naturellement, afin de diminuer d’autant ce qui constituait pour lui la difficulté du poème, à augmenter le nombre des rimes; c’est ce qui fait qu’il a écrit 4 sonnets sur 6 rimes, et 21 sur 7, tandis qu’avec toute sa fantaisie il n’a pu se donner que trois fois, en tout et pour tout, le luxe d’écrire un sonnet sur 4 rimes, exercice difficile quand on n’aime pas à se contenter de peu, et qui lui était ardu. » (p. 91-92). H. Peyre, Connaissance de Baudelaire (Corti). « De grandes monographies seraient à entreprendre [...] surtout peut-être sur le sonnet, la chanson et le poème strophique dans les Fleurs du Mal. Ici encore, c’est l’union du sens et du son, de la correspondance entre les procédés techniques et l’intensité et la tonalité du sentiment, qu’une telle étude devrait mettre en valeur. L’art du sonnet en France au xixe siècle (chez Sainte-Beuve, Nerval, Musset ; les Parnassiens, jusqu’à Valéry de VAlbum des vers anciens en passant par les grands sonnets de Mallarmé) serait à suivre, dans ses effets d’art et ses puissances de suggestion. Il nous importe assez peu par exemple de savoir que 47 sonnets sont sur 5 rimes, 4 sur 6, 4 sur 7 et 3 sur 4 rimes, et que quatre sonnets seulement sont absolument réguliers [...]. Il est plus important de se demander pourquoi Baudelaire est allé avec prédilection vers le sonnet, quels avantages de condensation de sens et d’approfondissement de la sensation il a trouvés dans cette forme poétique; comment il a évité le tour trop prévu, le commencement trop majestueux, l’agrandissement oratoire de la fin qui gâtent pour nous ces sonnets des Parnassiens dont Claudel a dit malignement qu’ils partent tout seuls comme des boîtes à musique. Baudelaire ne donne presque jamais l’impression d’avoir cédé au savoir-faire et d’avoir moulé plusieurs sonnets dans un même gaufrier. La grandeur de son art ici réside dans les effets dramatiques dont il a réussi à charger un cadre étroit de 14 vers (A une Passante, Causerie), dans la richesse psychologique de ces questions et réponses qui font du sonnet, non pas un monotone tableau, mais un roman où deux personnages dialoguent en écoutant le silence de leur cœur. Les sonnets qui commencent par D’où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange et Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire, et Remords posthume, Sonnet d’Automne, Le Rêve d’un curieux sont à cet égard fort originaux. Les frères aînés de Baudelaire, ses seuls égaux peut-être dans cet art du sonnet psychologique et dramatique, enfermant en lui un conflit qui prolonge le vers du lecteur, sont le Ronsard des Sonnets pour Hélène et Shakespeare. » (p. 131- 132). « Que diras-tu ce soir... » 63 Page 438 Dans une lettre de 1850 (ou de 1851), Baudelaire écrivait : « Pour vous, Marie, je serai fort et grand... Comme Pétrarque, j’immortaliserai ma Laure. Soyez mon Ange gardien, ma Muse et ma Madone, et conduisez-moi sur la route du Beau. » Il est donc possible que le poème n’ait pas été conçu pour Mme Sabatier, à qui il a été adressé le 16 février 1854 : il pouvait être destiné à toute maîtresse idéale, c’està-dire à une Muse. Le classement des Fleurs du Mal en cycles est thématique autant et plus que biographique. Ce n’est pourtant pas un simple jeu littéraire ou sentimental, mais l’appel pathétique d’un enfant perdu qui implore la protection d’une femme-déesse. Strophe I. Le poète sollicite son âme avec insistance (v. 1-2). Les adjectifs pauvre, flétri, sont faibles et la pauvre âme solitaire fait songer à la pauvre âme veuve de Lamartine dans la Vigne et la Maison (cf. XIXe Siècle, p. 120), mais la valeur incantatoire de ce début est due au jeu des allitérations, à l’anaphore, au rythme du vers 2. De la prière, on monte jusqu’à l’hymne, avec le vers 3, un trimètre qui chante gravement la Vierge-Mère plutôt que l’amante. Le vers 4 évoque certes le rajeunissement opéré par l’amour, mais en fait un miracle : le regard, messager traditionnel de l’amour, a refleuri le cœur naguère flétri. « J’étais mort, vous m’avez fait renaître », dit Baudelaire dans une lettre à Marie Daubrun. Strophes II et III. L’âme chante alors la Muse avec une ferveur religieuse, particulièrement sensible dans le mouvement des deux vers symétriques (v. 9, v. 10), dans la désincarnation de la femme (v. 7) et dans son assimilation à Y Ange (cf. « Je vous aime, Marie, c’est indéniable; mais l’amour que je ressens pour vous, c’est celui d’un chrétien pour son Dieu »). Il y a surtout l’éblouissante lumière qui accompagne l’apparition : Mallarmé, à son tour, écrira une Apparition où l’influence de ces vers est sensible. Le vers 11 est admirable et xix - 251 fait deviner que la comparaison n’a pas été de la femme vers le flambeau, mais dans le sens contraire. Quant au poète, d’abord agenouillé (attitude traditionnelle, mais aussi attitude mentale caractéristique de Baudelaire), puis ravi en extase par le parfum et par la lumière, il se perd dans la clarté qui rayonne (v. 8) autour de la Madone. Strophe IV. Le second tercet fait entendre la voix de la Muse, une voix qui ne parvient pas toujours au poète (parfois seulement) parce que l’élan mystique, et l’élan poétique n’ont pas assez de force ou de constance pour l’unir perpétuellement à la divinité ou à la beauté. L’amour, dit-elle, est la route qui conduit à l’idéal. Ce qu’il y a de meilleur auprès de l’homme (son An£e gardien) et ce qu’il y a de meilleur auprès de Dieu (la Madone) se retrouvent, par une association mystique, dans la poésie (la Muse). Conclusion. 64 Un bouquet de fleurs devant une statue, un enfant en larmes sur les genoux de sa mère ou un amant aux pieds de sa Dame, un poète qui contemple la Beauté ou un saint qui s’élance vers Dieu, le poème peut nous proposer tout cela, et c’est ce qui en fait la richesse et la force. Il pourrait être adressé à n’importe quelle Muse, il s’élève vers la Muse de l’enfance, parce que « le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté », parce que l’âme de l’homme est restée menue, chétive, dans un corps tourmenté qui n’est pas à sa mesure, et qu’elle en a terriblement souffert. Il est donc pathétique et merveilleux. Mais ce suppliant qui demande tout à la fois : la pureté, l’inspiration, le bonheur, se remet entre des mains qui ne peuvent être que celles de la Vierge. Or il cherche une protectrice sur terre, épouse et mère. L’appel à la femme et l’appel à Dieu ne peuvent alors pas avoir d’écho. Harmonie Le pantoum est une sorte de dialogue lyrique, qui n’est pas sans ressemblances avec nos vieux poèmes à forme fixe. Dans son emploi régulier, il faut que les vers et les thèmes soient constamment croisés : deux sens doivent se développer parallèlement; le second et le quatrième vers de chaque strophe doi L’élan d’un cœur inassouvi ? Th. Gautier, Notice des Fleurs du Mal (Calmann- Lévy). « Diverses figures de femme paraissent au fond des poésies de Baudelaire, les unes voilées, les autres demi-nues, mais sans qu’on puisse leur attribuer un nom. Ce sont plutôt des types que des personnes. Elles représentent Véternel féminin, et l’amour que le poète exprime pour elles est l’amour et non pas un amour, car nous avons vu que dans sa théorie il n’admettait pas la passion individuelle, la trouvant trop crue, trop familière et trop violente. Parmi ces femmes, les unes symbolisent la prostitution inconsciente et presque bestiale. [...] Mais ce n’est à aucune de ces créatures de plâtre, de marbre ou d’ébène qu’il donne son âme. Au-dessus de ce noir amas de maisons lépreuses, de ce dédale infect où circulent les spectres du plaisir, de cet immonde fourmillement de misère, de laideur et de perversité, loin, bien loin dans l’inaltérable azur, flotte l’adorable fantôme de la Béatrix, l’idéal toujours désiré, jamais atteint, la beauté supérieure et divine incarnée sous une forme de femme éthérée, spiritualisée, faite de lumière, de flamme et de parfum, une vapeur, un rêve, un reflet du monde aromal et séraphique comme les Ligeia, les Morella, les Una, les Éléonore d’Edgar Poe et la SéraphîtaSeraphitus de Balzac, cette étonnante création. Du fond de ses déchéances, de ses erreurs et de ses désespoirs, c’est vers cette image céleste comme vers une madone de Bon-Secours qu’il tend les bras avec des cris, des pleurs et un profond dégoût de lui-même. Aux heures de mélancolie amoureuse, c’est toujours avec elle qu’il voudrait s’enfuir et cacher sa félicité parfaite dans quelque asile mystérieusement féerique, ou idéalement confortable, cottage de Gainsborough, intérieur de Gérard Dow, ou mieux encore palais à dentelles de marbre de Benarès ou d’Hyderabad. Jamais son rêve n’emmène d’autre compagne. Faut-il voir dans cette Béatrix, dans cette Laure qu’aucun nom ne désigne, une jeune fille ou une jeune femme réelle, passionnément et religieusement aimée par le 65 poète pendant son passage sur la terre? [...] Le plus sûr serait de ne voir dans cet amour idéal qu’une postulation de l’âme, l’élan d’un cœur inassouvi et l’éternel soupir de l’imparfait aspirant à l’absolu. » (p. 35-37). du soir Page 439 vent être repris comme premier et troisième vers de la strophe suivante, et le vers initial se retrouver en finale; les rimes aussi sont croisées, etc. Ce qui peut séduire en lui, outre l’étrangeté « orientale » et le caractère acrobatique, c’est l’effet mystérieux, tragique peut-être, qu’ont par eux-mêmes les jeux d’échos, xix - 25a ue l’on comparera aux jeux de miroir d’autres poèmes voir par exemple, XIXe Siècle, p. 436 ou encore La y.lort des Amants). Baudelaire use librement du pan- Dum, comme il use librement du sonnet, mais il en ;arde l’essentiel, la musique et le dialogue, qu’il intériorise. Il souligne les symétries dans le balancement des images et des sons, un balancement qui tst d’abord le mouvement du sang dans un cœur angoissé. Strophe I. v. 1. — Une formule prophétique, usuelle dans les Ecritures, crée une atmosphère religieuse. Elle est proférée lentement. Le vers est très accentué, sans rudesse pourtant avec ses sonorités glissantes, mais une note aiguë se détache sur le fonds des voyelles sourdes ou nasales et donne une nuance d’anxiété douloureuse à l’attente. v. 2. — Puis le poème prend un rythme plus fort, qui monte en deux élans vers le second terme de la comparaison, l'encensoir, dont la présence suppose relie d’un objet sacré qu’on ne discerne pas encore. Une analogie entre le balancement de la fleur et celui de l’encensoir peut avoir été perçue dans un rrépuscule parfumé, mais il n’y a pas eu formation d’image : tout se noie dans un halo (vibration et évaporation), et la fleur est réduite à son parfum et ^ son mouvement, le parfum paraissant naître du mouvement, analogue à une vibration musicale, l'harmonie de ces sensations est complète; il s’en légage une impression de recueillement religieux, •n accord avec l’état d’âme du poète. Pour ce mystique de l’amour, le parfum de fleurs qui s’évapore "-vient un hommage qui monte vers la femme aimée : Dmme vers une divinité. v. 3-4. — Ces vers reprennent en les enrichissant les '..pressions précédentes : le tournoiement des sons : des parfums devient une valse et un vertige (compa- : r à la série des Éventails chez Mallarmé). La musique emporte le vers. Les effets de déséquilibre rythmique, la distribution des temps forts soutenus par . allitération en l, suggèrent le mouvement même 1: la valse, avec une certaine lourdeur. Dans l’accord sensations, l’ivresse envoûtante du soir s’accom- ^aie de mélancolie et de langueur. Construite une alternance de sons aigus (le i qui revient avec r. caractère obsédant) et de sons plus graves et -:uffés, l’harmonie même de la strophe traduit 66 :e double impression d’ensorcellement et de lan- ^--;ur douloureuse. Le mélange entre la magie - : • jrceleuse du soir et la tristesse du poète va repa- riiire dans chaque strophe du pantoum. Un fantôme se devine, celui de la femme aimée : ; v' le lieu où elle est parée et adorée, Se bal, cadre pr*:eré de l’heure exquise, dont le thème, pictural, ~. .'ical ou poétique, sera si souvent traité par les mbolistes. Strophe II. Les vers 5 et 7 sont repris de la strophe précédente, mais ils tendent à changer de sens en changeant de place, et doivent être reçus en même temps que le vers qui les sépare. Ainsi le balancement de la fleur- ostensoir se trouve plus étroitement accordé à la valse, et le frémissement du violon rappelle la vibration de la tige sur un mode plus lancinant, en accord avec le caractère aigu de la souffrance. Les vers « neufs » prennent nécessairement une importance particulière. La notation du coeur qu'on afflige devient essentielle (v. 6) et se trouve répercutée en finale (v. 8). Elle est née dans les communications complexes entre sensations et sentiments : de la mélancolie à sa cause, de la présence du fantôme à l’absence de la femme aimée, de la musique au battement du cœur. Au dernier vers, la magnificence d’un soleil couchant est suggérée par l’évocation des fleurs et des draperies pourpres et dorées qui ornent le repo- soir, lieu d’adoration. On y entendra ce qui y est sous-entendu : l’identité du cœur et du ciel, le caractère idéalement triste de la beauté, la correspondance du visible et de l’invisible. On y apercevra ce que le dernier vers doit manifester : l’inquiétude d’une aspiration mystique qui cherche à se fixer, la présence d’une lumière qui sauve le solitaire de son angoisse.
«
1
BAUDELAIRE
Né à Paris en 1821, Charles BAUDELAIRE était le fils d’un aimable sexagénaire disciple des
philosophes et amateur de peinture.
Sa mère, veuve en 1827, se remarie l’année suivante avec le
commandant Aupick, futur général, ambassadeur et sénateur sous l’Empire.
Révolté par ce mariage, l'enfant, qui ne s'entend pas avec son beau-père, est mis en pension à Lyon,
puis au Lycée Louis-le-Grand.
C’est un élève cynique, singulier, qui éprouve de « lourdes
mélancolies », un « sentiment de destinée éternellement solitaire ».
Bohème et dandysme
Pendant trois ans (1839-1841), BAUDELAIRE mène dissipée de Bohème littéraire au quartier latin.
LA BOHÈME.
II y retrouve Louis Ménard, fréquente Leconte de Lisle et Pierre Dupont, se lie avec Le Vavasseur,
chef de « l’Ecole Normande ».
Il lit beaucoup, devient ultra-romantique et disciple de GAUTIER; il se passionne aussi pour J.
DE
MAISTRE à qui l’on rattache certains aspects « catholiques » de son inspiration.
LE VOYAGE.
Pour l’arracher à cette vie « scandaleuse », sa famille l’embarque à Bordeaux sur un voilier en
partance pour les Indes (1841).
Pris de nostalgie, BAUDELAIRE n’ira pas plus loin que l’île Bourbon et
sera de retour au bout de dix mois.
Sur le bateau il s'isole orgueilleusement, indifférent à tout ce qui n’est pas littérature.
En réalité ce
voyage enrichit sa sensibilité, l’éveille à la poésie de la mer, du soleil, de l’exotisme.
LE DANDYSME.
Dès son retour, BAUDELAIRE exige sa part de l’héritage paternel et se lance dans l’existence dorée de
la bohème riche.
Il habite le somptueux hôtel Pimodan ; il est vêtu avec recherche : mais, selon son
idéal du dandysme, cette élégance matérielle n’est « qu’un symbole de la supériorité aristocratique
de son esprit ».
Il se lie avec la mulâtresse Jeanne DUVAL, la Vénus Noire, qu’en dépit d’amours orageuses il gardera
comme compagne presque jusqu’à sa mort.
C’est la période heureuse de son existence, où il écrit déjà certains poèmes des Fleurs du Mal.
Mais sa
prodigalité menace déjà son patrimoine.
Sa famille lui impose un conseil judiciaire qui le limite à une
rente mensuelle de deux cents francs (1844) : désormais il vivra misérablement.
L’activité littéraire
Baudelaire se consacre d'abord à la critique d'art : il va s'imposer comme un des maîtres du genre,
avec le Salon de 1845, le Salon de 1846, l'Exposition Universelle de 1855 et le Salon de 1859.
La politique l’accapare quelque temps au moment de la Révolution de 1848 : on le trouve dans la rue,
les mains noires de poudre : il fonde un journal, publie des articles violents.
Mais cette ardeur
s’évanouit et il revient vite à la littérature..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Femme dans l'oeuvre de Baudelaire
- Fleurs DU mal (les). Recueil poétique de Charles Baudelaire (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Spleen de Paris (le) de Charles Baudelaire (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Vie et oeuvre de Charles Baudelaire
- Analyse de l'oeuvre littéraire de Charles BAUDELAIRE ?