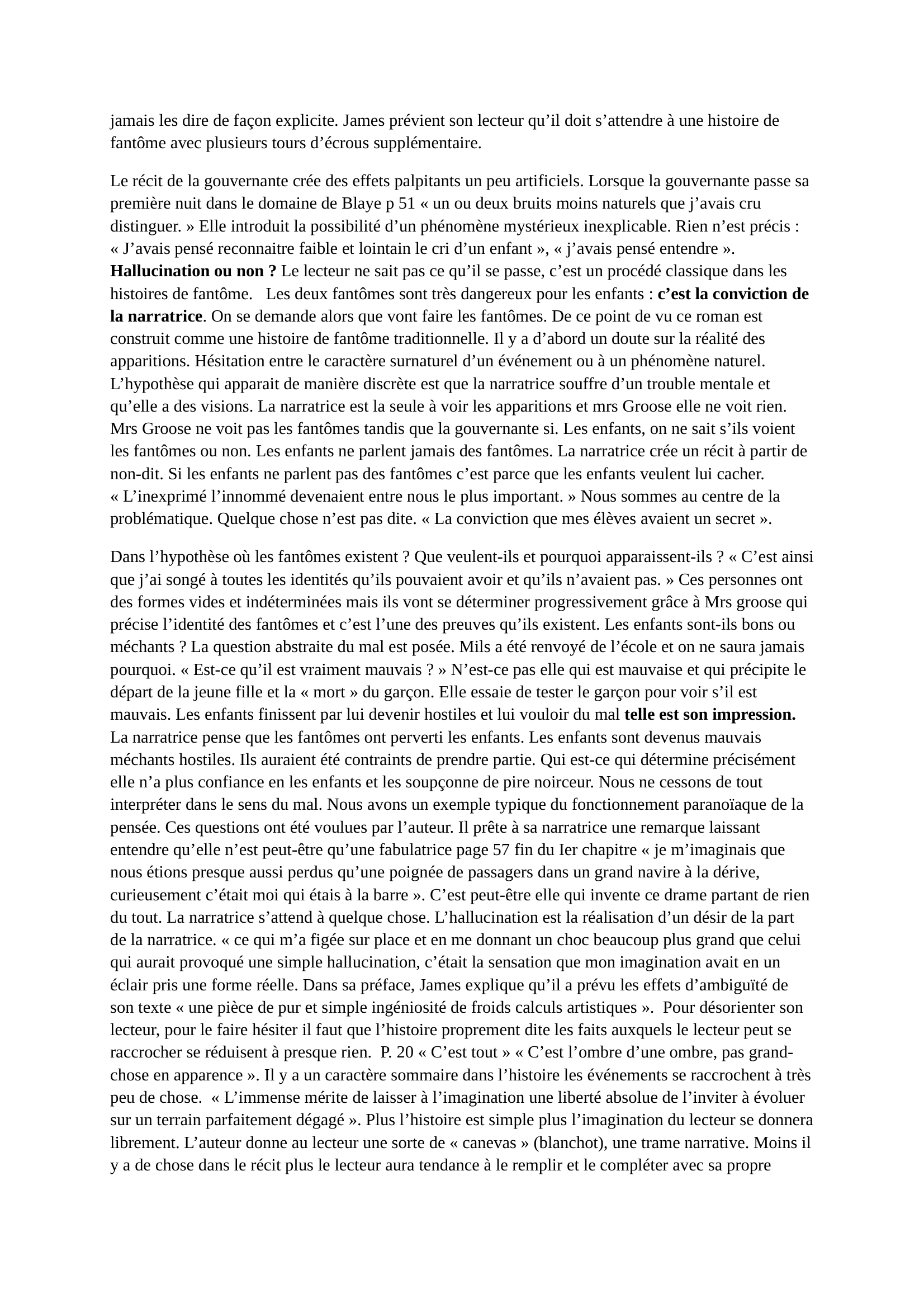LITTERATURE COMPAREE
Publié le 09/11/2014
Extrait du document
«
jamais les dire de façon explicite.
James prévient son lecteur qu’il doit s’attendre à une histoire de
fantôme avec plusieurs tours d’écrous supplémentaire.
Le récit de la gouvernante crée des effets palpitants un peu artificiels.
Lorsque la gouvernante passe sa
première nuit dans le domaine de Blaye p 51 « un ou deux bruits moins naturels que j’avais cru
distinguer.
» Elle introduit la possibilité d’un phénomène mystérieux inexplicable.
Rien n’est précis :
« J’avais pensé reconnaitre faible et lointain le cri d’un enfant », « j’avais pensé entendre ».
Hallucination ou non ? Le lecteur ne sait pas ce qu’il se passe, c’est un procédé classique dans les
histoires de fantôme.
Les deux fantômes sont très dangereux pour les enfants : c’est la conviction de
la narratrice .
On se demande alors que vont faire les fantômes.
De ce point de vu ce roman est
construit comme une histoire de fantôme traditionnelle.
Il y a d’abord un doute sur la réalité des
apparitions.
Hésitation entre le caractère surnaturel d’un événement ou à un phénomène naturel.
L’hypothèse qui apparait de manière discrète est que la narratrice souffre d’un trouble mentale et
qu’elle a des visions.
La narratrice est la seule à voir les apparitions et mrs Groose elle ne voit rien.
Mrs Groose ne voit pas les fantômes tandis que la gouvernante si.
Les enfants, on ne sait s’ils voient
les fantômes ou non.
Les enfants ne parlent jamais des fantômes.
La narratrice crée un récit à partir de
non-dit.
Si les enfants ne parlent pas des fantômes c’est parce que les enfants veulent lui cacher.
« L’inexprimé l’innommé devenaient entre nous le plus important.
» Nous sommes au centre de la
problématique.
Quelque chose n’est pas dite.
« La conviction que mes élèves avaient un secret ».
Dans l’hypothèse où les fantômes existent ? Que veulent-ils et pourquoi apparaissent-ils ? « C’est ainsi
que j’ai songé à toutes les identités qu’ils pouvaient avoir et qu’ils n’avaient pas.
» Ces personnes ont
des formes vides et indéterminées mais ils vont se déterminer progressivement grâce à Mrs groose qui
précise l’identité des fantômes et c’est l’une des preuves qu’ils existent.
Les enfants sont-ils bons ou
méchants ? La question abstraite du mal est posée.
Mils a été renvoyé de l’école et on ne saura jamais
pourquoi.
« Est-ce qu’il est vraiment mauvais ? » N’est-ce pas elle qui est mauvaise et qui précipite le
départ de la jeune fille et la « mort » du garçon.
Elle essaie de tester le garçon pour voir s’il est
mauvais.
Les enfants finissent par lui devenir hostiles et lui vouloir du mal telle est son impression.
La narratrice pense que les fantômes ont perverti les enfants.
Les enfants sont devenus mauvais
méchants hostiles.
Ils auraient été contraints de prendre partie.
Qui est-ce qui détermine précisément
elle n’a plus confiance en les enfants et les soupçonne de pire noirceur.
Nous ne cessons de tout
interpréter dans le sens du mal.
Nous avons un exemple typique du fonctionnement paranoïaque de la
pensée.
Ces questions ont été voulues par l’auteur.
Il prête à sa narratrice une remarque laissant
entendre qu’elle n’est peut-être qu’une fabulatrice page 57 fin du Ier chapitre « je m’imaginais que
nous étions presque aussi perdus qu’une poignée de passagers dans un grand navire à la dérive,
curieusement c’était moi qui étais à la barre ».
C’est peut-être elle qui invente ce drame partant de rien
du tout.
La narratrice s’attend à quelque chose.
L’hallucination est la réalisation d’un désir de la part
de la narratrice.
« ce qui m’a figée sur place et en me donnant un choc beaucoup plus grand que celui
qui aurait provoqué une simple hallucination, c’était la sensation que mon imagination avait en un
éclair pris une forme réelle.
Dans sa préface, James explique qu’il a prévu les effets d’ambiguïté de
son texte « une pièce de pur et simple ingéniosité de froids calculs artistiques ».
Pour désorienter son
lecteur, pour le faire hésiter il faut que l’histoire proprement dite les faits auxquels le lecteur peut se
raccrocher se réduisent à presque rien.
P.
20 « C’est tout » « C’est l’ombre d’une ombre, pas grand-
chose en apparence ».
Il y a un caractère sommaire dans l’histoire les événements se raccrochent à très
peu de chose.
« L’immense mérite de laisser à l’imagination une liberté absolue de l’inviter à évoluer
sur un terrain parfaitement dégagé ».
Plus l’histoire est simple plus l’imagination du lecteur se donnera
librement.
L’auteur donne au lecteur une sorte de « canevas » (blanchot), une trame narrative.
Moins il
y a de chose dans le récit plus le lecteur aura tendance à le remplir et le compléter avec sa propre.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- litterature.pdf : The play Macbeth was written by William shakespeare
- L'ILE DE LA RÉUNION ET LA LITTERATURE
- HISTOIRE DE LA LITTERATURE LATINE. (résumé)
- la litterature
- LITTERATURE ET LE MAL (La) GEoRGES Bataille (résumé)