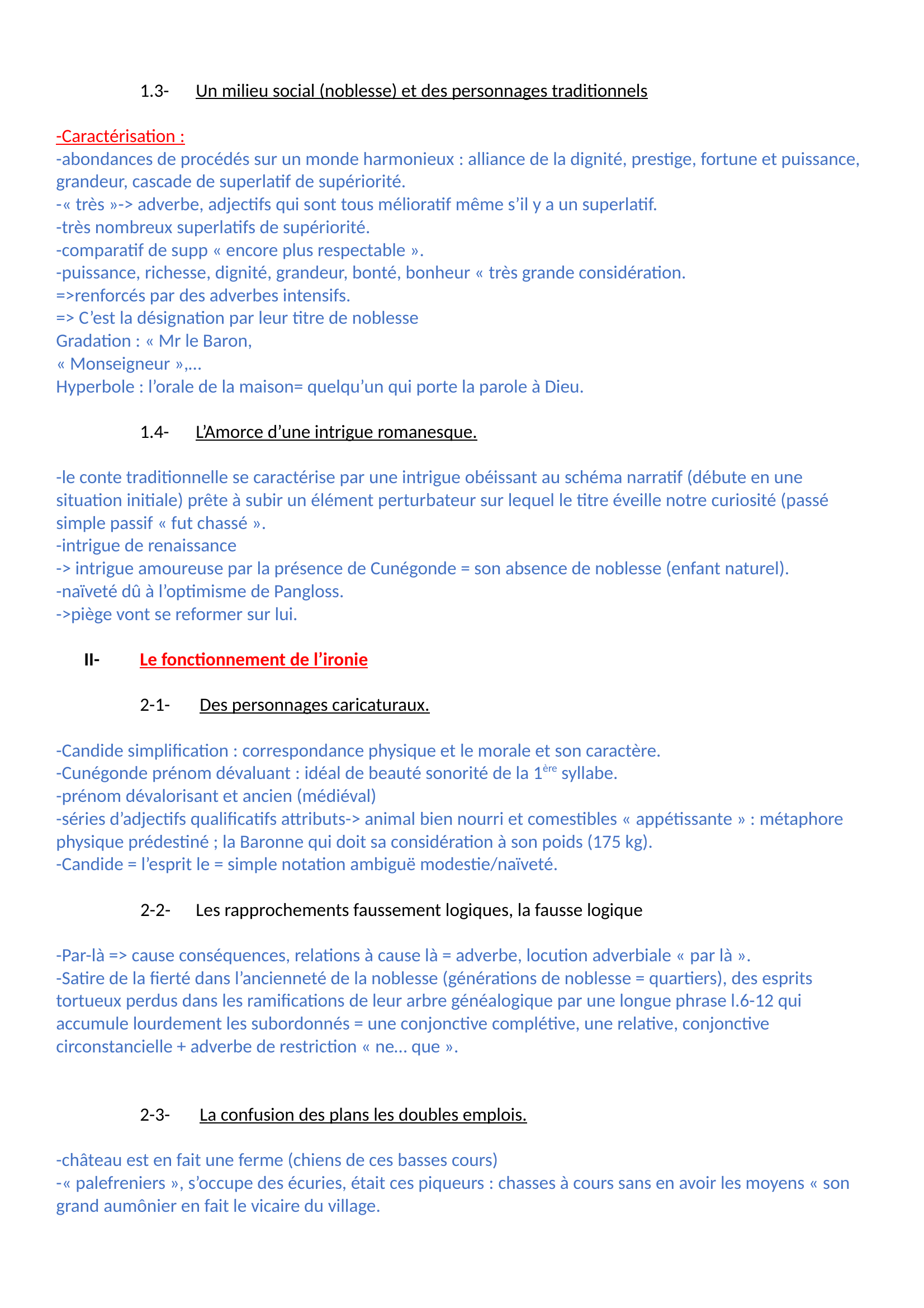litt
Publié le 28/01/2019
Extrait du document
«
1.3- Un milieu social (noblesse) et des personnages traditionnels
-Caractérisation :
-abondances de procédés sur un monde harmonieux : alliance de la dignité, prestige, fortune et puissance,
grandeur, cascade de superlatif de supériorité.
-« très »-> adverbe, adjectifs qui sont tous mélioratif même s’il y a un superlatif.
-très nombreux superlatifs de supériorité.
-comparatif de supp « encore plus respectable ».
-puissance, richesse, dignité, grandeur, bonté, bonheur « très grande considération.
=>renforcés par des adverbes intensifs.
=> C’est la désignation par leur titre de noblesse
Gradation : « Mr le Baron,
« Monseigneur »,…
Hyperbole : l’orale de la maison= quelqu’un qui porte la parole à Dieu.
1.4- L’Amorce d’une intrigue romanesque.
-le conte traditionnelle se caractérise par une intrigue obéissant au schéma narratif (débute en une situation initiale) prête à subir un élément perturbateur sur lequel le titre éveille notre curiosité (passé simple passif « fut chassé ». -intrigue de renaissance -> intrigue amoureuse par la présence de Cunégonde = son absence de noblesse (enfant naturel). -naïveté dû à l’optimisme de Pangloss. ->piège vont se reformer sur lui. II- Le fonctionnement de l’ironie 2-1- Des personnages caricaturaux. -Candide simplification : correspondance physique et le morale et son caractère. -Cunégonde prénom dévaluant : idéal de beauté sonorité de la 1 ère syllabe. -prénom dévalorisant et ancien (médiéval) -séries d’adjectifs qualificatifs attributs-> animal bien nourri et comestibles « appétissante » : métaphore physique prédestiné ; la Baronne qui doit sa considération à son poids (175 kg). -Candide = l’esprit le = simple notation ambiguë modestie/naïveté. 2-2- Les rapprochements faussement logiques, la fausse logique -Par-là => cause conséquences, relations à cause là = adverbe, locution adverbiale « par là ». -Satire de la fierté dans l’ancienneté de la noblesse (générations de noblesse = quartiers), des esprits tortueux perdus dans les ramifications de leur arbre généalogique par une longue phrase l.6-12 qui accumule lourdement les subordonnés = une conjonctive complétive, une relative, conjonctive circonstancielle + adverbe de restriction « ne… que ». 2-3- La confusion des plans les doubles emplois. -château est en fait une ferme (chiens de ces basses cours) -« palefreniers », s’occupe des écuries, était ces piqueurs : chasses à cours sans en avoir les moyens « son grand aumônier en fait le vicaire du village.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- YIN PING CHE TCH'OAN Kl [litt.
- WAMYO RULTU-SHO ou WAM- YOSHO [litt.
- WA-KAN • RO-M-SHU [litt.
- THÉORIE DE L’ÉDUCATION ET PHILOSOPHIE DES VALEURS (résumé) Theodor Litt
- HOMME ET LE MONDE (L’) Théodor Litt