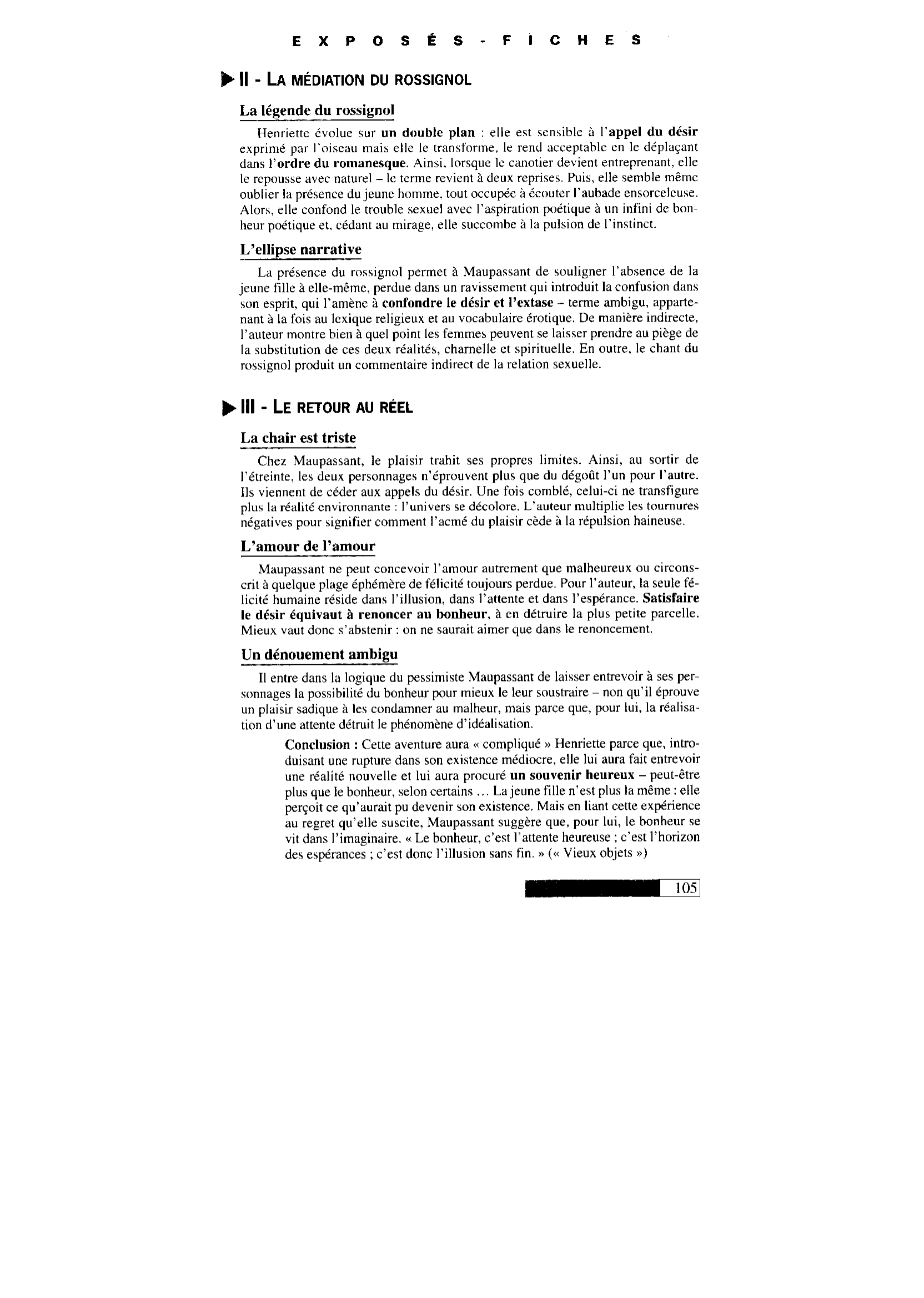L'imaginaire du désir chez Maupassant
Publié le 02/08/2014
Extrait du document
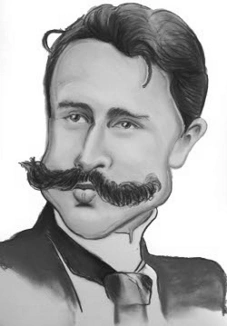
L'imaginaire du désir
En général, les personnages de Maupassant deviennent les victimes de leur sentimentalisme. Ces avatars de Mme Bovary confondent le désir avec leur représentation de l'amour idéal. Dans « Une partie de campagne «, long terme, le souvenir d'une folle étreinte se substitue aux représentations romanesques d'Henriette. Maupassant montre comment l'irruption du désir répond à des sollicitations diverses et conjuguées, celles de la nature mais aussi de l'imaginaire. En effet, la représentation « cristallise « le désir et favorise le plaisir ; la mémoire l'entretient.
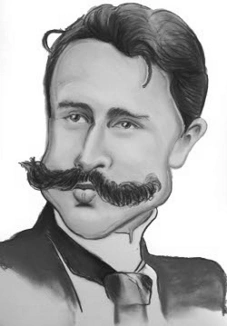
«
E X P 0 S t S F C H E S
...
Il -LA MÉDIATION DU ROSSIGNOL
La légende du rossignol
Henriette évolue sur un double plan elle est sensible à l'appel du désir
exprin1é par l'oiseau mai~ elle le transfonne, le rend acceptable en le déplaçant
dans
l'ordre du romanesque.
Ainsi, lorsque le canotier devient entreprenant.
elle le repousse avec naturel -le terme revient à deux reprises.
Puis, elle semble même
oublier la présence du jeune homme.
tout occupée à écouter l'aubade ensorceleuse.
Alors, elle confond le trouble sexuel avec l'aspiration poétique
à un infini de bon
heur poétique et.
cédant au mirage, elle succombe à la pulsion de l'instinct.
L'ellipse narrative
La présence du rossignol permet à Maupassant de souligner l'absence de la
jeune fille à elle-même, perdue dans un ravissement qui introduit la confusion dans
son esprit, qui l'amène à confondre le désir et l'extase -terme ambigu, apparte
nant à la fois au lexique religieux et au vocabulaire érotique.
De manière indirecte,
l'auteur montre bien à quel point les
femme~ peuvent se laisser prendre au piège de
la substitution de ces deux réalités, charnelle et spirituelle.
En outre, le chant du
rossignol produit
un commentaire indirect de la relation sexuelle .
....
Ill -LE RETOUR AU RÉEL
La chair est triste
Chez Maupassant, le plaisir trahit ses propres limites.
Ainsi, au sortir de
l'étreinte, les deux personnages n'éprouvent plus que du dégoût l'un pour l'autre.
Ils viennent
de céder aux appels du désir.
Une fois comblé, celui-ci ne transfigure
plus la réalité environnante: l'univers se décolore.
L'auteur multiplie les tournures
négatives pour signifier comment
lacmé du plaisir cède à la répulsion haineuse.
L'amour de l'amour
Maupassant ne peut concevoir l'amour autrement que malheureux ou circons
crit
à quelque plage éphémère de félicité toujours perdue.
Pour 1' auteur, la seule fé
licité humaine réside dans l'illusion, dans l'attente et dans l'espérance.
Satisfaire
le désir équivaut à renoncer au bonheur, à en détruire la plus petite parcelle.
Mieux vaut donc
s'abstenir: on ne saurait aimer que dans le renoncement.
Un dénouement ambigu
Il entre dans la logique du pessimiste Maupassant de laisser entrevoir à ses per
sonnages la possibilité du bonheur pour mieux le leur soustraire -non qu'il éprouve
un plaisir sadique à les condamner au malheur, mais parce que, pour lui, la réalisa
tion
d'une attente détruit le phénomène d'idéalisation.
Conclusion : Cette aventure aura
« compliqué » Henriette parce que, intro
duisant une rupture dans son existence médiocre, elle lui aura fait entrevoir
une réalité nouvelle et lui aura procuré
un souvenir heureux -peut-être
plus que le bonheur, selon certains
...
La jeune fille n'est plus la même: elle
perçoit ce qu'aurait pu devenir son existence.
Mais en liant cette expérience
au regret
qu'elle suscite, Maupassant suggère que, pour lui, le bonheur se
vit dans
l'imaginaire..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'imaginaire du désir dans «Une partie de campagne» MAUPASSANT
- Illustrez et, s'il y a lieu, discutez cette présentation du merveilleux surréaliste : «Donnant au langage une nouvelle dimension, (les Surréalistes) pensent accorder ainsi une nouvelle valeur à la vie et réintégrer le merveilleux dans le quotidien. Le «merveilleux» surréaliste semble parfois le fruit d'une volonté artificielle factice, mais dans ses meilleurs textes, il propose au lecteur une expérience bouleversante où le quotidien et l'imaginaire se rejoignent dans un foisonnement d'
- Maupassant illusionniste
- La science ne vise-t-elle que la satisfaction de notre désir de savoir ?
- analyse linéaire Molière - Texte 1 : Acte II scène 5 (extrait du Malade Imaginaire)