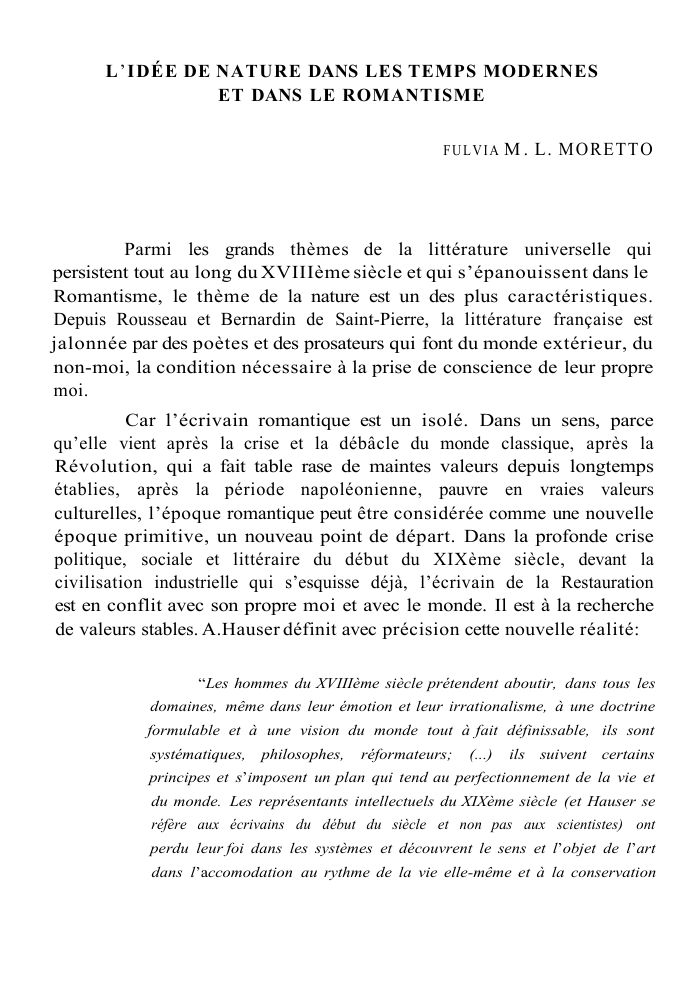L'idée de la nature dans les temps modernes et dans le romantisme
Publié le 08/04/2025
Extrait du document
«
L’IDÉE DE NATURE DANS LES TEMPS MODERNES
ET DANS LE ROMANTISME
FULVIA
M .
L.
MORETTO
Parmi les grands thèmes de la littérature universelle qui
persistent tout au long du XVIIIème siècle et qui s’épanouissent dans le
Romantisme, le thème de la nature est un des plus caractéristiques.
Depuis Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, la littérature française est
jalonnée par des poètes et des prosateurs qui font du monde extérieur, du
non-moi, la condition nécessaire à la prise de conscience de leur propre
moi.
Car l’écrivain romantique est un isolé.
Dans un sens, parce
qu’elle vient après la crise et la débâcle du monde classique, après la
Révolution, qui a fait table rase de maintes valeurs depuis longtemps
établies, après la période napoléonienne, pauvre en vraies valeurs
culturelles, l’époque romantique peut être considérée comme une nouvelle
époque primitive, un nouveau point de départ.
Dans la profonde crise
politique, sociale et littéraire du début du XIXème siècle, devant la
civilisation industrielle qui s’esquisse déjà, l’écrivain de la Restauration
est en conflit avec son propre moi et avec le monde.
Il est à la recherche
de valeurs stables.
A.Hauser définit avec précision cette nouvelle réalité:
“Les hommes du XVIIIème siècle prétendent aboutir, dans tous les
domaines, même dans leur émotion et leur irrationalisme, à une doctrine
formulable et à une vision du monde tout à fait définissable, ils sont
systématiques,
philosophes,
réformateurs;
(...)
ils
suivent
certains
principes et s’imposent un plan qui tend au perfectionnement de la vie et
du monde.
Les représentants intellectuels du XIXème siècle (et Hauser se
réfère aux écrivains du début du siècle et non pas aux scientistes) ont
perdu leur foi dans les systèmes et découvrent le sens et l’objet de l’art
dans l’accomodation au rythme de la vie elle-même et à la conservation
de l’atmosphère et de l’ambiance de l’existance.
Leur foi consiste en une
affirmation irrationelle et instinctive de la vie; leur morale en un
compromis avec la réalité” (1964, p.228).
De là, la valeur de l’évasion
dans la nature, van Tieghen nous le dit:
“moins pour en décrire les
beautés comme le faisaient volontiers leurs prédécesseurs du XVIIIème
siècle, que pour y nourrir leur réverie, y bercer leur mélancolie” (1948,
p.258).
Cet intérêt pour le monde extérieur a été défini comme “...
l’emozione indefinibile di stupore, di terrore, di serenità, ecc...) che
l’uomo prova con determinati aspetti della natura (paesaggio, volta
celeste, e c c .
.
.
) e che determina fra uomo e natura una viva relazione
simpatetica; come tale il s.d.n.
è la prima e autentica espressione del
‘senso dell’essere’ proprio della condizione umana” (E.F., 1957).
1l s’agit
donc là d’un état psychique qui peut être positif ou négatif, amour ou
haine, sympathie ou aversion.
En fait, depuis l’antiquité, la littérature occidentale chante la
nature aimable et l’éternel printemps.
En outre, que ce soit chez Homère,
chez Théocrite et Virgile ou dans l’Astrée, avec ses paysans enrubannés,
la nature est toujours marquée par la présence humaine.
L’églogue, la
pastorale, qui ont en Occident une tradition de deux mille ans, donnent
leurs derniers fruits au XVIIIème siècle.
Ce sont elles qui donnent
naissance à la littérature descriptive qui ne disparaîtra qu’au seuil du
Romantisme.
Car, la vieille tradition de la nature embellie, artificielle, peuplée
de dieux et de bergers traîne-t-elle encore sous L’Empire, au moment où
Chateaubriand a déjà publié le Génie, Atala, René, au moment où
Rousseau est largement connu dans toute l’Europe, où Mme.
de Staël a
déjà publié De la littérature.
Que s’est-il passé?
1
_________________________________
1
La tradition bucolique d’ailleurs se poursuit aussi en peinture où elle est mieux
représentée qu’en littérature.
Watteau surtout lui donne une vérité que n’avaient pas
la poésie pastorale et bucolique de l’époque, et je ne sais quel mystère, quel sens
fuyant de la vie.
Vie qui n’est pas là, dans le tableau, mais qui est alleurs, quelque
part, insaisissable peut-être.
-44-
Au XVIIème siècle il n’est pas bienséant de prendre comme sujet
littéraire la nature extérieure.
En outre, excepté les rares moments ou
celle-ci est citée, comme par exemple chez Théophile et Racan, qui la font
voir dans sa “verité” et dans sa simplicité, la nature, comme l’homme, est
vue à travers les règles de l’esthétique classique; figée, établie une fois
pour toutes dans sa “beauté”.
L’idée de changement, d’évolution n’existe
pas au siècle de Louis X I V .
Cette idée, dans son sens le plus large, apparaît au début du
XVIIIème siècle.
Les récits de voyage, si fréquents à la fin du siècle
précédent, la traduction des Mille et une nuits en 1704, la publication des
Lettres Persanes en 1721, donnent aux contemporains les premières
sensations de la relativité du vrai et même du beau.
Car enfin ce malaise
vient de ce que les mêmes mots recouvrent désormais des réalités
différentes.
D’abord, on ne s’accorde plus sur la définition du mot beau.
C’est là le grand symptôme que toute une esthétique est en train de
changer.
Pour le siècle classique, le beau est le vrai, ou plutôt le
vraisemblable, ce qui l’est pour la société qui vit sous Louis X I V .
Mais au
XVIIIème siècle le beau perd son caractère absolu.
Une esthétique
ouverte remplace l’esthétique fermée du siècle précédent.
Le beau est
désormais relatif.
Et pour cela même, les définitions concernant le beau
foisonnent au siècle philosophique.
Toutefois, le beau sera déterminé non
plus par l’objet, mais par le sentiment individuel, qui va désormais se
substituer à la raison.
Dans l’Encyclopédie, l’article “Beau” - écrit par
Diderot - est un compte-rendu des idées les plus en vogue sur ce sujet.
Après avoir exposé les théories de Huetchson, son “sens intérieur du
beau” et “l’uniformité dans la variété” Diderot présente celle du père
André, dont l’Essai sur le Beau est pour lui “le plus étendu, le mieux que
je connaisse”, et celle de Shaftesbury qui prétend avec beaucoup d’autres
qu’il n’y a qu’un seul beau dont l’utile est le fondement.
Après s’être
interrogé sur les raisons de la nécessité, de la régularité, de l’ordre et de
l’harmonie dans l’idée de beau chez le philosophe anglais, Diderot nous
__________________________________________________________________
P.Francastel l’appelle “le peintre de l’éphèmêre du fugitif, du moment qui passe et ne
revient pas, dont on sait et le prix et les retours amers qui le suivent”.
(s.d., p.135)
-45-
expose ses propres idées: “J’appelle donc beau hors de moi, tout ce qui
contient de quoi réveiller dans mon entendement l’idée de rapport; est
beau par rapport à moi tout ce qui réveille cette idée”.
Et Diderot conclut
que “le beau est plutôt une affaire de sentiment que de raison”
( M D C C L X X V I I I ) .
Le beau absolu, figé et déterminé, tel que le conçoit le
grand siècle n’existe plus: son arrêt de mort a été signé dès la fin du
XVIIème siècle, quand Locke (1690) a, le premier, lancé le discrédit sur
la toute puissance de la raison et donné la primauté aux sens.
Creusons encore un peu le concept de beau.
Pour Boileau, “rien
n’est beau que le vrai, le vrai seul est aimable” (1935, p.43).
Or, en 1826,
Victor Hugo déclare que “le poète ne doit avoir qu’un modèle, la nature;
qu’un guide, la vérité” (p.283).
Et en 1827, dans la préface de Cromwell,
en caractérisant les époques de la société primitive, antique et moderne, il
écrit: “le caractère de la troisième est la vérité”.
Cent cinquante ans
séparent l’esthétique de Boileau de celle de Hugo.
Mais dans l’une
comme dans l’autre, le vrai est le fondement du beau.
Par conséquent,
nous l’avons déjà dit, les mêmes mots recouvrent des réalités différentes:
le vrai des classiques est la vérité idéale, fondée sur l’équilibre, en un mot,
la belle nature.
Il s’agit d’une vérité surtout intellectuelle.
Mais la vérité
des romantiques est tout autre.
L.Emery résume le rôle qu’ont joué Locke
et les sensualistes dans ce nouveau concept de vérité:
Pour qui voit en l’idée une élaboration plus ou moins complexe de
la sensation, les anciennes préséances s’évanouissent et la vérité provient
avant tout des impressions sensibles que nous communiquent les objets.
Remonter à ces impressions ce n’est donc point trahir ou dégrader la
raison, c’est la ramener à sa racine.
Observer, sentir, équivaut à peu près
à penser (1948, p.33).
La vérité passe ainsi du domaine de l’intelligence au domaine
des sens.
Le beau est toujours le vrai, mais le vrai naît désormais du
sensible, du personnel, du moi.
Si nous revenons maintenant au thème de la nature, nous
constatons qu’à partir du milieu du XVIIIème siècle, le concept de beauté
a changé aussi.
Hugo, en plein Romantisme exige le laid, le difforme, le
-46-
grotesque dans l’art, au nom de la vérité et de l’harmonie des contraires.
Mais par rapport à la nature, il n’est jamais question de laideur.
Une
tempête ou une montagne, qui font peur au Moyen Age et dégoûtent le
XVIIème siècle, font les délices des romantiques.
Ce qui était laid pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le sentiment de la nature, le plaisir de vivre près d'elle, au moins pour quelque temps, sont des choses devenues banales depuis le romantisme. Pourtant chacun a sa façon toute personnelle d'aimer la nature, ou de ne l'aimer qu'à demi, ou même de ne pas l'aimer du tout. Vous montrerez quels sont exactement les sentiments que cette nature vous inspire.
- Peut-on accepter l'idée d'une nature humaine identique en tous temps ?
- CRITIQUE DES TEMPS MODERNES (résumé & analyse)
- TEMPS MODERNES (Les) de SARTRE (résumé)
- FIN DES TEMPS MODERNES (La) Romano Guardini (résumé)