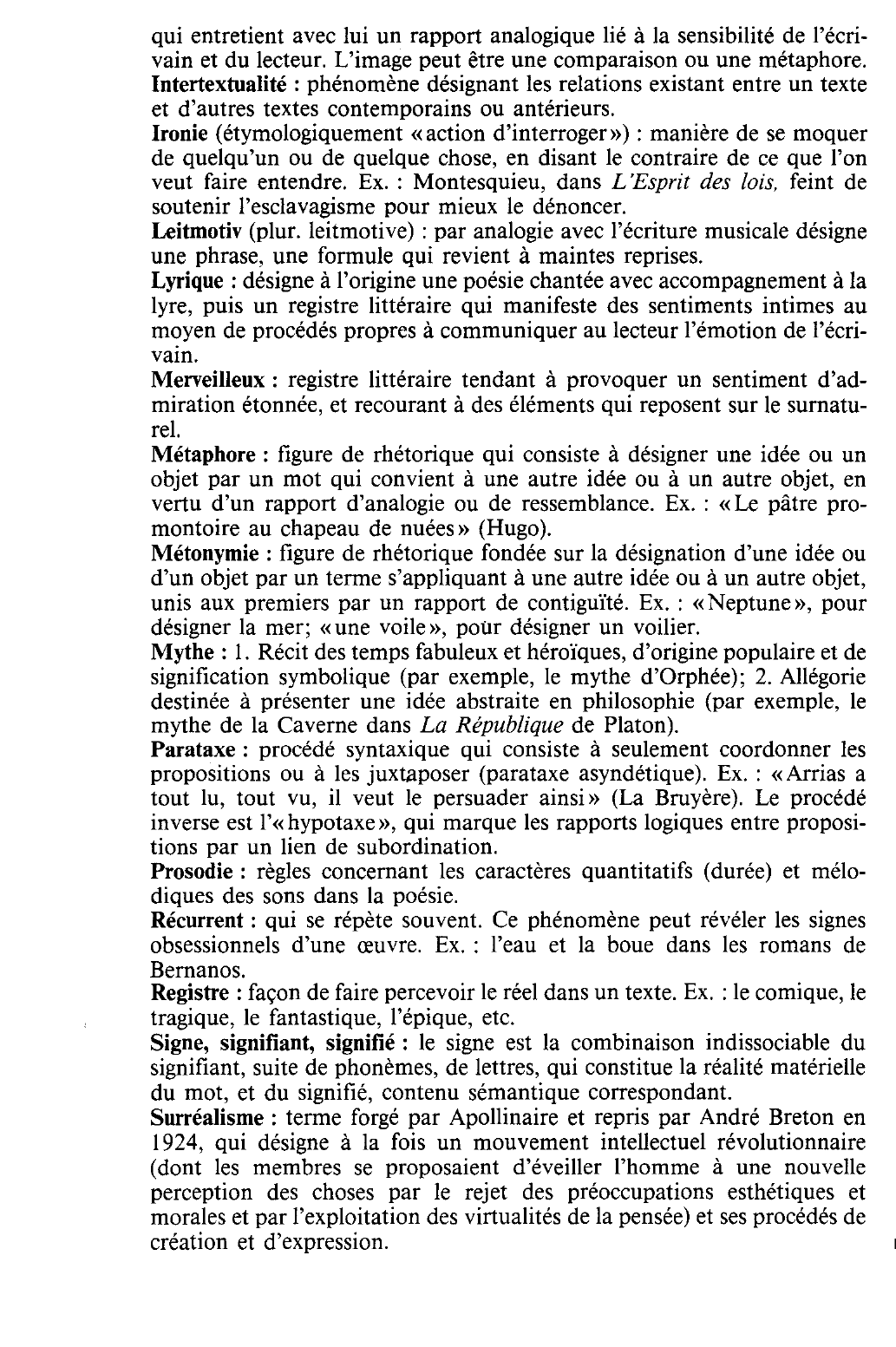LEXIQUE LITTERAIRE
Publié le 04/10/2013

Extrait du document
Adjuvant : l'un des actants ou forces agissantes (êtres animés, objets,
notions) qui, dans un roman ou une pièce de théâtre, déterminent
l'intrigue; par exemple dans Le Grand Meaulnes, outre les principaux
personnages, l'amour et la recherche d'une réalité secrète. L' «adjuvant«
aide le «sujet« dans sa quête : c'est le cas de François Seurel.
Allitération: répétition d'un même phonème consonantique en prose ou
en poésie. Ex. : « U nftais parjùm sortait des touffes d'asphodèles« (Hugo).
Assonance : répétition d'un même phonème vocalique, et plus particulièrement
de la dernière voyelle accentuée du vers. Ex. : «Je fais souvent ce
rêve étrange et pénétrant« (Verlaine).
Champ lexical: ensemble des mots d'un texte se rapportant à un domaine
donné de la réalité. Ex. : le champ lexical de la mine dans Germinal de
Zola.
Champ sémantique : ensemble des sens que revêt un mot dans un texte
donné. Ex. : le champ sémantique du mot «flamme« dans Alcools d' Apollinaire.
Comparaison : figure de rhétorique qui établit un rapport explicite d'analogie,
au moyen d'un lien grammatical (le plus souvent «comme«), entre
deux termes. Ex. : «Elle a passé, la jeune fille / Vive et preste comme un
oiseau« (Nerval).
Connotation : désigne tout ce qu'un terme peut évoquer en plus de son
sens propre. Ce pouvoir de suggestion importe beaucoup dans un texte
littéraire, où il dépend du contexte dans lequel il est employé. Le sens
connoté varie suivant les personnes, les époques, etc.
Dénotation : sens invariant et non subjectif d'un mot, donné par le dictionnaire.
Discours : désigne dans la linguistique moderne un énoncé où l'auteur
manifeste sa subjectivité sous une forme quelconque.
Discursif: adjectif correspondant à «discours«.
Énoncé : désigne le texte écrit sans aucune référence aux éléments qui ont
contribué à sa production.
Énonciation: désigne l'ensemble des éléments qui influent sur la manière
de produire un énoncé (lieu, époque, situation du narrateur. .. ).
Fantastique : on parle de fantastique dans un récit quand les événements
ou les personnages sont présentés d'une façon suffisamment ambiguë pour
que le lecteur hésite entre une explication rationnelle et une explication
surnaturelle.
Figures : procédés stylistiques employés dans un texte, par exemple la
métaphore.
Humour: forme d'esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en
souligner les aspects comiques ou insolites. Ex. : la vision humoristique de
la guerre dans Candide.
Hyperbole : figure de style qui consiste à mettre en relief une idée par une
expression exagérée. Ex. : «Rome entière noyée au sang de ses enfants«
12 (Corneille).
Image : procédé littéraire qui consiste à remplacer un terme par un autre,
qui entretient avec lui un rapport analogique lié à la sensibilité de !'écrivain
et du lecteur. L'image peut être une comparaison ou une métaphore.
lntertextualité : phénomène désignant les relations existant entre un texte
et d'autres textes contemporains ou antérieurs.
Ironie (étymologiquement «action d'interroger«): manière de se moquer
de quelqu'un ou de quelque chose, en disant le contraire de ce que l'on
veut faire entendre. Ex. : Montesquieu, dans L 'Esprit des lois, feint de
soutenir l'esclavagisme pour mieux le dénoncer.
Leitmotiv (plur. leitmotive) : par analogie avec l'écriture musicale désigne
une phrase, une formule qui revient à maintes reprises.
Lyrique: désigne à l'origine une poésie chantée avec accompagnement à la
lyre, puis un registre littéraire qui manifeste des sentiments intimes au
moyen de procédés propres à communiquer au lecteur l'émotion de !'écrivain.
Merveilleux : registre littéraire tendant à provoquer un sentiment d'admiration
étonnée, et recourant à des éléments qui reposent sur le surnaturel.
Métaphore : figure de rhétorique qui consiste à désigner une idée ou un
objet par un mot qui convient à une autre idée ou à un autre objet, en
vertu d'un rapport d'analogie ou de ressemblance. Ex. : «Le pâtre promontoire
au chapeau de nuées« (Hugo).
Métonymie : figure de rhétorique fondée sur la désignation d'une idée ou
d'un objet par un terme s'appliquant à une autre idée ou à un autre objet,
unis aux premiers par un rapport de contiguïté. Ex. : «Neptune«, pour
désigner la mer; «une voile«, poùr désigner un voilier.
Mythe: 1. Récit des temps fabuleux et héroïques, d'origine populaire et de
signification symbolique (par exemple, le mythe d'Orphée); 2. Allégorie
destinée à présenter une idée abstraite en philosophie (par exemple, le
mythe de la Caverne dans La République de Platon).
Parataxe : procédé syntaxique qui consiste à seulement coordonner les
propositions ou à les juxtaposer (parataxe asyndétique). Ex. : « Arrias a
tout lu, tout vu, il veut le persuader ainsi« (La Bruyère). Le procédé
inverse est l'« hypotaxe «, qui marque les rapports logiques entre propositions
par un lien de subordination.
Prosodie : règles concernant les caractères quantitatifs (durée) et mélodiques
des sons dans la poésie.
Récurrent : qui se répète souvent. Ce phénomène peut révéler les signes
obsessionnels d'une oeuvre. Ex. : l'eau et la boue dans les romans de
Bernanos.
Registre : façon de faire percevoir le réel dans un texte. Ex. : le comique, le
tragique, le fantastique, l'épique, etc.
Signe, signifiant, signifié : le signe est la combinaison indissociable du
signifiant, suite de phonèmes, de lettres, qui constitue la réalité matérielle
du mot, et du signifié, contenu sémantique correspondant.
Surréalisme : terme forgé par Apollinaire et repris par André Breton en
1924, qui désigne à la fois un mouvement intellectuel révolutionnaire
(dont les membres se proposaient d'éveiller l'homme à une nouvelle
perception des choses par le rejet des préoccupations esthétiques et
morales et par l'exploitation des virtualités de la pensée) et ses procédés de création et d'expression. -
LEXIQUE
-Syllepse (de sens) : figure par laquelle un mot est employé à la fois au sens
propre et au sens figuré. Ex. : «Vaincu, chargé de fers, de regrets consumé,
/Brûlé de plus de feux que je n'en allumai« (Racine), où« feux« désigne à
la fois les incendies et la passion amoureuse.
Symbole : image ou objet qui représente une réalité abstraite. Ex. : la
colombe est le symbole de la paix. Quand cette représentation se fait par
une suite d'éléments descriptifs ou narratifs qui correspondent terme à
terme à ce qu'ils évoquent, on parle d'«allégorie«. Ex. : les allégories du
Roman de la Rose.
«
qui entretient avec lui un rapport analogique lié à la sensibilité de !'écri
vain et du lecteur.
L'image peut être une comparaison ou une métaphore.
lntertextualité : phénomène désignant les relations existant entre un texte
et d'autres textes contemporains ou antérieurs.
Ironie (étymologiquement
«action d'interroger»): manière de se moquer
de quelqu'un ou de quelque chose, en disant le contraire de ce que l'on
veut faire entendre.
Ex.
: Montesquieu, dans L 'Esprit des lois, feint de
soutenir l'esclavagisme
pour mieux le dénoncer.
Leitmotiv (plur.
leitmotive) :
par analogie avec l'écriture musicale désigne
une phrase, une formule qui revient
à maintes reprises.
Lyrique: désigne à l'origine une poésie chantée avec accompagnement à la
lyre, puis un registre littéraire qui manifeste des sentiments intimes
au
moyen de procédés propres à communiquer au lecteur l'émotion de !'écri
vain.
Merveilleux : registre littéraire tendant à provoquer un sentiment
d'ad
miration étonnée, et recourant à des éléments qui reposent sur le surnatu
rel.
Métaphore : figure de rhétorique qui consiste à désigner une idée ou un
objet
par un mot qui convient à une autre idée ou à un autre objet, en
vertu
d'un rapport d'analogie ou de ressemblance.
Ex.
: «Le pâtre pro
montoire au chapeau de nuées» (Hugo).
Métonymie : figure de rhétorique fondée sur la désignation d'une idée ou
d'un objet par un terme s'appliquant à une autre idée ou à un autre objet,
unis aux premiers
par un rapport de contiguïté.
Ex.
: «Neptune», pour
désigner la mer; «une voile», poùr désigner un voilier.
Mythe: 1.
Récit des temps fabuleux et héroïques, d'origine populaire et de
signification symbolique (par exemple,
le mythe d'Orphée); 2.
Allégorie
destinée à présenter une idée abstraite en philosophie (par exemple,
le
mythe de la Caverne dans La République de Platon).
Parataxe : procédé syntaxique qui consiste à seulement coordonner les
propositions ou à les juxtaposer (parataxe asyndétique).
Ex.
: « Arrias a
tout lu, tout vu, il veut le persuader ainsi» (La Bruyère).
Le procédé
inverse est
l'« hypotaxe », qui marque les rapports logiques entre proposi
tions par un lien de subordination.
Prosodie : règles concernant les caractères quantitatifs (durée) et
mélo
diques des sons dans la poésie.
Récurrent : qui se répète souvent.
Ce phénomène peut révéler les signes
obsessionnels
d'une œuvre.
Ex.
: l'eau et la boue dans les romans de
Bernanos.
Registre : façon de faire percevoir
le réel dans un texte.
Ex.
: le comique, le
tragique, le fantastique, l'épique, etc.
Signe, signifiant, signifié : le signe est la combinaison indissociable du
signifiant, suite de phonèmes, de lettres, qui constitue la réalité matérielle
du mot, et du signifié, contenu sémantique correspondant.
Surréalisme : terme forgé
par Apollinaire et repris par André Breton en
1924, qui désigne à la fois
un mouvement intellectuel révolutionnaire
(dont les membres
se proposaient d'éveiller l'homme à une nouvelle
perception des choses
par le rejet des préoccupations esthétiques et
morales et
par l'exploitation des virtualités de la pensée) et ses procédés de
création et d'expression..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LEXIQUE LITTERAIRE
- LEXIQUE LITTERAIRE
- PETIT LEXIQUE DE PHILOSOPHIE
- Cycle 3 Lexique Anticorps Molécules fabriquées sur mesure pour reconnaître les microbes qui s'introduisent dans notre corps et les détruire.
- Commentaire Litteraire