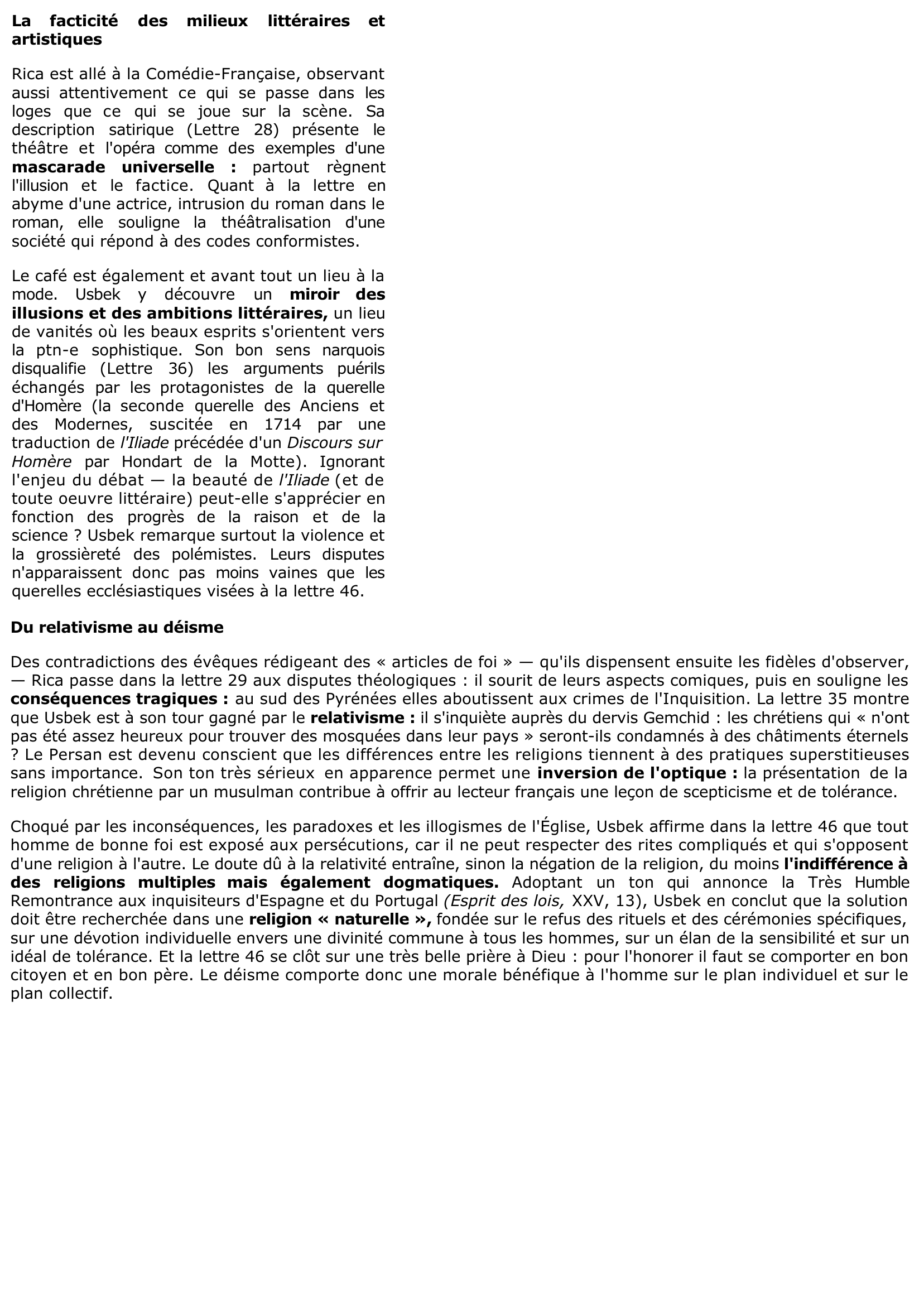LETTRES PERSANES 25 À 46 : LES CURIOSITÉS PARISIENNES
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
La facticité des milieux littéraires etartistiques
Rica est allé à la Comédie-Française, observantaussi attentivement ce qui se passe dans lesloges que ce qui se joue sur la scène.
Sadescription satirique (Lettre 28) présente lethéâtre et l'opéra comme des exemples d'unemascarade universelle : partout règnent l'illusion et le factice.
Quant à la lettre enabyme d'une actrice, intrusion du roman dans leroman, elle souligne la théâtralisation d'unesociété qui répond à des codes conformistes.
Le café est également et avant tout un lieu à lamode.
Usbek y découvre un miroir des illusions et des ambitions littéraires, un lieu de vanités où les beaux esprits s'orientent versla ptn-e sophistique.
Son bon sens narquoisdisqualifie (Lettre 36) les arguments puérilséchangés par les protagonistes de la querelled'Homère (la seconde querelle des Anciens etdes Modernes, suscitée en 1714 par unetraduction de l'Iliade précédée d'un Discours sur Homère par Hondart de la Motte).
Ignorant l'enjeu du débat — la beauté de l'Iliade (et de toute oeuvre littéraire) peut-elle s'apprécier enfonction des progrès de la raison et de lascience ? Usbek remarque surtout la violence etla grossièreté des polémistes.
Leurs disputesn'apparaissent donc pas moins vaines que lesquerelles ecclésiastiques visées à la lettre 46.
Du relativisme au déisme
Des contradictions des évêques rédigeant des « articles de foi » — qu'ils dispensent ensuite les fidèles d'observer,— Rica passe dans la lettre 29 aux disputes théologiques : il sourit de leurs aspects comiques, puis en souligne lesconséquences tragiques : au sud des Pyrénées elles aboutissent aux crimes de l'Inquisition.
La lettre 35 montre que Usbek est à son tour gagné par le relativisme : il s'inquiète auprès du dervis Gemchid : les chrétiens qui « n'ont pas été assez heureux pour trouver des mosquées dans leur pays » seront-ils condamnés à des châtiments éternels? Le Persan est devenu conscient que les différences entre les religions tiennent à des pratiques superstitieusessans importance.
Son ton très sérieux en apparence permet une inversion de l'optique : la présentation de la religion chrétienne par un musulman contribue à offrir au lecteur français une leçon de scepticisme et de tolérance.
Choqué par les inconséquences, les paradoxes et les illogismes de l'Église, Usbek affirme dans la lettre 46 que touthomme de bonne foi est exposé aux persécutions, car il ne peut respecter des rites compliqués et qui s'opposentd'une religion à l'autre.
Le doute dû à la relativité entraîne, sinon la négation de la religion, du moins l'indifférence à des religions multiples mais également dogmatiques.
Adoptant un ton qui annonce la Très Humble Remontrance aux inquisiteurs d'Espagne et du Portugal (Esprit des lois, XXV, 13), Usbek en conclut que la solution doit être recherchée dans une religion « naturelle », fondée sur le refus des rituels et des cérémonies spécifiques, sur une dévotion individuelle envers une divinité commune à tous les hommes, sur un élan de la sensibilité et sur unidéal de tolérance.
Et la lettre 46 se clôt sur une très belle prière à Dieu : pour l'honorer il faut se comporter en boncitoyen et en bon père.
Le déisme comporte donc une morale bénéfique à l'homme sur le plan individuel et sur leplan collectif..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- lecture linéaire lettres 24 lettres persanes
- Fiche de Lecture Résumé Les Lettres Persanes
- Lettres persanes de Montesquieu : Fiche de lecture
- Explication de texte de la dernière lettre des Lettres persanes de Montesquieu
- Lecture analytique Lettres Persanes