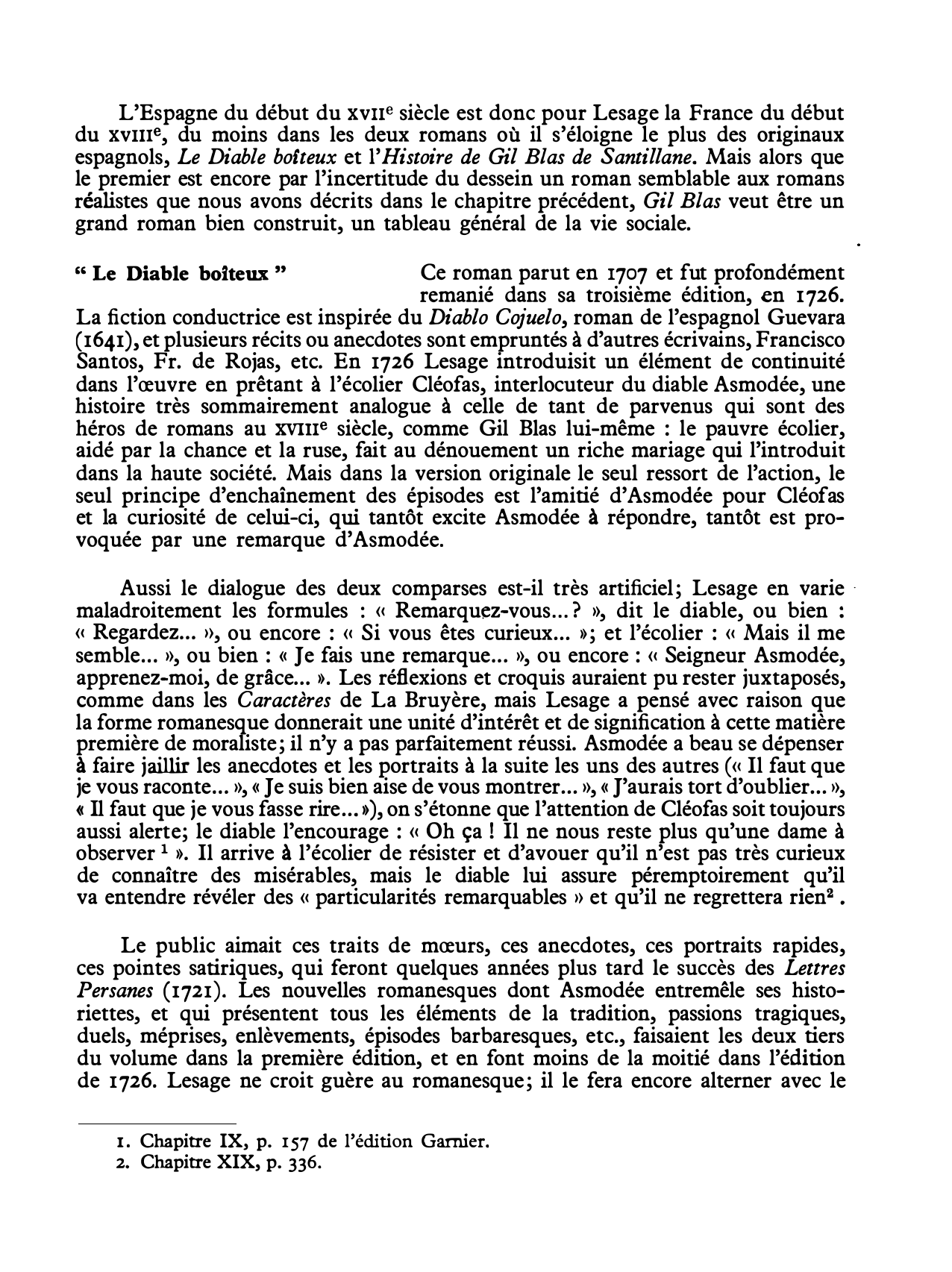Lesage - Histoire de la littérature
Publié le 25/01/2018
Extrait du document

Le Diable Boiteux faisait la revue de la société et des mœurs; dans Gli Blas, la peinture est en action, un individu traverse la société et raconte ses années d'apprentissage, sa réussite et sa retraite. Le tableau est complet; chaque type social y figure, peuple des campagnes et des villes, aubergistes, brigands, barbiers, tailleurs, alguazils, comédiens, écrivains, domestiques, intendants, secrétaires, riches bourgeois, petits nobles, hobereaux de province, grands seigneurs, ecclésiastiques, ministres, jusqu'au roi d'Espagne Philippe IV. Comme fera Balzac 7, Lesage offre plusieurs variantes d'un même type : Gil Bias « l'aventurier s, ainsi que l'appelle Lorença Sephora, le « picaro s, comme le nomme Olivarès, est doublé par Raphaël et par Scipion; l'aventurière Laure est escortée par Arsénie et Florimonde, par Lucinde, par Sirena, par Lucrèce, qui nous font passer de la courtisane à la fille vertueuse; les médecins sont représentés par Sangrado qui ordonne de l'eau à tous les malades, Cuchillo qui la leur interdit, Andros qui les purge pendant leur crise, Oquetos qui ne les purge qu'après; les ecclésiastiques, par le licencié Gil Perez, par le chanoine Sedillo, par l'archevêque de Grenade; les groupes sont montrés dans leur vie collective, voleurs dans leur repaire, mondains dans le salon de la marquise de Chaves, petits-maîtres au cabaret et domestiques qui les imitent, comédiens au foyer du théâtre, écrivains au café A ... La peinture est réaliste, sans longues descriptions; Lesage ne s'intéresse ni au paysage, ni à l'architecture, mais il fait voir les meubles, les costumes, saisit les gestes, les attitudes, les paroles qui ne sont pas les mêmes chez un barbier ou un hôtelier que chez un petit-maître ou une comédienne; la psychologie des personnages est déterminée par leur condition : la gouvernante de Sedillo gave son maître et est jalouse des autres domestiques; le
·'Celui que la crittque universitaire française et même certains romanciers du xixe et du xxe siècle ont considéré comme le créateur du roman de mœurs a placé l'action de presque toutes ses œuvres romanesques dans un cadre espagnol, sans être jamais allé en Espagne. Le fait est significatif de ce qu'est le réalisme romanesque jusqu'aux environs de 1760 : la transposition fantaisiste d'une expérience. Bons observateurs, mais en général hommes de lettres sans racines, journalistes besogneux, les romanciers réalistes de cette époque compensent l'instabilité de leur existence par la légèreté avec laquelle ils s'en accommodent. Ils dénoncent les ridicules sans les attaquer de front, ils exercent leur liberté de jugement par l'intermédiaire d'un certain irréalisme.

«
L'Espa gne du début du xvne siècle est donc pour Lesage la France du début
du xvme, du moins dans les deux romans où il s'éloigne le plus des originaux
espagnols , Le Diable boiteux et l'H istoire de Gil Bias de Santill ane.
Mais alors que
le premier est encore par l'inc ertitude du dessein un roman semblable aux romans
réalistes que nous avons décrits dans le chapitre précédent, Gil Bias veut être un
grand roman bien construit, un tableau général de la vie sociale.
" Le Diable boiteux " Ce
roman parut en 1707 et fut prof ondément
remanié dans sa troisième édition, en 1726.
La fiction conductrice est inspirée du Diablo Cojuelo, roman de l'espagnol Guevara
(16 41), et plusieurs récits ou anecdotes sont empruntés à d'autres écrivains, Francisco
Santos, Fr.
de Rojas, etc.
En 1726 Lesage introduisit un élément de continuité
dans l'œuvre en prêtant à l'éc olier Cléof as, interlocuteur du diable Asmodée, une
histoire très sommairement analogue à celle de tant de parvenus qui sont des
héros de romans au xvme siècle, comme Gil Blas lui-même : le pauvre écolier,
aidé par la chance et la ruse, fait au dénouement un riche mariage qui l'introduit
dans la haute société.
Mais dans la version originale le seul ressort de l'action, le
seul principe d'enchaînement des épisodes est l'amitié d'Asmodée pour Cléofas
et la curiosité de celui-ci, qui tantôt excite Asmodée à répondre, tantôt est pro
voquée par une remarque d'Asmodée.
Aussi le dialogue des deux comparses est-il très artificiel ; Lesage en varie ·
maladroitement les formules : >, dit le diable, ou bien :
>, ou encore : >; et l'écolier : >,ou bien : ,ou encore : >.
Les réflexions et croquis auraient pu rester juxtaposés,
comme dans les Caractères de La Bruyère, mais Lesage a pensé avec raison que
la forme romanesque donnerait une unité d'intérêt et de signifcation à cette matière
première de moralis te ; il n'y a pas parfaitement réussi.
Asmodée a beau se dépenser
à fa ire j ail les anecdotes et les portraits à la suite les uns des autres (>,>,,
« Il faut que je vous fasse rire ...
)>) , on s'étonne que l'attention de Cléof as soit toujours
aussi alerte; le diable l'encourage : et qu'il ne regrettera rien2•
Le public aimait ces traits de mœurs, ces anecdotes, ces portraits rapides,
ces pointes satiriques, qui feront quelques années plus tard le succès des Lettres
Persanes (1721).
Les nouvelles romanesques dont Asmodée entremêle ses histo
riettes, et qui présentent tous les éléments de la tradition, passions tragiques,
duels, méprises, enlèvements, épisodes barbaresques, etc., faisaient les deux tiers
du volume dans la première édition, et en font moins de la moitié dans l'édition
de 1726.
Lesage ne croit guère au romanesque ; il le fera encore alterner avec le
1.
Chapitre IX, p.
157 de l'édition Garnier.
2.
Chapitre XIX, p.
336..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours
- ARTHUR et la légende arthurienne (Histoire de la littérature)
- OVIDE MORALISÉ (Histoire de la littérature)