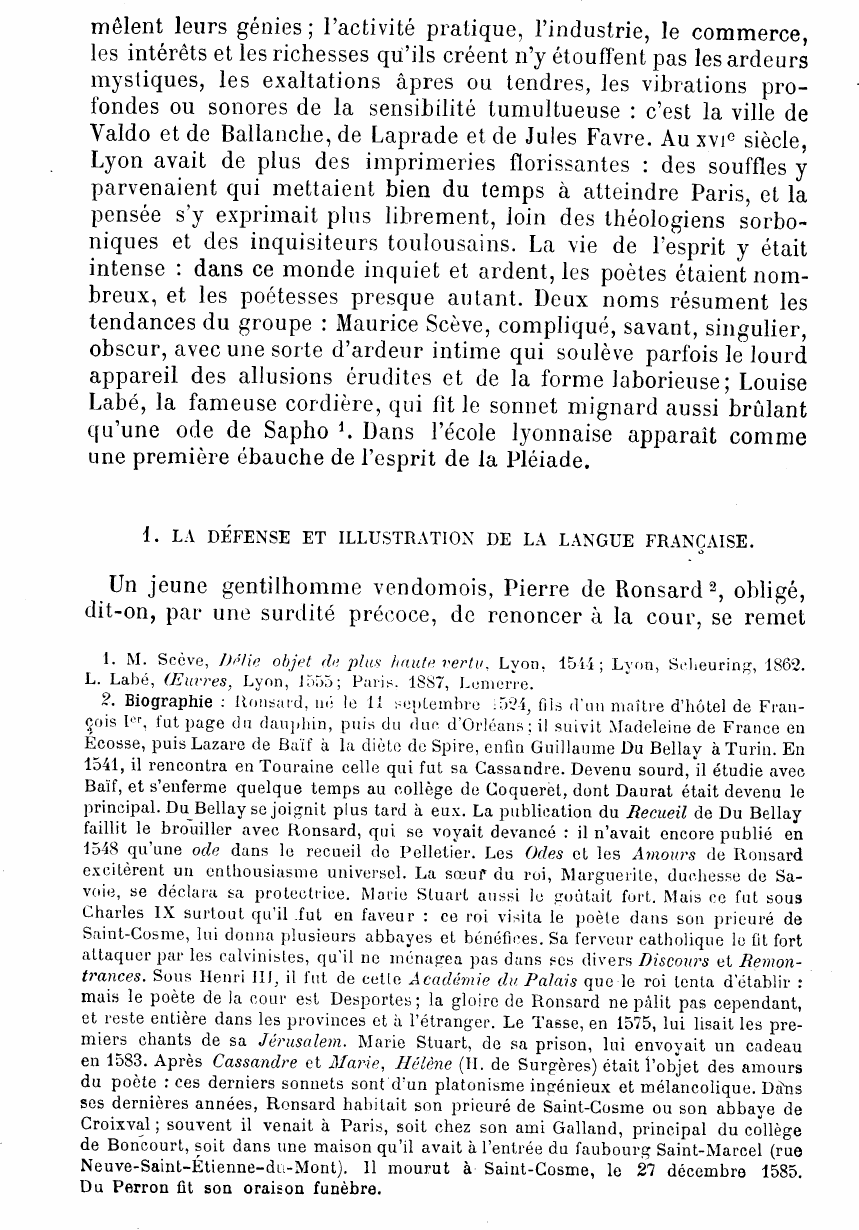LES THÉORIES DE LA PLÉIADE
Publié le 02/06/2012
Extrait du document
Il est toujours fâcheux pour des poètes de travailler sur des théories arrêtées à l'avance, et de réduire leur génie à l'application méthodique d'un système : mieux vaut que les oeuvres fassent naître les théories. Dans la réforme de Ronsard, la critique accompagna et même précéda l'inspiration: Du Bellay lança en 1549 sa Defense et lllustmtion de la langue française, qui est tout à la fois un pamphlet, un plaidoyer et un art poétique, oeuvre brillante et facile, parfois même éloquente et chaleureuse, le premier ouvrage enfin de critique littéraire qui compte dans notre littérature, et le plus considérable jusqu'à Boileau. Ronsard, moins impatient que son ami, et plus a1·tiste en ce sens qu'il s'efforça de réaliser, non de définir son idéal, a semé pourtant ses théories dans ses Préfaces des Odes et de la Franciade, ainsi que dans un Abregé d'art poétique qu'il donna en f565. En elles-mèmes ces théories n'ont rien d'aussi extravagant qu'on a dit quelquefois : dans l'ensemble, et pour l'essentiel, elles représentent assez bien ce qui s'est fait, même après Ronsard, ce qui lui a survécu pour être la substance et la forme de notre poésie moderne.
«
272 .
POÉSIE ÉRUDITE ET ARTISTIQUE.
mêlent leurs génies; l'activité pratique, l'industrie, le commerce,
les intérêts et les richesses qu'ils créent n'y étoufl'ent pas les ardeurs mystiques, les exaltations âpres ou tendres, les vibrations pro fondes ou sonores de la sensibilité tumultueuse : c'est la ville de
Valdo et de Ballanclie, de Laprade et de Jules Favre.
Au xv tc siècle,
Lyon avait de plus des imprimeries floris5antcs : des souffles y parvenaient qui mettaient bien du temps â atteindre Paris, et la pensée s'y exprimait plus librement, loin des théologiens sorbo
niques et des inquisiteurs toulousains.
La vie de l'esprit y était
intense : dans ce monde inquiet et ardent, les poètes étaient nom breux, et les poétesses presque autant.
Deux noms résument les tendances du groupe : Maurice Scève, compliqurl, savant, singulier,
obscur, avec une sorte d'ardeur intime qui soulève parfois le lourd appareil des allusions érudites et de la forme laborieuse; Louise
Labé, la fameuse cordière, qui fit le sonnet mignard aussi brûlant qu'une ode de Sapho 1
• Dans l'école lyonnaise apparaît comme une première ébauche de l'esprit de la Pléiade.
f.
LA DÉFE:\'SE ET ILLVSTR,\TIO:\' DE LA LAKGL'E FRANÇAISE.
Un jeune gentilhomme vendomois, Pierre de Ronsard 2
, ohligé,
dit-on, pal' unLl surdité pré,~occ, de renoncer à la cour, se remet
1.
M.
Srève, /Jt;/ie ohjf'f d1? plus luwte 1·ert11.
Lyon: 1rri-i; Lyon, SclJeuring, H-162.
L.
Labé, U!:urres, Lynn, E,;ù; P:u·i:-;.
18.S7, Lum(_~rre.
2.
Biographie: HrHbard, 1u! le~ 11 ~f~plemhru :~,:!-1, 01:3 d'un mnîlre d'hôtel de Frau çnis t~·r~ fut puge dn danjdJin, puis du du('.
ll'Orlt·~an:-;; il suivit :adelcine de Franec en f~cosse, pub Lazare de B;df i:L la dièt(~ de Spire, enfin Guillamn8 Du Bellay à Turin.
En 1541, il rencontra en Totuaine celle qui fut sa Cassandt·e.
Devenu sourd, il étudie avec Baïf, et s'enferme quelque temps au eollège de Coqueret, dont Daurat était devenu le principal.
Du Bellay sc joignit plus tard à eux.
La puhlkation du Recueil de Du Bellay faillit le brolliller avec Ronsard, qui ::;o voyait devancé : il n'avait encore publié en 1;:)48 qu'une ode dans le recueil de Pelletier.
Les Odes ct les Amours de Ronsard excitèrent un cnthousia~mc universel.
La sœur du roi, l\larguerile.
Ùu(•.hesse de Sa voi~~.
::;e déclar·a ~a protcett·iee.
l\lol'iu Stuart an~~i le goôtait fnrt.
Mais ('0 fut sous Charles IX surtout qu'il Jut en faveur: co roi visita le poèle dans son prieuré de S1tinl-Cosme, lni clouna plusieurs abbayes ct héwSfi~·es.
Sa fcrYeur catholique le fit fort attaquer pa1· les ('alYilli~tes, qu'il ne nu~nag-en pas dans :-cs divers Discours et Remon trances.
Sous Henri III: il fut de celle .AcadJrnie du Palais que le roî tenta d'établir: mais le poète de la cout· e~l Desportes; la gloire de Honsard ne pùlit pas cependant, et re~te enlière dans les provinces et ü l'étrange!'.
Le Tasse, en 1575, lui lisait les pre miers chants de sa Jérusolern.
Marie Stuart, de sa prison, lui envoyait un cll.deau en 1583.
Après Cassandre et 1lfar.ie, IINène (II.
de Surgères) était l'objet des amours du poète ~ces derniers sonnets sont d'un platonisme ing-énieux et mélancolique.
Dit'ns ses dernières années, Ronsard habitait son prieuré de Saint-Cosme ou son abbaye de Croixval; souvent il venait à Paris, soiL chez son ami Galland, principal du collège de Bon-court, soit dans une maison qu'il avait à l'entrée du faubourg Saint-Marcel (rue Neuve-Sainl-Élienne-du-Monl).
Il mourut à Saint-Cosme, le 27 décembre 1585.
Du Perron fit son oraison funèbre..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- théories philosophique sur l'art
- Le renouvellement des théories scientifiques doit-il faire douter de la science?
- PLÉIADE (la)
- THEME 1 : L'ETAT Leçon 2 : Les théories de l'Etat
- Esquirol, Des maladies mentales (extrait) Élève de Philippe Pinel, Esquirol a développé et affiné les théories de son maître.