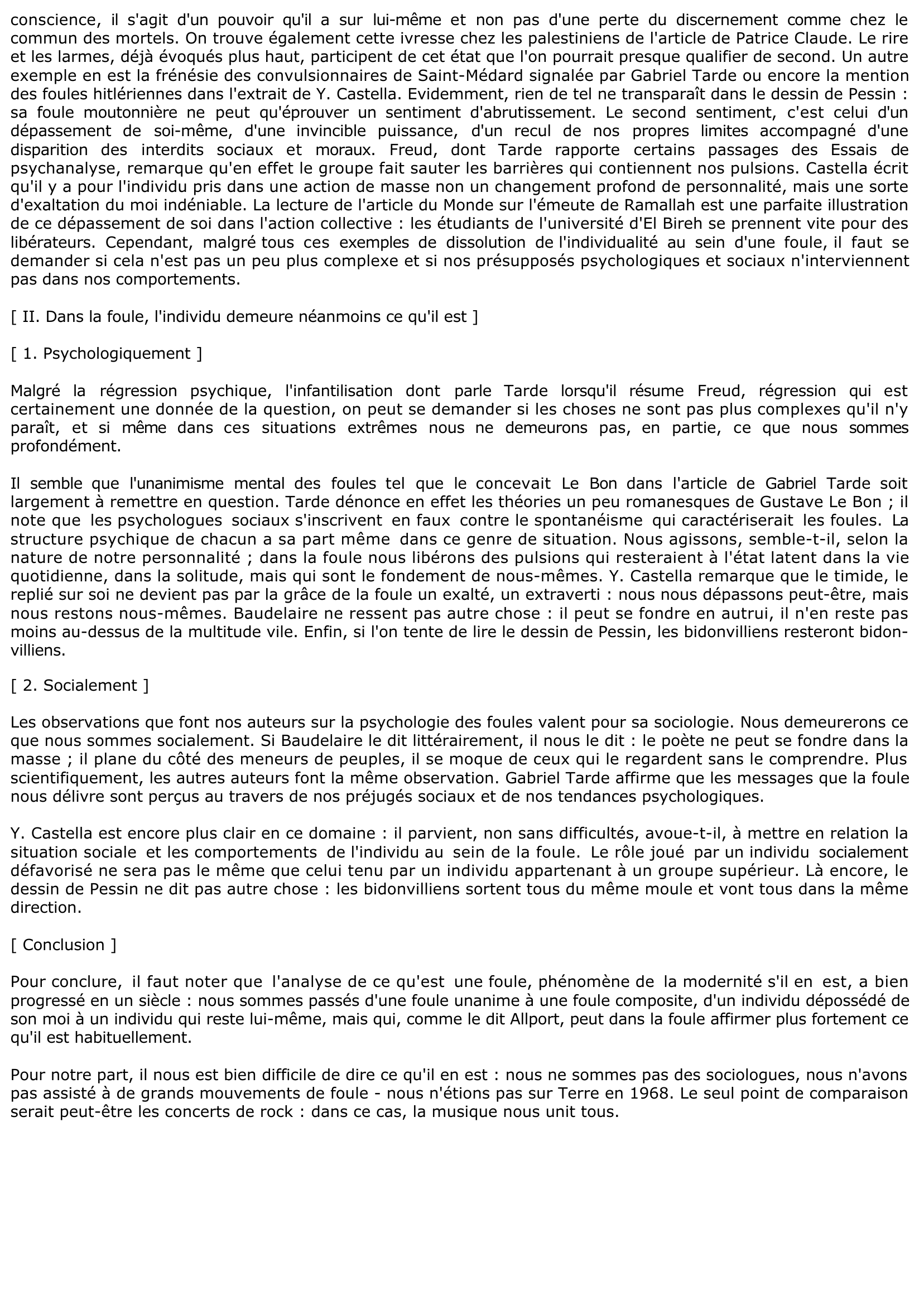Les rapports de l'individu avec la foule
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
conscience, il s'agit d'un pouvoir qu'il a sur lui-même et non pas d'une perte du discernement comme chez lecommun des mortels.
On trouve également cette ivresse chez les palestiniens de l'article de Patrice Claude.
Le rireet les larmes, déjà évoqués plus haut, participent de cet état que l'on pourrait presque qualifier de second.
Un autreexemple en est la frénésie des convulsionnaires de Saint-Médard signalée par Gabriel Tarde ou encore la mentiondes foules hitlériennes dans l'extrait de Y.
Castella.
Evidemment, rien de tel ne transparaît dans le dessin de Pessin :sa foule moutonnière ne peut qu'éprouver un sentiment d'abrutissement.
Le second sentiment, c'est celui d'undépassement de soi-même, d'une invincible puissance, d'un recul de nos propres limites accompagné d'unedisparition des interdits sociaux et moraux.
Freud, dont Tarde rapporte certains passages des Essais depsychanalyse, remarque qu'en effet le groupe fait sauter les barrières qui contiennent nos pulsions.
Castella écritqu'il y a pour l'individu pris dans une action de masse non un changement profond de personnalité, mais une sorted'exaltation du moi indéniable.
La lecture de l'article du Monde sur l'émeute de Ramallah est une parfaite illustrationde ce dépassement de soi dans l'action collective : les étudiants de l'université d'El Bireh se prennent vite pour deslibérateurs.
Cependant, malgré tous ces exemples de dissolution de l'individualité au sein d'une foule, il faut sedemander si cela n'est pas un peu plus complexe et si nos présupposés psychologiques et sociaux n'interviennentpas dans nos comportements.
[ II.
Dans la foule, l'individu demeure néanmoins ce qu'il est ]
[ 1.
Psychologiquement ]
Malgré la régression psychique, l'infantilisation dont parle Tarde lorsqu'il résume Freud, régression qui estcertainement une donnée de la question, on peut se demander si les choses ne sont pas plus complexes qu'il n'yparaît, et si même dans ces situations extrêmes nous ne demeurons pas, en partie, ce que nous sommesprofondément.
Il semble que l'unanimisme mental des foules tel que le concevait Le Bon dans l'article de Gabriel Tarde soitlargement à remettre en question.
Tarde dénonce en effet les théories un peu romanesques de Gustave Le Bon ; ilnote que les psychologues sociaux s'inscrivent en faux contre le spontanéisme qui caractériserait les foules.
Lastructure psychique de chacun a sa part même dans ce genre de situation.
Nous agissons, semble-t-il, selon lanature de notre personnalité ; dans la foule nous libérons des pulsions qui resteraient à l'état latent dans la viequotidienne, dans la solitude, mais qui sont le fondement de nous-mêmes.
Y.
Castella remarque que le timide, lereplié sur soi ne devient pas par la grâce de la foule un exalté, un extraverti : nous nous dépassons peut-être, maisnous restons nous-mêmes.
Baudelaire ne ressent pas autre chose : il peut se fondre en autrui, il n'en reste pasmoins au-dessus de la multitude vile.
Enfin, si l'on tente de lire le dessin de Pessin, les bidonvilliens resteront bidon-villiens.
[ 2.
Socialement ]
Les observations que font nos auteurs sur la psychologie des foules valent pour sa sociologie.
Nous demeurerons ceque nous sommes socialement.
Si Baudelaire le dit littérairement, il nous le dit : le poète ne peut se fondre dans lamasse ; il plane du côté des meneurs de peuples, il se moque de ceux qui le regardent sans le comprendre.
Plusscientifiquement, les autres auteurs font la même observation.
Gabriel Tarde affirme que les messages que la foulenous délivre sont perçus au travers de nos préjugés sociaux et de nos tendances psychologiques.
Y.
Castella est encore plus clair en ce domaine : il parvient, non sans difficultés, avoue-t-il, à mettre en relation lasituation sociale et les comportements de l'individu au sein de la foule.
Le rôle joué par un individu socialementdéfavorisé ne sera pas le même que celui tenu par un individu appartenant à un groupe supérieur.
Là encore, ledessin de Pessin ne dit pas autre chose : les bidonvilliens sortent tous du même moule et vont tous dans la mêmedirection.
[ Conclusion ]
Pour conclure, il faut noter que l'analyse de ce qu'est une foule, phénomène de la modernité s'il en est, a bienprogressé en un siècle : nous sommes passés d'une foule unanime à une foule composite, d'un individu dépossédé deson moi à un individu qui reste lui-même, mais qui, comme le dit Allport, peut dans la foule affirmer plus fortement cequ'il est habituellement.
Pour notre part, il nous est bien difficile de dire ce qu'il en est : nous ne sommes pas des sociologues, nous n'avonspas assisté à de grands mouvements de foule - nous n'étions pas sur Terre en 1968.
Le seul point de comparaisonserait peut-être les concerts de rock : dans ce cas, la musique nous unit tous..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans une de ses «Lettres à Angèle» (1898-1900), reprises dans Prétextes, André Gide conseille à un poète de se méfier d'«une idolâtrie grave, que certains enseignent aujourd'hui» et qui est «celle du peuple, de la foule». Et il ajoute un peu plus loin que «la communication (avec les foules) ne s'obtient que sur les points les plus communs, les plus grossiers et les plus vils. Sympathiser avec la foule, c'est déchoir». Et il s'objecte sans doute à lui-même qu'il y a des cas où la créati
- Étudiez ce texte de A. Renaudet (Dictionnaire des Lettres françaises, XVIe siècle, sous la direction de Mgr Grente, Fayard, 1951) : «L'humanisme est une éthique de confiance en la nature humaine. Orienté à la fois vers l'étude et la vie, il prescrit pour but et pour règle, à l'individu comme à la société, de tendre sans cesse vers une existence plus haute. Il commande à l'homme un effort constant pour réaliser en lui le type idéal de l'homme, à la société un effort constant pour réalis
- La foule rend-elle l'individu plus fort ?
- éduquer un individu est ce porter atteinte a sa liberté ?
- La Princesse de Clèves, Mme de Lafayette, Parcours : Individu, morale et société Texte 2 : L'AVEU