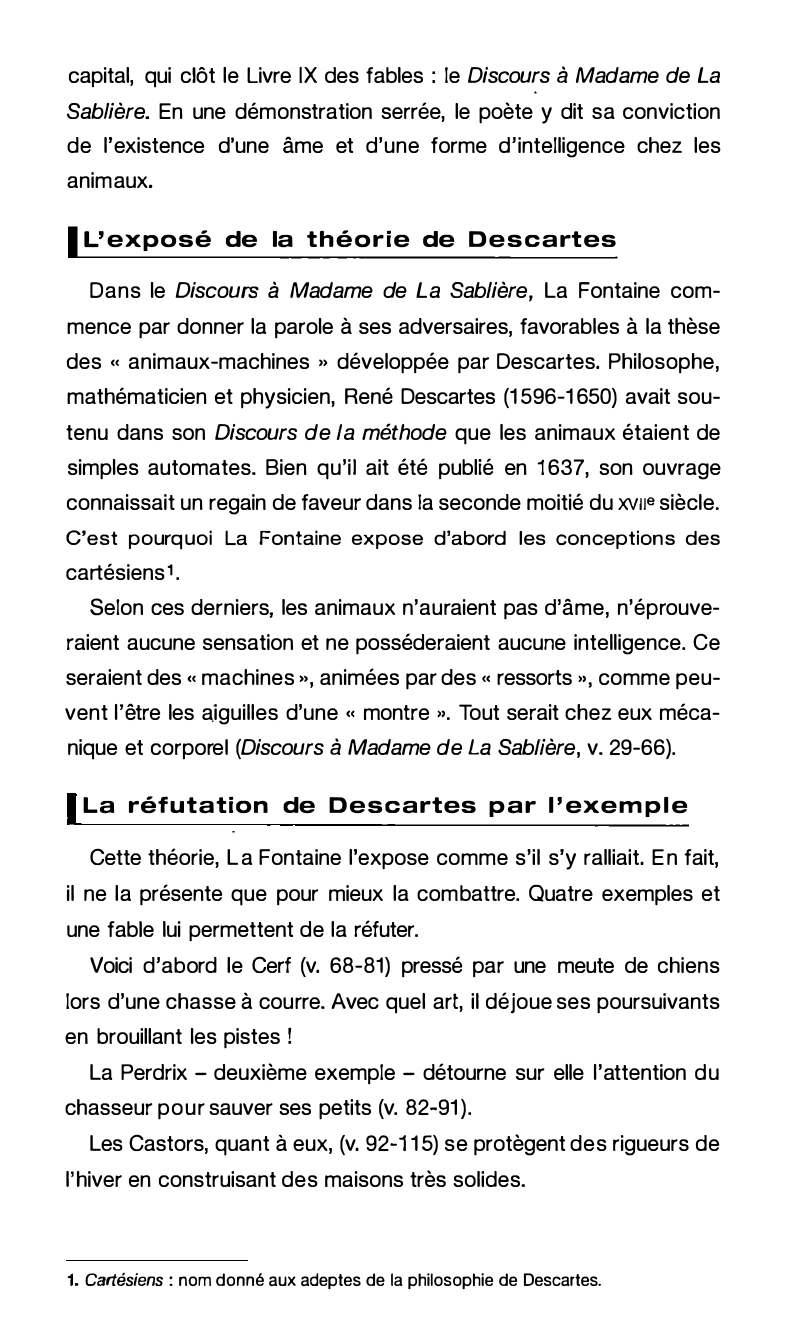Les questions philosophiques et religieuses dans les Fables de La Fontaine
Publié le 12/09/2019
Extrait du document
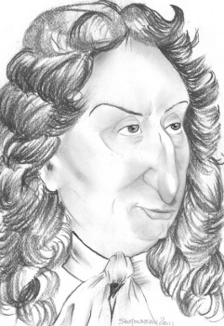
Si tout est atome, d'où proviennent la multiplicité et la complexité croissante des formes vivantes ? De combinaisons différentes des atomes. La particule de base est partout la même, mais J'agrégat de ces atomes donne naissance à la diversité.
À la différence toutefois des philosophes matérialistes, La Fontaine croit que ces combinaisons dépendaient de l'action d'une « certaine âme universelle » (Discours à Madame de La Sablière, fin du Livre IX). Quand cette action est faible, elle produit les règnes minéral et végétal. Lorsqu'elle est plus forte, elle crée Je règne animal. Quand elle est encore plus nette, elle aboutit à la formation de l'homme.
Pour La Fontaine, un même et immense principe vital parcourt et anime la nature, selon une hiérarchie et des degrés qui vont du plus élémentaire au plus élaboré 1. Au sommet de cette hiérarchie du vivant se trouve l'homme. Mais, pour occuper la place supérieure, celui-ci n'en demeure pas moins un chaînon de J'ensemble. Parce qu'il participe, comme les plantes et les animaux, de cette « âme universelle \"• il leur doit respect et protection. C'est ce que les animaux, lorsqu'ils instruisent le procès de l'homme2, lui rappellent sans cesse et, hélas, toujours en vain.
Le Livre Xli offre toutefois une tonalité nettement plus chrétienne. La vieillesse, la maladie et la disparition d'amis chers1 ne sont sans doute pas étrangères à ce phénomène. La dernière fable du Livre Xli, Le Juge arbitre, l'Hospitalier et le Solitaire {Xli, 29) constitue le testament spirituel de La Fontaine.
Or les trois personnages que campe la fable sont des saints, qui œuvrent au salut de leur âme et à celui de leurs frères humains. La vertu chrétienne de \" charité » (v. 17) y apparaît, ainsi que la notion de vie éternelle (v. 1). La fonction de juge bénévole que remplit le \" Juge arbitre », l'aide aux mourants à laquelle se dévoue l'« Hospitalier » étaient à l'époque des activités assumées par des congrégations religieuses. Quant au \" Solitaire >■• il évoque ceux qui consacraient leur existence à la prière.
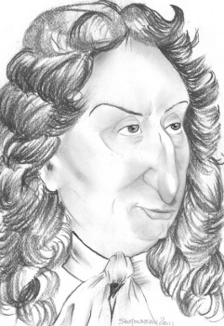
«
capital, qui
clôt le Livre IX des fables : le Discours à Madame de La
Sablière.
En une démons tration serrée, le poète y dit sa conviction
de l'e xistence d'une âme et d'une forme d'intelligence chez les
anim aux.
L' exposé de la théorie de Descar tes
Dans le Discours à Madame de La Sablière , La Fontaine com
mence par donner la parole à ses adversaires, favorables à la thèse
des " anim aux-machines , développée par Descartes.
Philosophe,
mathématicien et physicien, René Descartes (159 6-1 650) avait sou
tenu dans son Discours de la méthode que les animaux étaient de
simples automates.
Bien qu'il ait été publié en 1637, son ouvrage
connaissait un regain de fav eur dans la seconde moitié du xvu• siècle.
C'est pourquoi La Fontaine expose d'abord les conceptions des
cartésiens 1.
Selon ces dernie rs, les animaux n'auraient pas d'âme, n'éprouve
raient aucune sensation et ne posséderaient aucune intelligence.
Ce
seraient des " machines "• animées par des " ressorts "• comme peu
vent l'être les a.iguilles d'une " montre "· To ut serait chez eux méca
nique et corpor el (Di scours à Madame de La Sablière , v.
29-66).
La
réfutation de Descar tes par l'exe mple
Cette théorie, La Fontaine l'expose comme s'il s'y ralliait.
En fait,
il ne la présente que pour mieux la com battre.
Quatre exemples et
une fable lui permettent de la réfuter.
Voici d'abord le Cerf (v.
68-81) pressé par une meute de chiens
lors d'une chasse à cou rre.
Avec quel art, il déjoue ses poursuivants
en brouillant les pistes !
La Perdrix -deuxième exemple - détourne sur elle l'attention du
chasseur pour sauver ses petits (v.
82-91 ).
Les Castors, quant à eux, (v.
92-1 15) se protègent des rigueurs de
l' hiver en construisant des maisons très solides.
1.
Cartésiens : nom donné aux adeptes de la philosophie de Descartes..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Fontaine avait beaucoup de goût pour les lectures et discussions philosophiques. Il lisait, s'il faut l'en croire, Platon; il discutait le système de Descartes; il s'engouait, grâce à son ami Bernier, de la philosophie de Gassendi, etc. Dans quelle mesure, selon vous, peut-on trouver dans les Fables un intérêt philosophique ?
- Le pragmatisme dans les fables de La Fontaine
- LA FONTAINE: FABLES (résumé et analyse)
- Dissertation Fables de La Fontaine (livre VII)
- dissertation fables de La Fontaine: Mensonge et vérité