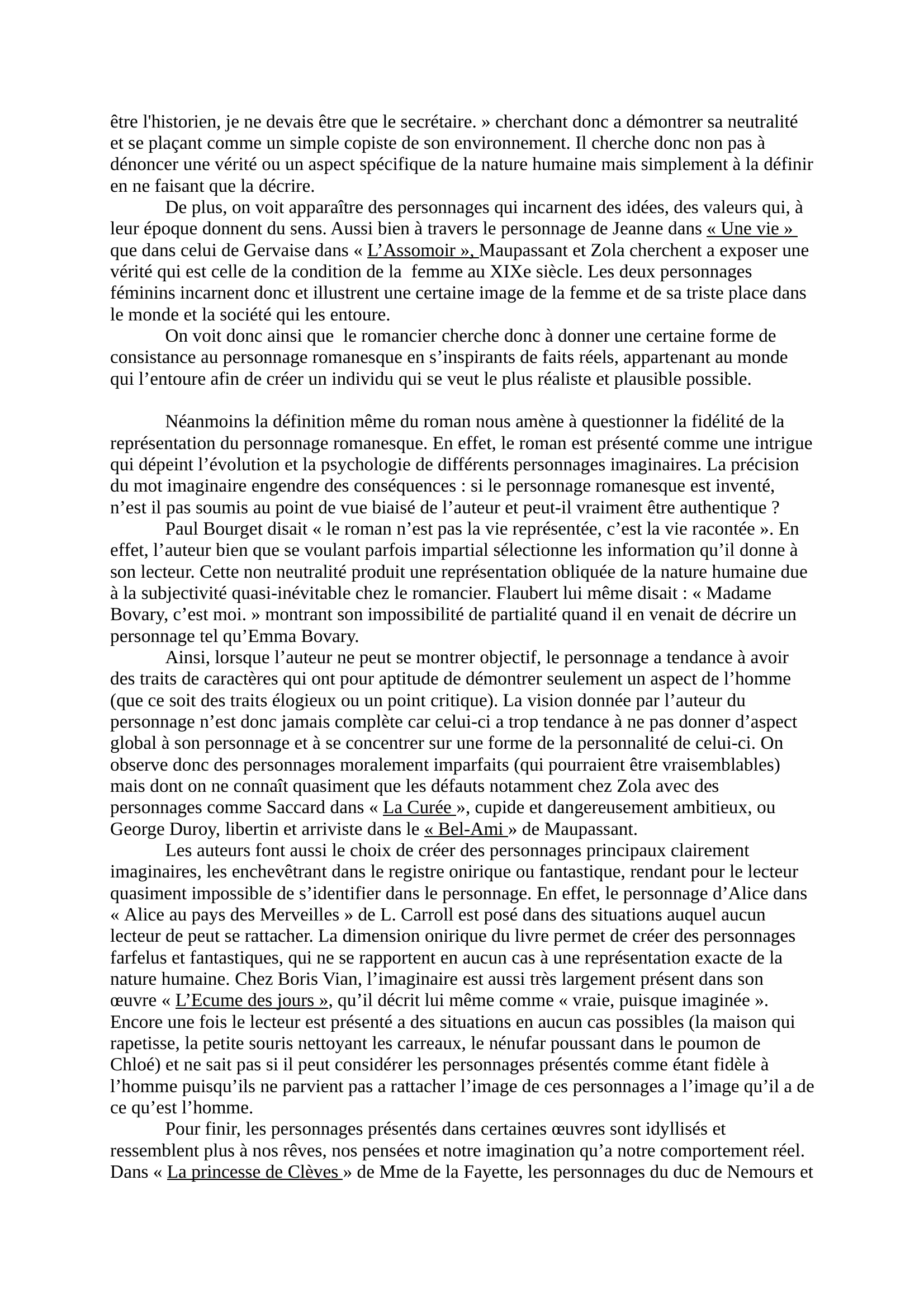Les personnages de roman sont-ils le reflet exact de ce que sont les hommes?
Publié le 02/11/2013
Extrait du document
«
être l'historien, je ne devais être que le secrétaire.
» cherchant donc a démontrer sa neutralité
et se plaçant comme un simple copiste de son environnement.
Il cherche donc non pas à
dénoncer une vérité ou un aspect spécifique de la nature humaine mais simplement à la définir
en ne faisant que la décrire.
De plus, on voit apparaître des personnages qui incarnent des idées, des valeurs qui, à
leur époque donnent du sens.
Aussi bien à travers le personnage de Jeanne dans « Une vie »
que dans celui de Gervaise dans « L’Assomoir », Maupassant et Zola cherchent a exposer une
vérité qui est celle de la condition de la femme au XIXe siècle.
Les deux personnages
féminins incarnent donc et illustrent une certaine image de la femme et de sa triste place dans
le monde et la société qui les entoure.
On voit donc ainsi que le romancier cherche donc à donner une certaine forme de
consistance au personnage romanesque en s’inspirants de faits réels, appartenant au monde
qui l’entoure afin de créer un individu qui se veut le plus réaliste et plausible possible.
Néanmoins la définition même du roman nous amène à questionner la fidélité de la
représentation du personnage romanesque.
En effet, le roman est présenté comme une intrigue
qui dépeint l’évolution et la psychologie de différents personnages imaginaires.
La précision
du mot imaginaire engendre des conséquences : si le personnage romanesque est inventé,
n’est il pas soumis au point de vue biaisé de l’auteur et peut-il vraiment être authentique ?
Paul Bourget disait « le roman n’est pas la vie représentée, c’est la vie racontée ».
En
effet, l’auteur bien que se voulant parfois impartial sélectionne les information qu’il donne à
son lecteur.
Cette non neutralité produit une représentation obliquée de la nature humaine due
à la subjectivité quasi-inévitable chez le romancier.
Flaubert lui même disait : « Madame
Bovary, c’est moi.
» montrant son impossibilité de partialité quand il en venait de décrire un
personnage tel qu’Emma Bovary.
Ainsi, lorsque l’auteur ne peut se montrer objectif, le personnage a tendance à avoir
des traits de caractères qui ont pour aptitude de démontrer seulement un aspect de l’homme
(que ce soit des traits élogieux ou un point critique).
La vision donnée par l’auteur du
personnage n’est donc jamais complète car celui-ci a trop tendance à ne pas donner d’aspect
global à son personnage et à se concentrer sur une forme de la personnalité de celui-ci.
On
observe donc des personnages moralement imparfaits (qui pourraient être vraisemblables)
mais dont on ne connaît quasiment que les défauts notamment chez Zola avec des
personnages comme Saccard dans « La Curée », cupide et dangereusement ambitieux, ou
George Duroy, libertin et arriviste dans le « Bel-Ami » de Maupassant.
Les auteurs font aussi le choix de créer des personnages principaux clairement
imaginaires, les enchevêtrant dans le registre onirique ou fantastique, rendant pour le lecteur
quasiment impossible de s’identifier dans le personnage.
En effet, le personnage d’Alice dans
« Alice au pays des Merveilles » de L.
Carroll est posé dans des situations auquel aucun
lecteur de peut se rattacher.
La dimension onirique du livre permet de créer des personnages
farfelus et fantastiques, qui ne se rapportent en aucun cas à une représentation exacte de la
nature humaine.
Chez Boris Vian, l’imaginaire est aussi très largement présent dans son
œuvre « L’Ecume des jours » , qu’il décrit lui même comme « vraie, puisque imaginée ».
Encore une fois le lecteur est présenté a des situations en aucun cas possibles (la maison qui
rapetisse, la petite souris nettoyant les carreaux, le nénufar poussant dans le poumon de
Chloé) et ne sait pas si il peut considérer les personnages présentés comme étant fidèle à
l’homme puisqu’ils ne parvient pas a rattacher l’image de ces personnages a l’image qu’il a de
ce qu’est l’homme.
Pour finir, les personnages présentés dans certaines œuvres sont idyllisés et
ressemblent plus à nos rêves, nos pensées et notre imagination qu’a notre comportement réel.
Dans « La princesse de Clèves » de Mme de la Fayette, les personnages du duc de Nemours et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Parlant du métier de romancier, François Mauriac écrit : « Les personnages fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes... Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde irréel grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et de pitié. » Expliquez, commentez et, si vous le
- Parlant du métier de romancier François MAURIAC écrit : « Les personnages fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes... Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde irréel grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre cœur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et de pitié ». Expliquez, commentez et, si vous le
- Parlant du métier de romancier, François Mauriac écrit : « Les personnages fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes... Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde irréel grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre cœur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et de pitié. » Expliquez, commentez et, si vous le
- Le roman et ses personnages: Le thème de tout roman, c'est le conflit d'un personnage romanesque avec des choses et des hommes qu'il découvre en perspective à mesure qu'il avance, qu'il connaît d'abord mal, et qu'il ne comprend jamais tout à fait.
- Parlant du métier de romancier François MAURIAC écrit : « Les personnages fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes... Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde irréel grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre cœur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et de pitié ». Expliquez, commentez et, si vous le j