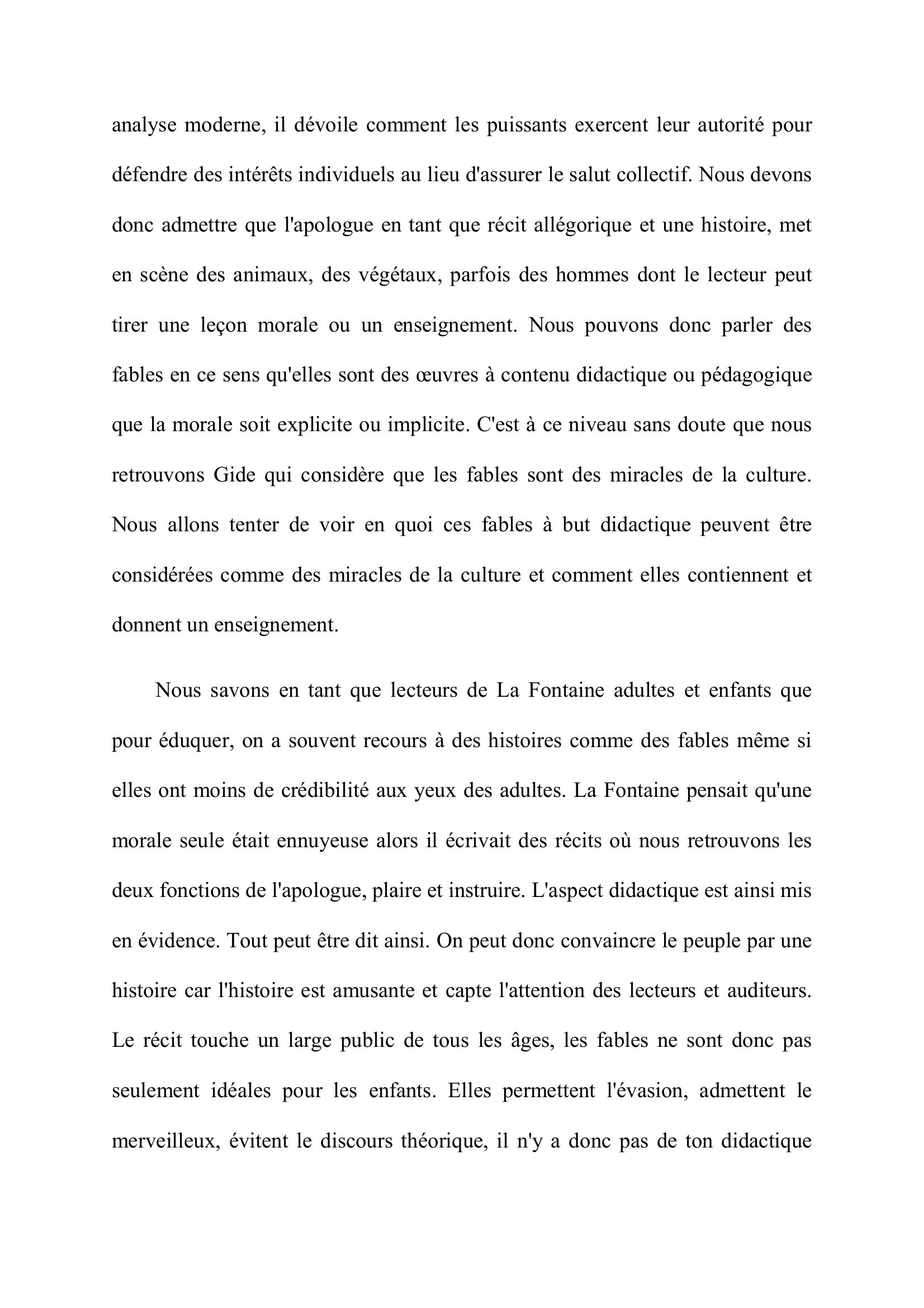Les fables de La Fontaine sont un miracle de la culture a écrit André Gide. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Publié le 03/03/2012
Extrait du document
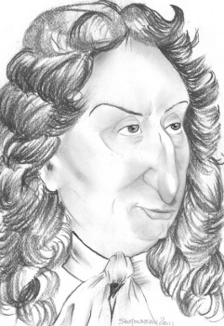
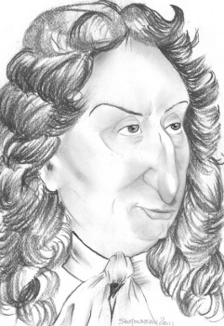
«
analyse moderne, il dévoile comment les puissants exercent leur autorité pour
défendre des intérêts individuels au lieu d'assurer le salut collectif.
Nous devons
donc admettre que l'apologue en tant que récit allégorique et une histoire, met
en scène des animaux, des végétaux, parfois des hommes dont le lecteur peut
tirer une leçon morale ou un enseignement.
Nous pouvons donc parler des
fables en ce sens qu'elles sont des œ uvres à contenu didactique ou pédagogique
que la morale soit explicite ou implicite.
C'est à ce niveau sans doute que nous
retrouvons Gide qui considère que les fables sont des miracles de la culture.
Nous allons tenter de voir en quoi ces fables à but didactique peuvent être
considérées comme des miracles de la culture et comment elles contiennent et
donnent un enseignement.
Nous savons en tant que lecteurs de La Fontaine adultes et enfants que
pour éduquer, on a souvent recours à des histoires comme des fables même si
elles ont moins de crédibilité aux yeux des adultes.
La Fontaine pensait qu'une
morale seule était ennuyeuse alors il écrivait des récits où nous retrouvons les
deux fonctions de l'apologue, plaire et instruire.
L'aspect didactique est ainsi mis
en évidence.
Tout peut être dit ainsi.
On peut donc convaincre le peuple par une
histoire car l'histoire est amusante et capte l'attention des lecteurs et auditeurs.
Le récit touche un large public de tous les âges, les fables ne sont donc pas
seulement idéales pour les enfants.
Elles permettent l'évasion, admettent le
merveilleux, évitent le discours théorique, il n'y a donc pas de ton didactique.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- André Gide écrit : « Notre littérature, et singulièrement la romantique, a louangé, cultivé, propagé la tristesse (...) Pour moi, je tiens pour impie le vers de Musset tant prôné : « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. » Êtes-vous d'accord avec cette prise de position ? Appuyez-vous sur des exemples précis.
- « Une fable de La Fontaine est toujours un monde en raccourci », écrit Léon-Paul Fargue (Tableau de la littérature française, 1939). Vous apprécierez ce jugement à la lumière des fables que vous avez étudiées. ?
- « La fable pour La Fontaine n'a été le plus souvent qu'un prétexte au récit, au conte, à la rêverie; la moralité s'y ajuste à la fin comme elle peut,», écrit le critique Sainte-Beuve (Lundis, VII). A la lumière des fables que vous avez étudiées, vous direz si vous partagez ce jugement. ?
- « Les Fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste du vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant », écrit, en 1849, Lamartine dans la préface à la réédition de ses Premières méditations. Vous commenterez ce jugement en vous appuyant sur les fables que vous avez étudiées. ?
- « Les longs ouvrages me font peur», écrit La Fontaine dans l'Épilogue du Livre VI. A la lumière des fables contenues dans les Livres VII à XII, vous direz en quoi cette confidence du fabuliste éclaire son art poétique. ?