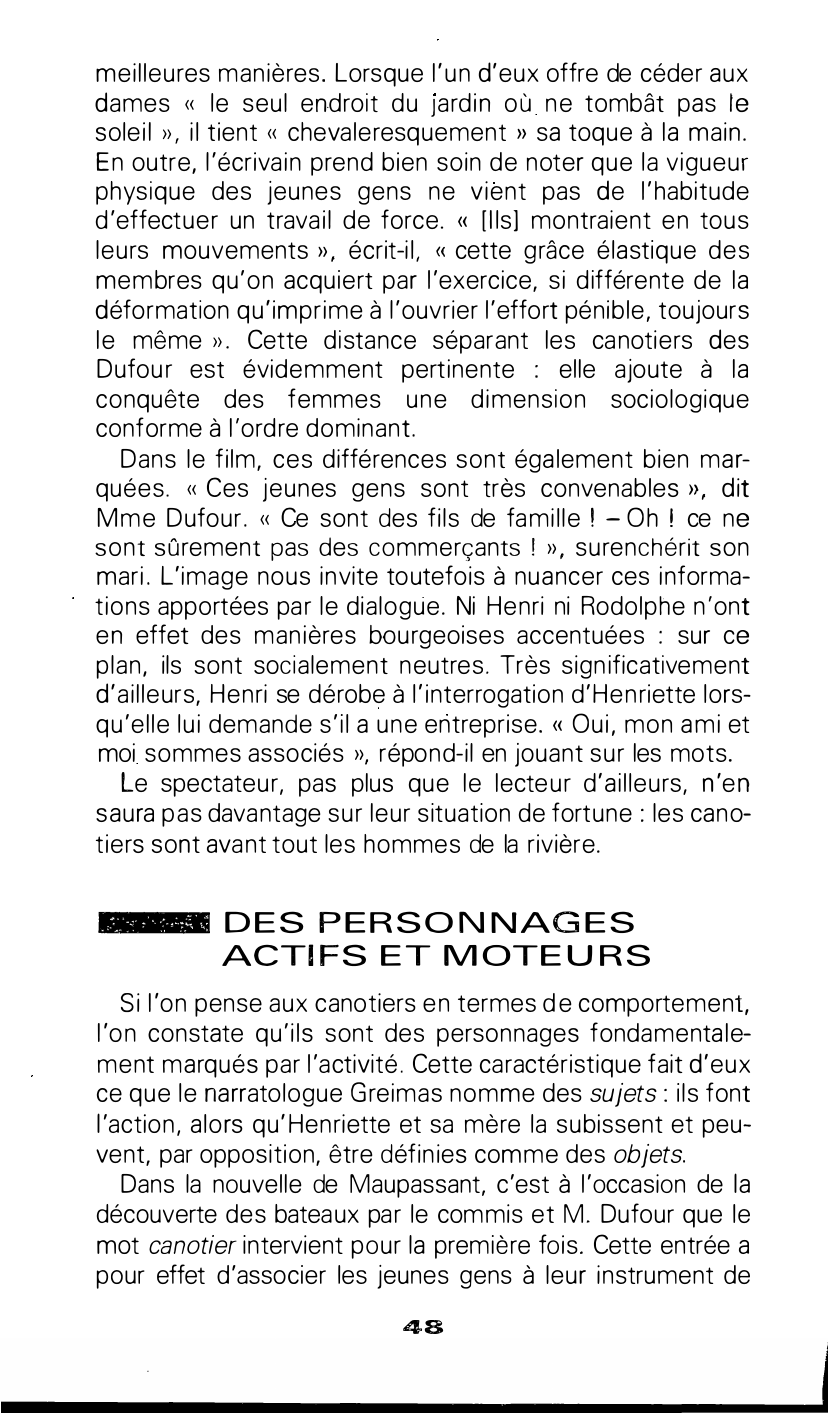Les canotiers dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
Publié le 05/12/2019
Extrait du document
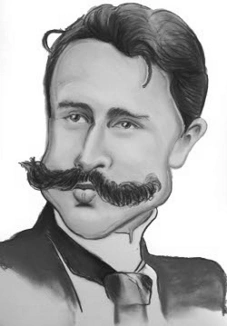
navigation, de faire d'eux des êtres de vitesse et de passage. En outre, le quincaillier situe immédiatement la relation avec les canotiers dans un cadre concurrentiel en rappelant qu'a utrefo is il « rossait » les Anglais en course à Joinville.
Dès lors, tout, pour ainsi dire, coule de source. Lorsque les canotiers paraissent au paragraphe suivant. leur fonction de compétiteurs se confirme : ils occupent le terrain convoité par la famille Dufour et ne le céderont que parce qu'ils se mettent en chasse en aperceva nt la jolie Henriette.
Les éléments descriptifs qui se rapportent aux canotiers vont également dans le même sens. C'est en effet la mobilité et la virilité agressive qui sont privilégiées. De leur corps, l'écrivain retient ainsi tout particulièrement ce qui sert au canotage, les bras et le souffle, donnant en quelque sorte l'image d'une spécialisation physique. Par deux fois, leur poitrine est mentionnée ; et. à la seconde occurrence, un geste de défi aux fortes connotations animales est adressé au mari : « Ils tapèrent violemment sur leur poitrine pour montrer quel son ça rendait ». Quant aux bras nus, « robustes comme ceux des forgerons », gênant la jeune fille et attirant le regard polisson de l'épouse, ils affichent clairement ici la virilité symbolique des deux hommes.
Au bord de l'eau se forme ainsi une société composite que Maupassant s'est souvent plu à décrire et qui comprend des employés de ministères, de' petits rentiers, des fils de famille, voire des artisans, et ces aristocrates du prolétariat que sont les ouvriers qualifiés.
Le milieu dominical des canotiers opère donc une double rupture : il affranchit les citadins des servitudes, notamment vestimentaires et comportementales, de la ville ; et il permet à des catégories sociales ordinairement étrangères les unes aux autres de se fréquenter. C'est très exactement la situation qui prévaut dans la nouvelle et dans le film.
Dans son texte, Maupassant accorde en effet une certaine importance à la question des origines sociales. Il est ainsi parfaitement clair dès le début que les deux canotiers sont moins populaires que les boutiquiers et qu'ils ont de
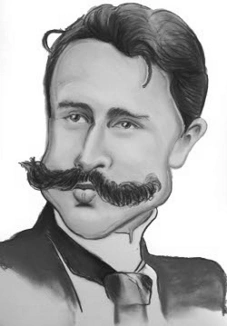
«
meilleur
es man ières .
Lor sque l'un d'eux offre de céde r aux
dames « le seul endroit du Jardin où ne tombât pas le
sol eil », il tient « chev aleresq uement >>sa toq ue à la main.
En outre, l'écriv ain prend bien soin de noter que la vigueur
phy sique des jeunes gens ne vient pas de l'habitude
d' effec tuer un trava il de force.
« [Ils] mon traient en tous
leur s mouvemen ts », écr it-il, « cette grâce élas tique des
mem bres qu'on acquier t par l'exer cice, si différe nte de la
dé formation qu'imprime à l'ouvrier l'effo rt pé nible, toujours
le même » .
Cette distance séparant les canotier s des
Du four est évidemmen t per tinen te : elle ajoute à la
conquê te des femmes une dimension sociologique
conforme à l'or dr e dominant.
Dans le film, ces diffé rences sont également bien mar
quées.
« Ces jeune s gens sont très convenables )), dit
Mme Du four.
« Ce sont des fils de famille ! -O h ! ce ne
sont sûrement pas des commer çants ! », sur enchér it son
mari .
L'image nous invite toutefo is à nua ncer ces informa
tions apportées par le dialogue.
Ni Henr i ni Rod olphe n'ont
en effet des manières bourgeoises accentuées : sur ce
plan, ils sont socialement neutr es.
Très significativ ement
d'ailleurs, Henri se dérobe à l'interr ogation d'Hen riette lors
qu' elle lui demande s'il a une entreprise.
« Oui, mon ami et
moi sommes associés », rép ond -il en jouant sur les mots.
Le spec tateur, pas plus que le lect eur d'ailleur s, n'en
saur a pas dava ntage sur leur situation de fortune : les cano
tier s sont avant tout les hommes de la rivière.
--�� DES PERS ONNAGES
ACTI FS ET MO TEURS
Si l'on pense aux canotier s en termes de compor temen t,
l' on con state qu'ils sont des per son nages fondamentale
men t mar qués par l'ac tivité .
Cette caracté ristique fait d'eux
ce que le na rrat ologue Greimas nomme des sujets : ils font
l' actio n, alor s qu' Hen riette et sa mère la su bissent et peu
ve nt, par oppos ition, être défin ies com me des objets.
Dans la nouv elle de Maup assant, c'est à l'occ asion de la
découver te des batea ux par le com mis et M.
Duf our que le
mo t ca not ier intervient pour la première fo is.
Cette entrée a
pour effet d'asso cier les jeunes gens à leur instru ment de
48.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L' impressionnisme chez Maupassant et Renoir dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Adaptation ou création ? dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Analyse comparée de la rencontre finale dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Résumés en parallèle dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Les personnages dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)