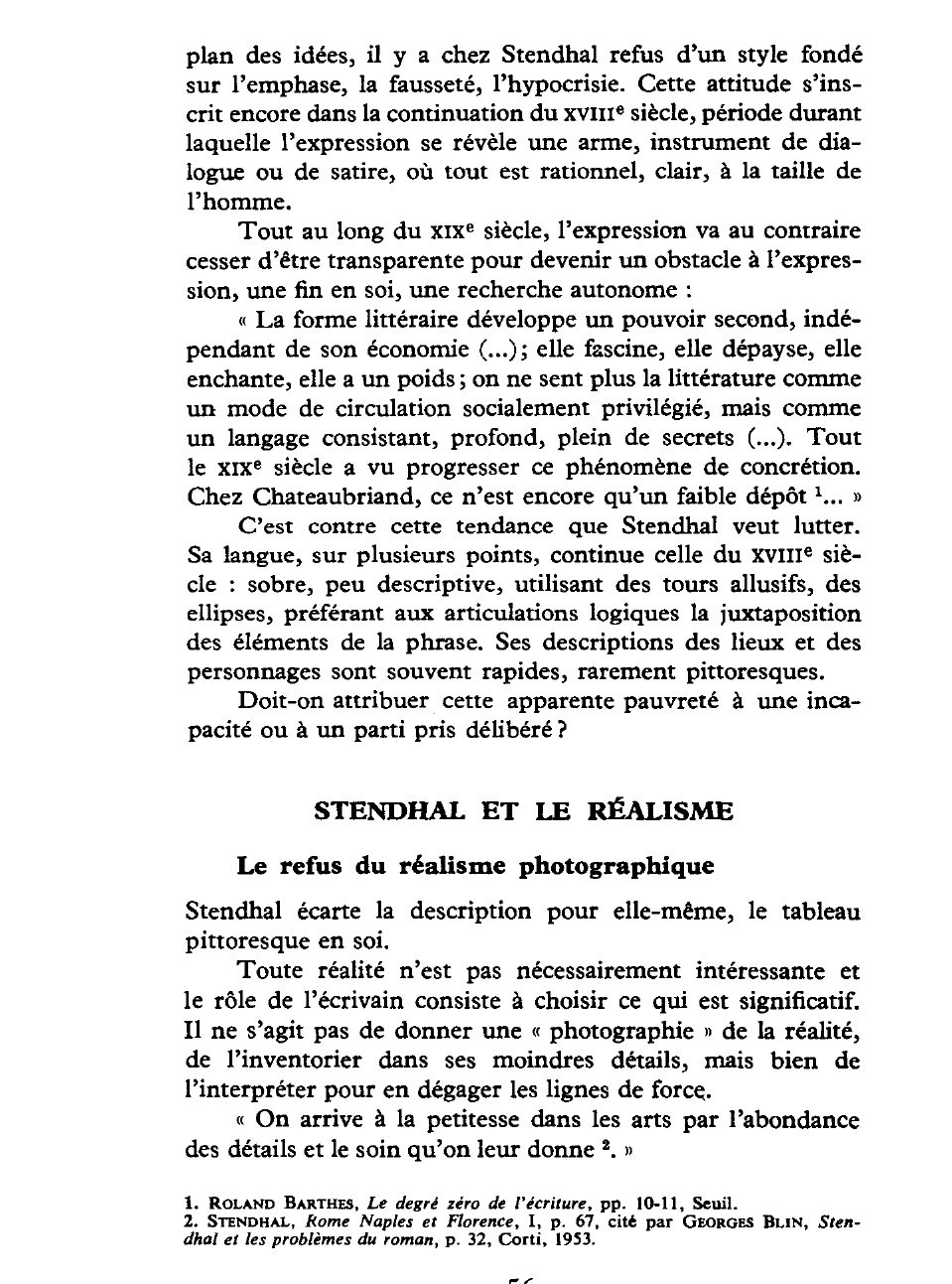Le travail de la forme chez Stendhal
Publié le 27/06/2015
Extrait du document


«
plan des idées, il y a chez Stendhal refus d'un style fondé
sur l'emphase, la fausseté, l'hypocrisie.
Cette attitude s'ins
crit encore dans la continuation du XVIII• siècle, période durant
laquelle l'expression se révèle une arme, instrument de dia
logue
ou de satire, où tout est rationnel, clair, à la taille de
l'homme.
Tout au long du XIX" siècle, l'expression va au contraire
cesser
d'être transparente pour devenir un obstacle à l'expres
sion,
une fin en soi, une recherche autonome :
" La forme littéraire développe un pouvoir second, indé
pendant de son économie ( ...
); elle f&scine, elle dépayse, elle
enchante, elle a
un poids; on ne sent plus la littérature comme
un mode de circulation socialement privilégié, mais comme
un langage consistant, profond, plein de secrets ( ...
).
Tout
le XIX" siècle a vu progresser ce phénomène de concrétion.
Chez
Chateaubriand, ce n'est encore qu'un faible dépôt 1 ••• n
C'est contre cette tendance que Stendhal veut lutter.
Sa langue, sur plusieurs points, continue celle du XVIII• siè
cle : sobre,
peu descriptive, utilisant des tours allusifs, des
ellipses,
préférant aux articulations logiques la juxtaposition
des éléments de la phrase.
Ses descriptions des lieux et des
personnages sont souvent rapides,
rarement pittoresques.
Doit-on attribuer cette apparente pauvreté à une inca
pacité
ou à un parti pris délibéré?
STENDHAL ET LE RÉALISME
Le refus du réalisme photographique
Stendhal écarte la description pour elle-même, le tableau
pittoresque en soi.
Toute réalité n'est pas nécessairement intéressante et
le rôle de l'écrivain consiste à choisir ce qui est significatif.
Il ne s'agit pas de donner une " photographie n de la réalité,
de l'inventorier
dans ses moindres détails, mais bien de
l'interpréter pour en dégager les lignes de fore~.
" On arrive à la petitesse dans les arts par l'abondance
des détails et le soin qu'on leur donne 2
• n
1.
ROLAND BARTHES, Le degré zéro de l'écriture, pp.
10-11, Seuil.
2.
STENDHAL, Rome Naples et Florence, I, p.
67, cité par GEORGES BLIN, Sten dhal et les problèmes du roman, p.
32, Corti, 1953.
-56-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le travail de la forme chez Stendhal
- Sujet : l'activité artistique est-elle une forme de travail ?
- Jules FERRY (1832-1893) Les « races supérieures » et les « races inférieures » La forme première de la colonisation, c'est celle qui offre un asile et du travail au surcroît des pays pauvres ou de ceux qui renferment une population exubérante.
- bois, travail du 1 PRÉSENTATION bois, travail du, mise en forme du bois pour créer, restaurer ou réparer des objets utiles ou décoratifs.
- Le travail est-il la seul forme d'intelligence ?