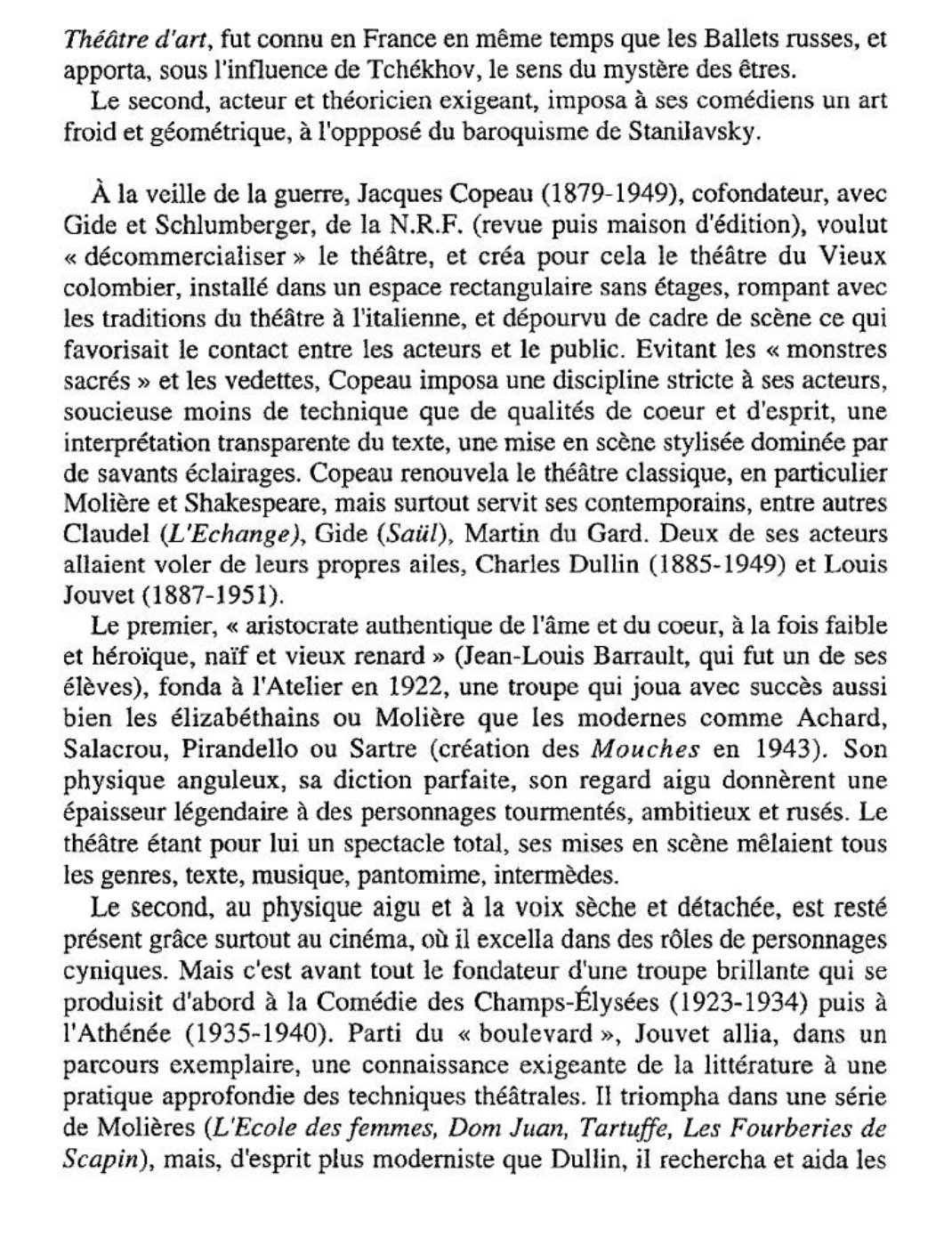LE THÉÂTRE DURANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES
Publié le 10/01/2020
Extrait du document
3 Les mythes antiques ressuscités
Cependant, le mouvement théâtral essentiel de l'entre-deux-guerres fut sans doute, à l'opposé, le retour à la tragédie et au mythe, dans le sillage du néoclassicisme. L'Antiquité, en effet féconda de façon inattendue et remarquable une grande partie de la culture de cette période, en réaction à tous les -ismes à la mode depuis plusieurs générations, du naturalisme et du symbolisme au surréalisme. C’est ainsi qu'en musique Igor Stravinsky, après sa période iconoclaste du Sacre du printemps (1913) revint aux règles traditionnelles et aux mythes grecs avec son ballet Apollon Musagète (1927) et ses opéras Oedipus rex et Perséphone (1927 et 1934) ; en peinture André Derain ou Giorgio de Chirico revinrent à la figuration et au mythe, en sculpture Bourdelle créa de nombreuses figures antiques dans un style solide et dépouillé (Héraclès) ; même l'architecture connut des « retours » analogues, comme en témoigne par exemple le Palais de Chaillot, construit pour l’Exposition de 1937.
Mais c'est bien évidemment au théâtre que le néoclassicisme connut une importance fondamentale. Issu d’un retour général à l'humanisme, dû en particulier à l'influence de la NRF, le retour à la tragédie et aux mythes ne signifie pas un académisme stérilisant, mais plutôt une manière neuve de parler des problèmes du temps présent, en réinterprétant les vieux mythes.
André Gide (1869-1951), plus connu comme romancier (La Symphonie pastorale, Les Faux monnayeurs, etc), ou comme autobiographe (Si le grain ne meurt), écrivit une tragédie biblique, Saül, et deux tragédies grecques, Candaule, jouée en 1901 par Lugné Poe, et Œdipe, où il cultive l'anachronisme et les allusions à Freud. Jean Cocteau (1889-1963), poète, cinéaste (Orphée), romancier (Les Enfants terribles), fut l'auteur d'une œuvre théâtrale abondante qui repose en grande partie sur la réinterprétation des mythes grecs (La Machine infernale, sur le thème d'Œdipe, Orphée, Antigone), médiévaux (Les Chevaliers de la table ronde, Renaud et Armide), ou modernes (L Aigle à deux têtes évoque la mort de Louis II de Bavière). Jean Anouilh (1910-1987) commençait une brillante carrière de dramaturge multiforme dans les années 30, avec ses pièces « roses » (Le Bal des voleurs) ou « noires », mais c'est avec Antigone ((1944) qu'il devait renouveler, comme Cocteau et Giraudoux, un mythe
«
Théâtre d'art, fut co nnu en France en même temps que les Ballets russes, et
apporta, sous l'influence de Tchékhov, le sens du mystère des êtres.
Le second, acteur et théoricien exigeant, imposa à ses comédiens un art
froid et géométrique, à l'opppo sé du baroquisme de Stanilavsky.
À la veille de la guerre, Jacques Copeau (1879-1949), cofondateur, avec
Gide et Schlumberger, de la N.R. F.
(revue puis maison d'édition), voulut
« décommercialiser » le théâtre, et créa pour cela le théâtre du Vieux
colombier, inst allé dans un espace rectangu lair e sans étages, rompant avec
les traditions du théâtre à l'italienne, et dépourvu de cadre de scène ce qui
favorisait le contact entre les acteurs et le publi c.
Evitant les « monstres
sacrés » et les vedettes, Copeau impo sa une discipline stricte à ses acteurs,
soucieuse moins de technique que de qualités de coeur et d'esprit, une
interpré tation transparente du texte, une mise en scène stylisée dominée par
de savants éclairages.
Copeau renouvela le théâtre classique, en particulier
Molière et Shakespeare, mais surtout serv it ses contemporai ns, entre autres
Claudel (L'Echange), Gide (Saül), Martin du Gard.
Deux de ses acteurs
allaient voler de leurs propres ailes, Charles Dullin (1885-1949) et Loui s
Jouvet (1887-1951) .
Le premier, « aristocrate authentique de l'âme et du coeur, à la fois faible
et héroïque , naïf et vieux renard» (Jean-Louis Barrault, qui fut un de ses
élèves), fonda à !'Atelier en 1922, une troupe qui joua avec succès aussi
bien les élizabéthains ou Molière que les modernes comme Achard,
Salacrou, Pirandello ou Sartre (création des Mouches en 1943).
Son
physique anguleux, sa diction parfaite, son regard aigu donnèrent une
épaisseur lég endaire à des personnages tounnentés, ambi tieux et rusés.
Le
théât re étant pour lui un spectacle total, ses mises en scène mêlaient tous
les genres, texte, musique, pantomime, int ermèdes.
Le second, au physique aigu et à la voix sèche et détachée, est resté
présent grâce surtout au cinéma, où il excella dans des rôles de personnages
cy niqu es.
Mais c'est avant tout le fondateur d'une troupe brillante qui se
produisit d'abord à la Comédie des Champs-Élysées (1923-1934) puis à
l'Athénée (1935-1940).
Parti du «boulevard», Jouvet allia, dans un
parcours exe mp laire , une connaissance exigeante de la littérature à une
pratique approfondie des technique s théâtrales .
Il triompha dans une série
de Molières (L'Ecole des femmes, Dom Juan, Tartuffe, Les Fourberies de
Scapin), mais, d'esprit plus moderniste que Dullin, il rechercha et aida les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE THÉÂTRE DURANT L’ENTRE-DEUX-GUERRES
- Le Théâtre Classique et la règle de trois unités.
- Critique d'Artemisia Gentileschi Théâtre
- Dm de spé théâtre: Tartuffe de Molière
- Le théâtre n'est-il l'art que de la parole?