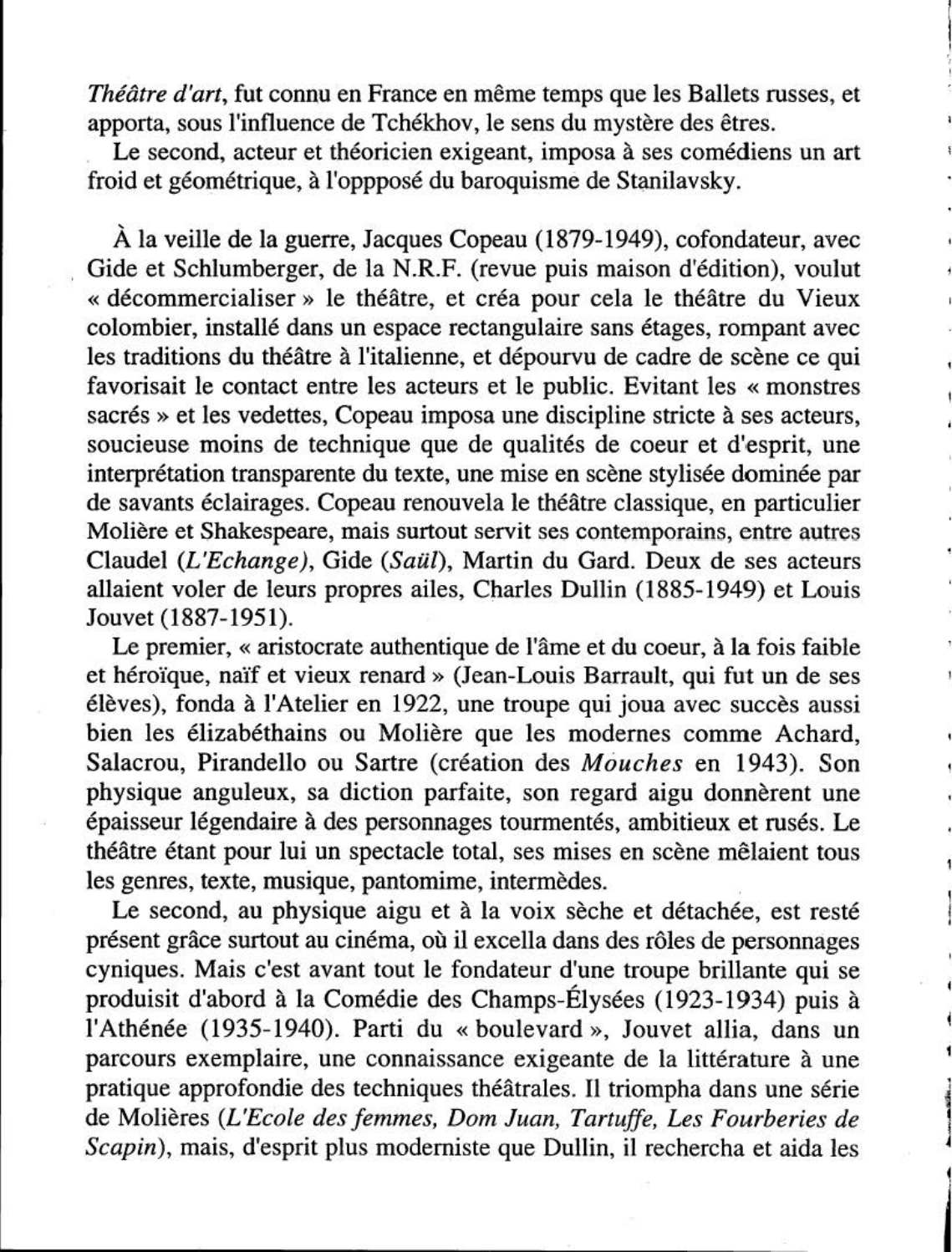LE THÉÂTRE DURANT L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Publié le 31/12/2019
Extrait du document
Les auteurs dramatiques
Contrairement à la période d'avant 1914, peu fertile en dramaturges de premier plan, l'entre-deux-guerre fut particulièrement brillante, malgré ce que dit Giraudoux. Sacha Guitry, Marcel Achard, Jacques Deval firent les beaux soirs du théâtre de boulevard et de la comédie légère, publiés régulièrement par la Petite illustration. Edouard Bourdet, Jules Romains, Marcel Pagnol illustrèrent avec plus ou moins de méchanceté ou de sourire la comédie de mœurs ; la farce, grâce aux commandes de Jacques Copeau en particulier, revint à la mode grâce au concours inattendu de grands auteurs comme Claudel (Protéé), Martin du Gard, et surtout l'écrivain belge Fernand Crommelynck (Le Cocu magnifique, pièce flamboyante à grand succès), tandis que le drame, inspiré parfois de Freud ou du dramaturge italien Pirandello, fut abondamment illustré.
L'Esprit nouveau d'Apollinaire (1880-1918), plus connu comme poète, s'incarna au théâtre dans Les Mamelles de Tirésias (1917), « drame surréaliste » qui fit scandale par sa loufoquerie et ses provocations.
Dans une veine analogue, le surréalisme, plus connu comme mouvement poétique et pictural, donna quelques pièces, dont la plus célèbre est Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac. Toute l’époque, d'ailleurs, dans le sillage de Dada et du surréalisme, fut le théâtre d'une recherche intense en matière d'architecture théâtrale, de mise en scène, de dramaturgie et d'écriture, intéressante pour l'avenir, mais au retentissement limité à l'époque. L'auteur le plus remarquable dans ce sillage, surtout par son influence, fut Antonin Artaud (1896-1948), à la fois comédien de cinéma (dans la Jeanne d'Arc de Dreyer, 1927, et le Napoléon d'Abel Gance, 1928-34), poète et théoricien du « Théâtre de la cruauté ». Artaud voulut, en réaction à la tradition occidentale, s'inspirer du théâtre oriental et de son art du mime, et surtout révéler de façon paroxystique érotisme, violence et terreur, en accord avec le cosmos. Il illustra ces théories dans une seule pièce, Les Cenci, drame de la Renaissance italienne (1935).
«
Théâtre d'art, fut connu en France en même temps que les Ballets russes, et
apporta, sous l'influence de Tchékhov, le sens du mystère des êtres.
.
Le seco nd , acteur et théoricien exigeant, imposa à ses coméd iens un art
froid
et géométrique, à l'oppposé du baroquisme de Stanilavsky.
À la veille de la guerre, Jacques Copeau (1879-1949), cofondateur, avec
Gide et Schlumberger, de la N.R.F.
(revue puis maison d'édition), voulut
« décommercialiser » le théâtre, et créa pour cela le théâtre du Vieux
colombier, installé dans un espace rectangulaire sans étages, rompant avec
les traditions du théâtre à l'italienne, et dépourvu de cadre de scène ce qui
favorisait
le contact entre les acteurs et le public.
Evitant l es « monstres
sacrés
» et les vedettes, Copeau imposa une discipline stricte à ses acteurs,
soucieuse moins de technique que de qualités de coeur et d'esprit , une
interprétation transparente du texte, une mise en scène stylisée dominée par
de savants éclairages.
Copeau renouvela le théâtre classique, en parti culie r
Molière
et Shakespeare, mais surtout servit ses contemporain s, entre aut res
Claudel
(L'Echange), Gide (Saül), Martin du Gard .
Deux de ses acteurs
allaient voler
de leurs propres ailes, Charles Dullin (1885- 1949) et Louis
Jouvet (1887-1951).
Le premier, « aristocrate authentique de l'âme et du coeur, à la fois faible
et héroïque , naïf et vieux renard» (Jean-Louis Barrault, qui fut un de ses
élèves), fonda à !'Atelier en 1922, une troupe qui joua avec succès aussi
bien les élizabéthains ou Molière que les modernes comme Achard,
Salacrou, Pirandello ou Sartre (création des Mouches en 1943 ).
Son
physique anguleux, sa diction parfaite, so n regard aigu donnèrent une
épaisseur légendaire à des personnages tourmentés, ambitieux et rusés.
Le
théâtre étant pour lui un spectacle total, ses mi ses en scène mêlaient tous
les genres, texte, musique, pantomime, intermèdes.
Le second, au phy sique aigu et à la voix sèche et détachée, est resté
présent grâce surtout au cinéma,
où il excella dans des rôles de personnages
cyniques.
Mais
c'est avant tout le fondateur d'une troupe brillante qui se
produisit d'abord à la Comédie des Champs-Élysées (1923-1934) puis à
l'Athénée (1935-1940).
Parti du «bouleva rd », Jouvet allia, dans un
parcour s exemplaire, une connaissance exigeante de la littér ature à une
pratique approfondie des techniques théâtrales.
Il triompha dans une série 1
de Molières (L'Ecole des femmes, Dom Juan, Tartuffe , Les Fourberies de J
Scapin), mais, d'es prit plus moderniste que Dullin , il rechercha et aida l es
j.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE THÉÂTRE DURANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES
- Le Théâtre Classique et la règle de trois unités.
- Critique d'Artemisia Gentileschi Théâtre
- Dm de spé théâtre: Tartuffe de Molière
- Le théâtre n'est-il l'art que de la parole?