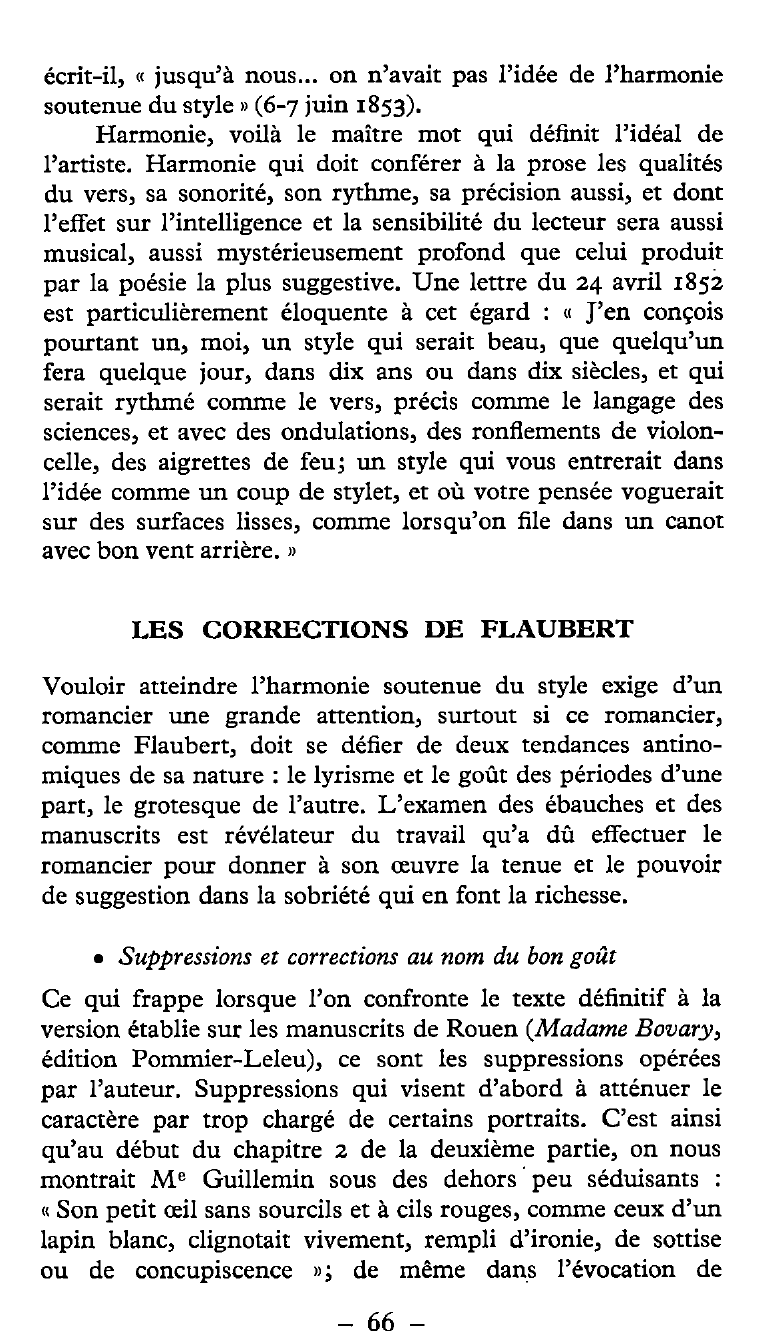Le style dans Madame Bovary de Gustave Flaubert
Publié le 22/01/2020
Extrait du document
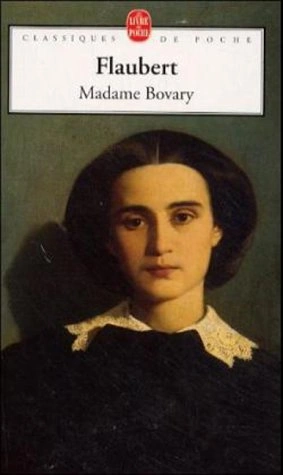
Mme Homais, à la page 137, quelques mots : « d’un aspect si commun », remplacent un développement plus long : ' « d’une physionomie si insignifiante, avec sa figure blonde, grasse et pâle, et ses petits yeux bleus comme une faïence dépolie ». Suppressions aussi qui épargnent au lecteur des détails peu appétissants ou trop précisément sensuels. Passons sur les réflexions de Rodolphe après sa première rencontre avec Mme Bovary, et qui bravent l’honnêteté, ou sur celles de la veuve Dubuc, « dévote et sensuelle », qui « trouvait son compte sans se troubler du tout la conscience » dans son mariage avec le jeune Charles. Notons seulement la discrétion de la phrase qui présente Rodolphe, à la page 213, par rapport à celle de la version antérieure : « Elle fut ravie de sa tournure quand il apparut debout sur le palier, manchettes retroussées, fouet en main, ganté juste et cravaté bas, avec son habitude velours jaune à la française, qui lui découvrait la taille et sa culotte de tricot qui lui serrait les cuisses, » Plus tard (voir p. 399), quand elle revoit son amant, Emma se laisse prendre « plus encore à sa voix et par le spectacle de sa personne ». Là encore, le manuscrit était beaucoup plus explicite. Cette phrase y était suivie en effet de celle-ci : « Sa chemise entrouverte découvrait son cou gras et blanc, son pantalon à pieds de flanelle rousse lui dessinait les cuisses, et toute la rancune d’Emma, peu à peu, s’assoupissait sous le charme de la force et de la virilité. »
Les images et les métaphores sont encore très nombreuses dans Madame Bovary, et leur étude mériterait tout un long développement. Flaubert s’en méfiait pourtant et, dit-il, les « persécutait ». Il a sans doute eu raison d’en supprimer quelques-unes. Que l’on se reporte au début du chapitre 5 de la deuxième partie : durant la promenade à la manufacture, Emma contemple Léon; sur le brouillon, le portrait s’achevait par : « Un peu de neige restée dans sa moustache faisait aux coins de sa bouche une mousse légère. » Une des ébauches indiquait même : « neige au coin de la bouche, comme de la crème de meringue ». Il est évident que ces images ne convenaient guère au portrait idéalisé du clerc vu par la jeune femme. On n’eût guère compris qu’elle en devînt amoureuse précisément à ce moment-là.
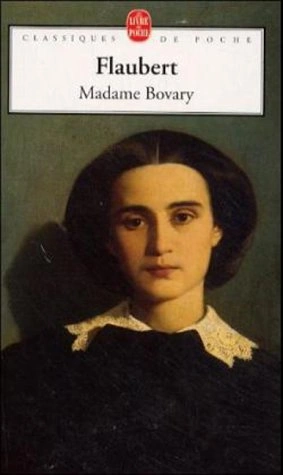
«
écrit-il, « jusqu'à nous ...
on n'avait pas l'idée de l'harmonie
soutenue du style» (6-7 juin 1853).
Harmonie, voilà le maître mot qui définit l'idéal de
l'artiste.
Harmonie qui doit conférer à la prose les qualités
du vers, sa sonorité, son rythme, sa précision aussi, et dont
l'effet sur l'intelligence et la sensibilité du lecteur sera aussi
musical, aussi mystérieusement profond que celui produit
par la poésie la plus suggestive.
Une lettre du 24 avril 1852
est particulièrement éloquente à cet égard : « J'en conçois
pourtant un, moi, un style qui serait beau, que quelqu'un
fera quelque jour, dans dix ans ou dans dix siècles, et qui
serait rythmé comme le vers, précis comme le langage des
sciences, et avec des ondulations, des ronflements de violon
celle, des aigrettes de feu; un style qui vous entrerait dans
l'idée comme un coup de stylet, et où votre pensée voguerait
sur des surfaces lisses, comme lorsqu'on file dans un canot
avec bon vent arrière.
»
LES CORRECTIONS DE FLAUBERT
Vouloir atteindre l'harmonie soutenue du style exige d'un
romancier une grande attention, surtout si ce romancier,
comme Flaubert, doit se défier de deux tendances antino
miques de sa nature : le lyrisme et le goût des périodes d'une
part, le grotesque de l'autre.
L'examen des ébauches et des
manuscrits est révélateur du travail qu'a dû effectuer le
romancier pour donner à son œuvre la tenue et le pouvoir
de suggestion dans la sobriété qui en font la richesse.
• Suppressions et corrections au nom du bon goût
Ce qui frappe lorsque l'on confronte le texte définitif à la
version établie sur les manuscrits de Rouen (Madame Bovary,
édition Pommier-Leleu), ce sont les suppressions opérées
par l'auteur.
Suppressions qui visent d'abord à atténuer le
caractère par trop chargé de certains portraits.
C'est ainsi
qu'au début du chapitre 2 de la deuxième partie, on nous
montrait Me Guillemin sous des dehors · peu séduisants :
« Son petit œil sans sourcils et à cils rouges, comme ceux d'un
lapin blanc, clignotait vivement, rempli d'ironie, de sottise
ou de concupiscence »; de même dan_s l'évocation de
- 66 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse de Madame Bovary de Gustave Flaubert
- Ce corpus est composé de trois extraits, Le Rouge et le Noir écrit en 1830 par Stendhal, Le père Goriot écrit en 1835 par Honoré de Balzac, Madame Bovary écrit en 1857 par Gustave Flaubert.
- Gustave flaubert Madame de Bovary Chapitre 9 partie 2
- MADAME Bovary, de Gustave Flaubert
- Madame Bovary de Gustave Flaubert (Analyse)