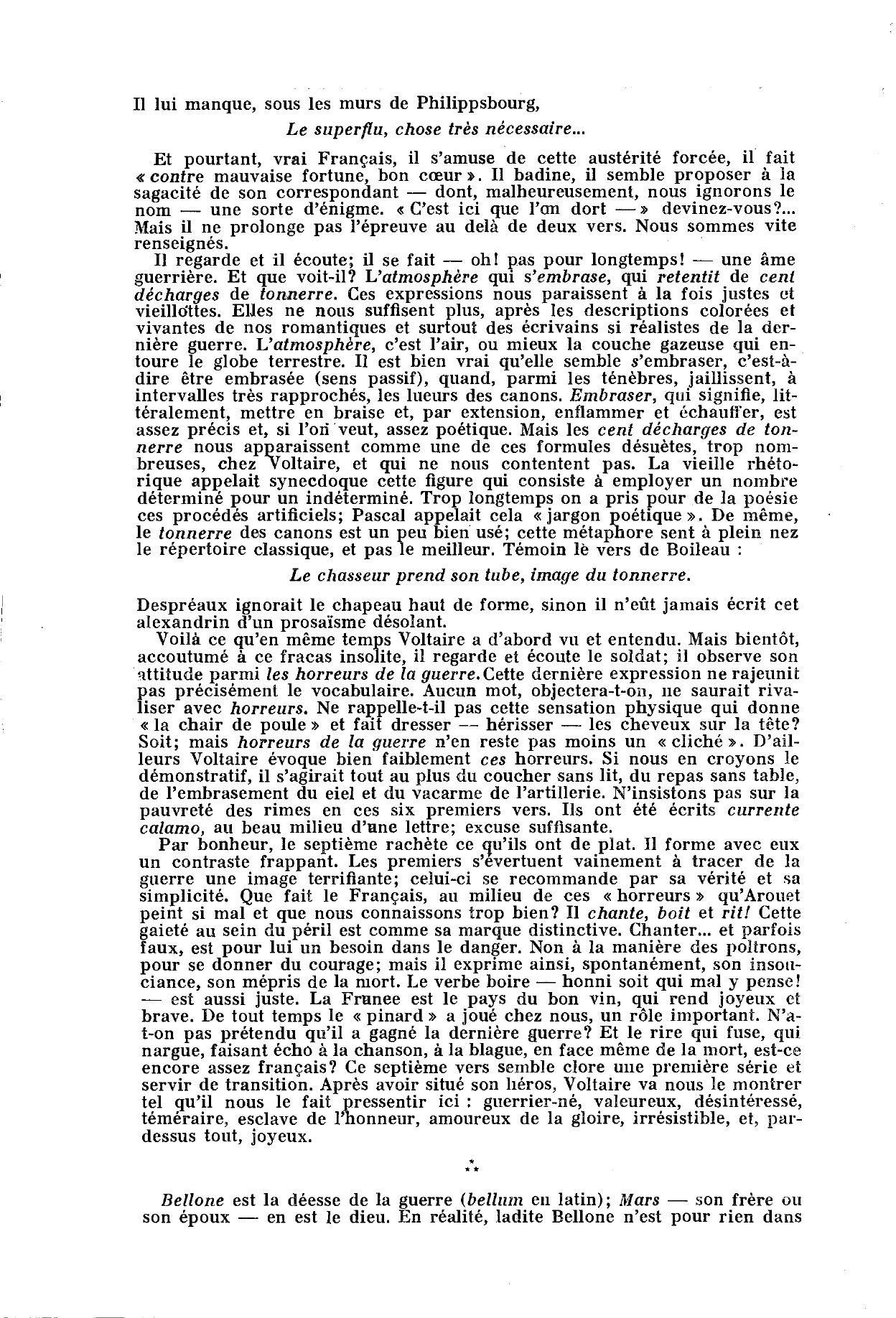Le Soldat français (Voltaire): ÉPÎTRES
Publié le 16/02/2012
Extrait du document

C’est ici que l’on dort sans lit, Et qu’on prend ses repas par terre; Je vois et j’entends l’atmosphère Qui s’embrase et qui retentit De cent décharges de tonnerre; Et dans ces horreurs de la guerre Le Français chante, boit, et rit. Bellone va réduire en cendres Les courtines de Philisbourg, Par cinquante mille Alexandres Payés à quatre sous par jour: Je les vois, prodiguant leur vie, Chercher ces combats meurtriers, Couverts de fange et de lauriers, Et pleins d’honneur et de folie. Je vois briller au milieu d’eux Ce fantôme nommé la Gloire, A l’oeil superbe, au front poudreux, Portant au cou cravate noire, Ayant sa trompette en sa main, Sonnant la charge et la victoire, Et chantant quelques airs à boire, Dont ils répètent le refrain
Voltaire ne saurait passer pour un modèle de patriotisme. On pourrait, à l'aide de ses écrits, de ses faits et gestes, constituer un dossier accablant, sur lequel on serait en droit d'écrire : Voltaire contre la France. Mais il serait également aisé de produire maintes pièces à décharge, établissant qu'il fut patriote à ses heures, qu'il a connu et aimé les gens de son pays. Besoin de se contredire? Manoeuvres de l'intérêt? Pur caprice?

«
Il lui manque, sous les murs de Philippsbourg,
Le superflu, chose tres necessaire...
Et pourtant, vrai Francais, it s'amuse de cette austerite forcee, it fait
eontre mauvaise fortune, bon cceur ».
II badine, it semble proposer a la
sagacite de son correspondant - dont, malheureusement, nous ignorons le nom - une sorte d'enigme.
« C'est ici que l'cm dort -» devinez-vous?...
Mais it ne prolonge pas l'epreuve au dela de deux vers.
Nous sommes vite
renseignes.
Il regarde et it ecoute; it se fait - oh! pas pour longtemps! - une 'Arne
guerriere.
Et que voit-il? L'atmosphere qui s'embrase, qui retentit de cent
decharges de tonnerre.
Ces expressions nous paraissent a la fois justes et
vieillcittes.
Elles ne nous suffisent plus, apres les descriptions colorees et
vivantes de nos romantiques et surtout des ecrivains si realistes de la der-
niere guerre.
L'atmosphere, c'est I'air, ou mieux la couche gazeuse qui en-
toure le globe terrestre.
Il est bien vrai qu'elle semble s'embraser, c'est-a-
dire etre embrasee (sens passif), quand, parmi les tenebres, jaillissent,
intervalles tres rapproches, les lueurs des canons.
Embraser, qui signifie, lit-
teralement, mettre en braise et, par extension, enflammer et echauffer, est
assez précis et, si l'oii vent, assez poetique.
Mais les cent decharges de ton-
nerre nous apparaissent comme une de ces formules desuetes, trop nom- breuses, chez Voltaire, et qui ne nous contentent pas.
La vieille rheto-
rique appelait synecdoque cette figure qui consiste a employer un nombre
determine pour un incletermine.
Trop longtemps on a pris pour de la poesie
ces procedes artificiels; Pascal appelait cela « jargon poetique ».
De meme,
le tonnerre des canons est un peu bien use; cette metaphore sent a plein nez
le repertoire classique, et pas le meilleur.
Temoin le vers de Boileau :
Le chasseur prend son tube, image du tonnerre.
Despreaux ignorait le chapeau haul de forme, sinon it n'efit jamais ecrit cet
alexandrin d'un prosaIsme desolant.
Voila ce qu'en meme temps Voltaire a d'abord vu et entendu.
Mais bientot,
accoutume a ce fracas insolite, it regarde et ecoute le soldat; il observe son
qttitude parmi les horreurs de la guerre.
Cette derniere expression ne rajeunit
pas precisement le vocabulaire.
Aucun mot, objectera-t-on, ne saurait riva-
liser avec horreurs.
Ne rappelle-t-il pas cette sensation physique qui donne la chair de poule » et fait dresser -- herisser - les cheveux sur la tete?
Soit; mais horreurs de la guerre n'en reste pas moins un « cliche ».
D'ail-
leurs Voltaire evoque hien faiblement ces horreurs.
Si nous en croyons le demonstratif, it s'agirait tout au plus du coucher sans lit, du repas sans table,
de l'embrasement du eiel et du vacarme de l'artillerie.
N'insistons pas sur la
pauvrete des rimes en ces six premiers vers.
Its ont ete ecrits currente
calamo, au beau milieu d'une lettre; excuse suffisante.
Par bonheur, le septieme rachete ce qu'ils ont de plat.
II forme avec eux
un contraste frappant.
Les premiers s'evertuent vainement a tracer de la
guerre une image terrifiante; celui-ci se recommande par sa verite et sa
simplicite.
Que fait le Francais, an milieu de ces « horreurs » qu'Arouet
peint si mal et que nous connaissons trop bien? II chante, boll et rit! Cette
gaiete au sein du peril est comme sa marque distinctive.
Chanter...
et parfois
faux, est pour lui un besoin dans le danger.
Non a la maniere des poltrons,
pour se donner du courage; mais it exprime ainsi, spontanement, son insou- ciance, son mepris de la mort.
Le verbe boire - honni soit qui mal y pense!
- est aussi juste.
La France est le pays du bon yin, qui rend joyeux et
brave.
De tout temps le « pinard » a joue chez nous, un role important.
N'a-
t-on pas pretendu qu'il a gagne la derniere guerre? Et le rire qui fuse, qui
nargue, faisant echo a la chanson, a la blague, en face meme de la mort, est-ce
encore assez francais? Ce septieme vers semble clore une premiere serie et
servir de transition.
Apres avoir situe son hems, Voltaire va nous le montrer
tel qu'il nous le fait pressentir ici : guerrier-ne, valeureux, desinteresse,
temeraire, esclave de rhonneur, amoureux de la gloire, irresistible, et, par-
dessus tout, joyeux.
Bellone est la deesse de la guerre Wilma en latin); Mars - son frere ou
son epoux - en est le dieu.
En realite, ladite Bellone n'est pour rien dans
Il lui manque, sous les murs de Philippsbourg,
Le superflu, chose très nécessaire...
Et pourtant, vrai Français, il s'amuse de cette austérité forcée, il fait «contre mauvaise fortune, bon cœur».
Il badine, il semble proposer à la
sagacité de son correspondant — dont, malheureusement, nous ignorons le nom — une sorte d'énigme.
«C'est ici que l'on dort —» devinez-vous?...
Mais il ne prolonge pas l'épreuve au delà de deux vers.
Nous sommes vite renseignés.
Il regarde et il écoute; il se fait — oh! pas pour longtemps! — une âme
guerrière.
Et que voit-il? L'atmosphère qui s'embrase, qui retentit de cent décharges de tonnerre. Ces expressions nous paraissent à la fois justes et vieillottes. Elles ne nous suffisent plus, après les descriptions colorées et vivantes de nos romantiques et surtout des écrivains si réalistes de la der nière guerre. L'atmosphère, c'est l'air, ou mieux la couche gazeuse qui en toure le globe terrestre. Il est bien vrai qu'elle semble s'embraser, c'est-à- dire être embrasée (sens passif), quand, parmi les ténèbres, jaillissent, à intervalles très rapprochés, les lueurs des canons.
Embraser, qui signifie, lit téralement, mettre en braise et, par extension, enflammer et échauffer, est assez précis et, si l'on veut, assez poétique. Mais les cent décharges de ton
nerre nous apparaissent comme une de ces formules désuètes, trop nom
breuses, chez Voltaire, et qui ne nous contentent pas.
La vieille rhéto rique appelait synecdoque cette figure qui consiste à employer un nombre déterminé pour un indéterminé. Trop longtemps on a pris pour de la poésie
le tonnerre des canons est un peu bien usé; cette métaphore sent à plein nez le répertoire classique, et pas le meilleur. Témoin îè vers de Boileau :
Despréaux ignorait le chapeau haut de forme, sinon il n'eût jamais écrit cet alexandrin d'un prosaïsme désolant.
Voilà ce qu'en même temps Voltaire a d'abord vu et entendu.
Mais bientôt,
accoutumé à ce fracas insolite, il regarde et écoute le soldat; il observe son attitude parmi les horreurs de la guerre.
Cette dernière expression ne rajeunit
pas précisément le vocabulaire.
Aucun mot, objectera-t-on, ne saurait riva liser avec horreurs. Ne rappelle-t-il pas cette sensation physique qui donne « la chair de poule » et fait dresser — hérisser — les cheveux sur la tête? Soit; mais horreurs de la guerre n'en reste pas moins un «cliché». D'ail leurs Voltaire évoque bien faiblement ces horreurs. Si nous en croyons le
démonstratif, il s'agirait tout au plus du coucher sans lit, du repas sans table,
de l'embrasement du ciel et du vacarme de l'artillerie. N'insistons pas sur la
pauvreté des rimes en ces six premiers vers. Ils ont été écrits currente
calamo, au beau milieu d'une lettre; excuse suffisante.
Par bonheur, le septième rachète ce qu'ils ont de plat. Il forme avec eux un contraste frappant. Les premiers s'évertuent vainement à tracer de la guerre une image terrifiante; celui-ci se recommande par sa vérité et sa
simplicité.
Que fait le Français, au milieu de ces « horreurs » qu'Arouet
peint si mal et que nous connaissons trop bien? Il chante, boit et rit! Cette gaieté au sein du péril est comme sa marque distinctive.
Chanter... et parfois
faux, est pour lui un besoin dans le danger. Non à la manière des poltrons,
pour se donner du courage; mais il exprime ainsi, spontanément, son insou ciance, son mépris de la mort. Le verbe boire — honni soit qui mal y pense !
— est aussi juste. La France est le pays du bon vin, qui rend joyeux et brave. De tout temps le « pinard » a joué chez nous, un rôle important. N'a- t-on pas prétendu qu'il a gagné la dernière guerre? Et le rire qui fuse, qui nargue, faisant écho à la chanson, à la blague, en face même de la mort, est-ce
encore assez français? Ce septième vers semble clore une première série et servir de transition. Après avoir situé son héros, Voltaire va nous le montrer tel cpi'il nous le fait pressentir ici : guerrier-né, valeureux, désintéressé,
téméraire, esclave de l'honneur, amoureux de la gloire, irrésistible, et, par
dessus tout, joyeux.
ces procédés artificiels; Pascal même,
Le chasseur prend son tube, image du tonnerre.
Bellone est la déesse de la guerre (bellum en latin); Mars — son frère ou son époux — en est le dieu. En réalité, ladite Bellone n'est pour rien dans.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lamartine a dit de Voltaire qu'il était la Médaille du pays. Il veut signifier par là que, de tous nos écrivains, c'est Voltaire qui incarne le plus complètement et le plus parfaitement l'esprit français, et que nous retrouvons en lui les traits principaux dt notre caractère. Expliquez et appréciez ce jugement.
- Eugène de Savoie 1663-1736 Ce fils d'un soldat de valeur, prince de Savoie devenu Français, avait pour aïeul, du côté paternel, un chef de guerre réputé et, par sa mère, Olympe Mancini, il était le petit-neveu de Mazarin.
- Un critique a dit : « On a raison de mettre Le siècle de Louis XIV aux mains de la jeunesse. Tant qu'il sera un livre d'enseignement, je n'ai pas peur que les Français aiment médiocrement leur pays. C'est le meilleur ouvrage et peut-être la meilleure action de Voltaire. » (Nisard.) ?
- Commentaire – Français Candide de Voltaire: L'Eldorado, un univers merveilleux
- Bara (Joseph) Soldat français (Palaiseau, 1779 - près de Cholet, 1793).