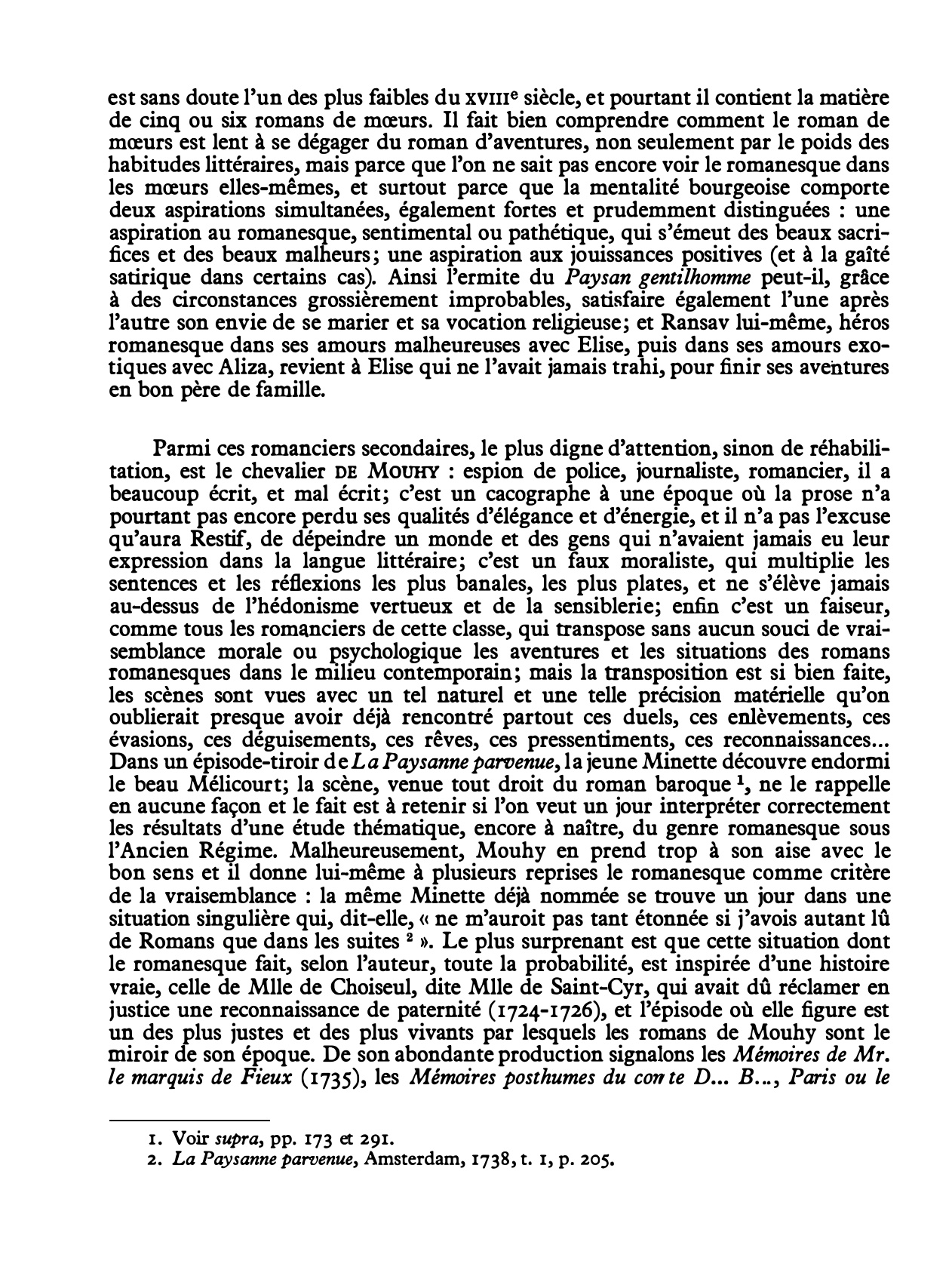Le roman de mœurs - Histoire de la littérature
Publié le 25/01/2018
Extrait du document

L'étude systématique des diverses catégories de romans au XVIIIe siècle n'étant pas encore faite, nous devons nous en tenir à quelques œuvres qui serviront d'exemples. Quand l'attention apportée aux réalités de l'existence quotidienne et à la composition de la société ne s'accompagne pas des vues morales profondes ou du génie créateur propres aux grands romanciers, le réalisme réduit à lui-même n'a plus qu'un intérêt documentaire et l'esprit bourgeois, conquérant mais conformiste, sentimental mais égoïste, étale son contentement et sa veulerie chez les imitateurs de Lesage, de Prévost et de Marivaux. En revanche, le coup d'œil est sûr, l'expérience est riche, les faits parlent d'eux-mêmes et en disent parfois plus long que ne le croient les romanciers : le roman est dans le monde, s'il n'est pas exactement dans leur tête; bientôt il sera dans leur vie, avec Restif; il a manqué un Balzac à cette époque, mais on sent constamment qu'il n'est pas loin. Ce n'est pas le talent qui manque non plus, mais ce talent est trop facile; les écrivains n'essaient pas d'inventer une forme qui ferait apparaître la vérité originale du monde moderne, ils se contentent d'emprunts aux œuvres qui ont eu du succès ou au fonds romanesque du siècle précédent. D'où le voisinage dans une même œuvre de fragments qui semblent directement tirés de la vie et d'invraisemblances conventionnelles. Quelques souvenirs vécus, quelques réminiscences des Mémoires de Hollande et des Aventures du Seigneur Rozelli, il n'en faut pas plus pour écrire un roman, Mémoires du Comte de V axère, ou le Faux Rabin, par le marquis d'Argens, qui n'est pas sans intérêt (1749); une dizaine d'histoires brochées les unes sur les autres, des militaires au couvent, des accouchements clandestins, un duel, un peu de politique, la description d'une bibliothèque (comme dans les Lettres Persanes), une cabale contre un intendant, un mari trompé, un amant quitté, une tentative d'assassinat, une femme séquestrée pendant deux ans et qui n'a jamais cédé à son ravisseur (voir Le Grand Cyrus), des enlèvements successifs, des morts, des mariages, des jalousies, des malentendus, tout un répertoire qu'on a l'impression d'avoir parcouru déjà plus de cent fois ... L'auteur assure que toutes ces aventures sont véritables, et il est probable en effet que plusieurs le sont : c'est Le Solitaire philosophe ou Mémoires de Mr. le marquis de Mirmon, en 260 pages, encore par le marquis d~Argens (1739). On ne s'étonnera donc pas de trouver dans un même livre, Le paysan gentilhomme ou Aventures de M. Ransav, avec son Voyage aux Isles Jumelles, par Catalde (1737), des pages de roman réaliste (conditions de vie des nobles et des bourgeois de Hollande, ignominie d'un mari acoquiné avec une bande de brigands et qui veut vendre sa femme à un riche créole, malentendu domestique dans une famille parisienne à cause de la protection innocente accordée par la femme à un jeune homme pauvre, mais méritant), du picaresque affadi (réussite de ce même jeune homme à la Cour d'Angleterre où il se fait passer pour noble), des platitudes sentimentales (histoire d'un ermite) et un voyage utopique. Ce roman incohérent

«
est sans doute l'un des plus faibles du XVIIIe siècle, et pourtant il contient la matière
de cinq ou six romans de mœurs .
Il fait bien comprendre comment le roman de
mœurs est lent à se dégager du roman d' aventures , non seulement par le poids des
habitudes littéraires, mais parce que l'on ne sait pas encore voir le romanesque dans
les mœurs elles-mêmes, et surtout parce que la mentalité bourgeoise comporte
deux aspirations simultanées, également fortes et prudemment distinguées : une
aspiration au romanesque, sentimental ou pathétique, qui s'émeut des beaux sacri
fices et des beaux malheurs ; une aspiration aux jouissances positives (et à la gaîté
satirique dans certains cas).
Ainsi l'ermite du Paysan gentilhomme peut-il, grâce
à des circonstances grossièrement improbables, satisfaire également l'une après
l'autre son envie de se marier et sa vocation religieuse; et Ransav lui-même, héros
romanesque dans ses amours malheureuses avec Elise, puis dans ses amours exo
tiques avec Aliza, revient à Elise qui ne l'avait jamais trahi, pour finir ses aventures
en bon père de famille.
Parmi ces romanciers secondaires, le plus digne d'attention, sinon de réhabili
tation, est le chevalier DE MoUHY : espion de police, journaliste, romancier, il a
beaucoup écrit, et mal écrit ; c'est un cacographe à une époque où la prose n'a
pourtant pas encore perdu ses qualités d'élégance et d'énergie, et il n'a pas l'excuse
qu'aura Restif, de dépeindre un monde et des gens qui n'avaient jamais eu leur
expression dans la langue littéraire; c'est un faux moraliste, qui multiplie les
sentences et les réflexions les plus banales, les plus plates, et ne s'élève jamais
au-dessus de l'hédo nisme vertueux et de la sensibler ie; enfin c'est un faiseur,
comme tous les romanciers de cette classe, qui transpose sans aucun souci de vrai
semblance morale ou psychologique les aventures et les situations des romans
romanesques dans le milieu contemporain ; mais la transposition est si bien faite,
les scènes sont vues avec un tel naturel et une telle précision matérielle qu'on
oublierait presque avoir déjà rencontré partout ces duels, ces enlèvements, ces
évasions, ces déguisements, ces rêves, ces pressentiments, ces reconnaissances ...
Dans un épisode-tiroir de La Paysanne paroenue, la jeune Minette découvre endormi
le beau Mélicou rt; la scène, venue tout droit du roman baroque 1, ne le rappelle
en aucune façon et le fait est à retenir si l'on veut un jour interpréter correctement
les résultats d'une étude thématique, encore à naître, du genre romanesque sous
l'Ancien Régime.
Malheureusement, Mouhy en prend trop à son aise avec le
bon sens et il donne lui-même à plusieurs reprises le romanesque comme critère
de la vraisemblance : la même Minette déjà nommée se trouve un jour dans une
situation singulière qui, dit-elle, .
Le plus surprenant est que cette situation dont
le romanesque fait, selon l'auteur, toute la probabilité, est inspirée d'une histoire
vraie, celle de Mlle de Choiseul, dite Mlle de Saint-Cyr, qui avait dû réclamer en
ju stice une reconnaissance de paternité (1724- 1726), et l'épisode où elle figure est
un des plus justes et des plus vivants par lesquels les romans de Mouhy sont le
miroir de son époque.
De son abondante production signalons les Mémoires de Mr.
le marquis de Fieux (1735), les Mémoires posthumes du cor� te D ...
B.
..
, Paris ou le
1.
Voir supra, pp.
173 et 291.
2.
La Paysanne parvenue, Amsterdam, 1738, t.
1, p.
205..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de La Fayette nous dépeint dans La Princesse de Clèves une fresque de la Cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques ; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vous
- Nouveau Roman (histoire de la littérature)
- LE ROMAN POLICIER (Histoire de la littérature)
- LE ROMAN-PHOTO (Histoire de la littérature)
- LE ROMAN NOIR (Histoire de la littérature)