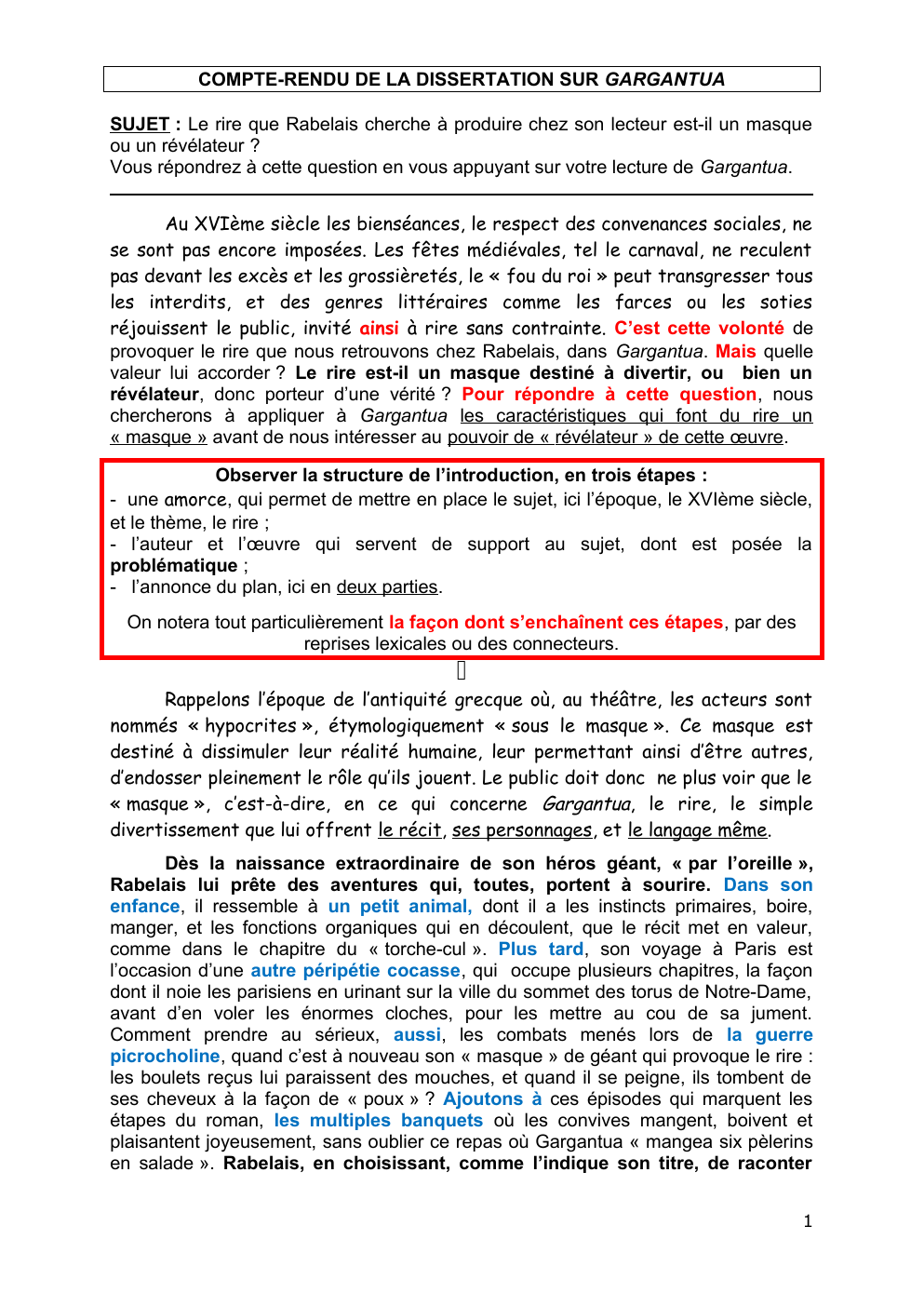Le rire que Rabelais cherche à produire chez son lecteur est-il un masque ou un révélateur ?
Publié le 03/01/2023
Extrait du document
«
COMPTE-RENDU DE LA DISSERTATION SUR GARGANTUA
SUJET : Le rire que Rabelais cherche à produire chez son lecteur est-il un masque
ou un révélateur ?
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre lecture de Gargantua.
Au XVIème siècle les bienséances, le respect des convenances sociales, ne
se sont pas encore imposées.
Les fêtes médiévales, tel le carnaval, ne reculent
pas devant les excès et les grossièretés, le « fou du roi » peut transgresser tous
les interdits, et des genres littéraires comme les farces ou les soties
réjouissent le public, invité ainsi à rire sans contrainte.
C’est cette volonté de
provoquer le rire que nous retrouvons chez Rabelais, dans Gargantua.
Mais quelle
valeur lui accorder ? Le rire est-il un masque destiné à divertir, ou bien un
révélateur, donc porteur d’une vérité ? Pour répondre à cette question, nous
chercherons à appliquer à Gargantua les caractéristiques qui font du rire un
« masque » avant de nous intéresser au pouvoir de « révélateur » de cette œuvre.
Observer la structure de l’introduction, en trois étapes :
- une amorce, qui permet de mettre en place le sujet, ici l’époque, le XVIème siècle,
et le thème, le rire ;
- l’auteur et l’œuvre qui servent de support au sujet, dont est posée la
problématique ;
- l’annonce du plan, ici en deux parties.
On notera tout particulièrement la façon dont s’enchaînent ces étapes, par des
reprises lexicales ou des connecteurs.
Rappelons l’époque de l’antiquité grecque où, au théâtre, les acteurs sont
nommés « hypocrites », étymologiquement « sous le masque ».
Ce masque est
destiné à dissimuler leur réalité humaine, leur permettant ainsi d’être autres,
d’endosser pleinement le rôle qu’ils jouent.
Le public doit donc ne plus voir que le
« masque », c’est-à-dire, en ce qui concerne Gargantua, le rire, le simple
divertissement que lui offrent le récit, ses personnages, et le langage même.
Dès la naissance extraordinaire de son héros géant, « par l’oreille »,
Rabelais lui prête des aventures qui, toutes, portent à sourire.
Dans son
enfance, il ressemble à un petit animal, dont il a les instincts primaires, boire,
manger, et les fonctions organiques qui en découlent, que le récit met en valeur,
comme dans le chapitre du « torche-cul ».
Plus tard, son voyage à Paris est
l’occasion d’une autre péripétie cocasse, qui occupe plusieurs chapitres, la façon
dont il noie les parisiens en urinant sur la ville du sommet des torus de Notre-Dame,
avant d’en voler les énormes cloches, pour les mettre au cou de sa jument.
Comment prendre au sérieux, aussi, les combats menés lors de la guerre
picrocholine, quand c’est à nouveau son « masque » de géant qui provoque le rire :
les boulets reçus lui paraissent des mouches, et quand il se peigne, ils tombent de
ses cheveux à la façon de « poux » ? Ajoutons à ces épisodes qui marquent les
étapes du roman, les multiples banquets où les convives mangent, boivent et
plaisantent joyeusement, sans oublier ce repas où Gargantua « mangea six pèlerins
en salade ».
Rabelais, en choisissant, comme l’indique son titre, de raconter
1
« la vie très horrifique du grand Gargantua » impose donc d’emblée un
« masque » : cet adjectif met en valeur sa volonté de divertir ses lecteurs.
De même, tous ses personnages, même ceux qui appartiennent à
l’humanité ordinaire, sont caricaturés, tant leur caractère est exagéré.
Cela va
des personnages secondaires, tels les sophistes qui interviennent pour former
Gargantua, Thubal Holoferne ou le « vieux tousseux », ou encore maître Janotus de
Bragmardo, aux principaux protagonistes, comme Picrochole à la « bile amère »
ou Frère Jean, le moine combattant.
Le premier fait rire par son caractère propre,
ses ambitions de conquête démesurées nées d’une simple querelle à propos de
« fouaces », et son adhésion naïve à la peinture de ses succès par ses conseillers.
Le second fait rire par la parodie de la chanson de geste et même de l’épopée, par
la façon dont il se lance au combat tel un noble chevalier, « met son froc en
écharpe » et frappe à grands coups de « bâton de la croix », rire d’autant plus
jaillissant en raison du décalage entre son statut religieux et ce joyeux massacre.
Pédants, peureux et lâches, hypocrites et perfides, ivrognes grossiers, la liste est
longue des excès qui suscitent spontanément le rire.
Ainsi, le masque est porteur de plaisantes grimaces, et, entre jurons,
grossièreté, obscénité, scatologie, toutes les ressources du comique sont
mises en œuvre pour ridiculiser les personnages.
Un exemple en est donné lors
de l’enfance de Gargantua, avec tout le jeu des servantes autour de la braguette du
héros ; son absence de toute règle de politesse ressort également quand
Ponocrates observe son comportement habituel, la façon dont il se laisse aller à ses
plaisirs naturels : « il fientait, pissait, se raclait la gorge, rotait, pétait », avant de
s’empiffrer.
Rabelais met en scène le comique de gestes, tels ceux de Frère Jean
pendant son combat face aux ennemis dont « il perçait le boyau du cul entre les
couilles », mais aussi le comique de mots, depuis les noms cocasses des
personnages jusqu’aux néologismes plaisants, avec l’apogée lors du discours de
maître Janotus avec son argumentation ridicules, son latin vide de sens et ses
onomatopées conclusives : « nac petetin petetac, ticque, torche, lorgne ».
Rabelais,
par ces jeux sur le langage et sur les sonorités, touche là, comme
fréquemment dans son œuvre, au comique de l’absurde.
Comment le lecteur pourrait-il donc ne pas être emporté par le rire en
accompagnant Gargantua dans ses aventures ? Il est face au « fou du roi », à ses
« belles billevesées », et suit l’invitation qui clôt le prologue : « À présent,
réjouissez-vous, mes amours, et lisez gaiement la suite pour le plaisir du corps et
la santé des reins ! »
Observer la structure de cette 1ère partie du développement :
- une introduction partielle : elle explicite le contenu de la partie, ici le terme
« masque », en annonçant le plan de la partie, ici trois paragraphes.
- une conclusion partielle ferme la partie par un bilan qui permet d’enchaîner avec
celle qui suit.
- des sous-parties forment des paragraphes marqués par l’alinéa, qui s’articulent
par des connecteurs logiques.
Chacun est composé d’une phrase d’ouverture,
qui pose l’argument, ensuite développé et prouvé par des exemples, cités ou
simplement évoqués.
Il se ferme par une phrase de bilan.
On notera tout particulièrement la façon dont s’enchaînent ces étapes, à l’aide de
connecteurs logiques.
2
Cependant, il reste la question est de savoir s’il est possible d’enlever le
masque, de ne pas se laisser prendre à ces apparences, pour, au contraire, voir
dans le rire un « révélateur », comparable à ces produits chimiques qui
permettent, en photographie, de rendre visible l’image.
Ainsi, loin....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En quoi peut on dire que Gargantua de Rabelais prête autant a rire qu’il donne à penser ?
- Dissertation sur œuvre Gargantua, RABELAIS: Le rire
- Le rire est le propre de l'homme. Rabelais
- Quelles raisons poussent un écrivain à transcrire sous forme de poèmes des événements de sa vie et des réflexions personnelles ? Et quelles raisons poussent un lecteur à les lire, que cherche-il, que trouve-til ?
- La comédie doit-elle seulement faire rire le lecteur-spectateur ?