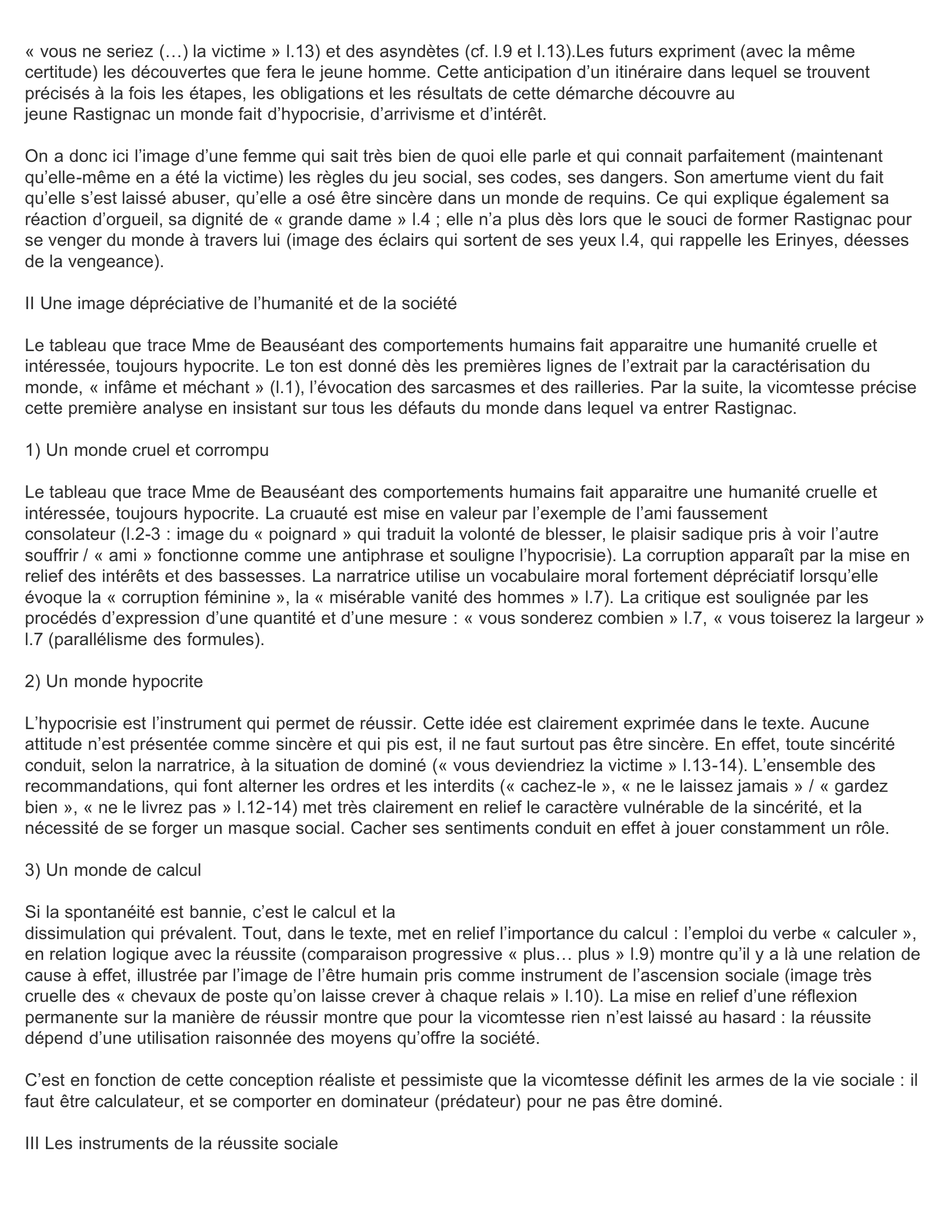Le Père Goriot (1835), texte 2 : « Discours de Mme de Beauséant à Rastignac »
Publié le 14/09/2018
Extrait du document

3) La nécessité d’une initiatrice
Outre l’appui d’une femme jeune, riche et élégante, la vicomtesse, par sa propre attitude, montre à quel point est essentiel un enseignement initial. Le rôle qu’elle joue dans le passage, en prodiguant des conseils assurés et justifiés par son expérience, est en lui-même révélateur de la nécessité, pour un jeune homme inexpérimenté, de bénéficier des conseils d’un maître. Cet appuiessentiel consiste non seulement en conseils avisés (tous ceux qui sont prodigués dans le texte) mais en promesse d’aide sur le terrain (« je vous aiderai »). En cela la vicomtesse met elle-même en application ses propres conseils. Elle va se servir de Rastignac pour se venger du monde, responsable de sa souffrance et de son amertume.
Conclusion
Dans ce passage, Mme de Beauséant se montre comme une femme expérimentée qui a bien compris les règles du jeu social. Désireuse de voir son jeune cousin réussir et de se venger de ce monde de mensonge et de trahison à travers lui, elle fait ici son initiation en lui prodiguant les résultats de ses analyses et en lui prodiguant un certain nombre de conseils et de recommandations pour l’aider à se faire une place dans le monde. Elle utilise ainsi un ton, des images fortes, un vocabulaire du combat qui présentent en creux sa vision du monde et de la société : une guerre de tous contre tous où chacun est un loup pour l’autre. Paris est une jungle dans laquelle seuls les plus habiles, c’est-à-dire ceux qui jouent parfaitement leur rôle, les plus calculateurs, les plus froids… peuvent survivre. Dans la suite du roman, Vautrin confirmera ces mécanismes sociaux et présentera à Rastignac la même vision du monde de façon plus abrupte ce qui fera dire à Rastignac « il m’a dit crûment ce que Mme de Beauséant me disait en y mettant les formes ».

«
« vous ne seriez (…) la victime » l.13) et des asyndètes (cf.
l.9 et l.13).Les futurs expriment (avec la même
certitude) les découvertes que fera le jeune homme.
Cette anticipation d’un itinéraire dans lequel se trouvent
précisés à la fois les étapes, les obligations et les résultats de cette démarche découvre au
jeune Rastignac un monde fait d’hypocrisie, d’arrivisme et d’intérêt.
On a donc ici l’image d’une femme qui sait très bien de quoi elle parle et qui connait parfaitement (maintenant
qu’elle-même en a été la victime) les règles du jeu social, ses codes, ses dangers.
Son amertume vient du fait
qu’elle s’est laissé abuser, qu’elle a osé être sincère dans un monde de requins.
Ce qui explique également sa
réaction d’orgueil, sa dignité de « grande dame » l.4 ; elle n’a plus dès lors que le souci de former Rastignac pour
se venger du monde à travers lui (image des éclairs qui sortent de ses yeux l.4, qui rappelle les Erinyes, déesses
de la vengeance).
II Une image dépréciative de l’humanité et de la société
Le tableau que trace Mme de Beauséant des comportements humains fait apparaitre une humanité cruelle et
intéressée, toujours hypocrite.
Le ton est donné dès les premières lignes de l’extrait par la caractérisation du
monde, « infâme et méchant » (l.1), l’évocation des sarcasmes et des railleries.
Par la suite, la vicomtesse précise
cette première analyse en insistant sur tous les défauts du monde dans lequel va entrer Rastignac.
1) Un monde cruel et corrompu
Le tableau que trace Mme de Beauséant des comportements humains fait apparaitre une humanité cruelle et
intéressée, toujours hypocrite.
La cruauté est mise en valeur par l’exemple de l’ami faussement
consolateur (l.2-3 : image du « poignard » qui traduit la volonté de blesser, le plaisir sadique pris à voir l’autre
souffrir / « ami » fonctionne comme une antiphrase et souligne l’hypocrisie).
La corruption apparaît par la mise en
relief des intérêts et des bassesses.
La narratrice utilise un vocabulaire moral fortement dépréciatif lorsqu’elle
évoque la « corruption féminine », la « misérable vanité des hommes » l.7).
La critique est soulignée par les
procédés d’expression d’une quantité et d’une mesure : « vous sonderez combien » l.7, « vous toiserez la largeur »
l.7 (parallélisme des formules).
2) Un monde hypocrite
L’hypocrisie est l’instrument qui permet de réussir.
Cette idée est clairement exprimée dans le texte.
Aucune
attitude n’est présentée comme sincère et qui pis est, il ne faut surtout pas être sincère.
En effet, toute sincérité
conduit, selon la narratrice, à la situation de dominé (« vous deviendriez la victime » l.13 -14).
L’ensemble des
recommandations, qui font alterner les ordres et les interdits (« cachez-le », « ne le laissez jamais » / « gardez
bien », « ne le livrez pas » l.12 -14) met très clairement en relief le caractère vulnérable de la sincérité, et la
nécessité de se forger un masque social.
Cacher ses sentiments conduit en effet à jouer constamment un rôle.
3) Un monde de calcul
Si la spontanéité est bannie, c’est le calcul et la
dissimulation qui prévalent.
Tout, dans le texte, met en relief l’importance du calcul : l’emploi du verbe « calculer »,
en relation logique avec la réussite (comparaison progressive « plus… plus » l.9) montre qu’il y a là une relation de
cause à effet, illustrée par l’image de l’être humain pris comme instrument de l’ascension sociale (image très
cruelle des « chevaux de poste qu’on laisse crever à chaque relais » l.10).
La mise en relief d’une réflexion
permanente sur la manière de réussir montre que pour la vicomtesse rien n’est laissé au hasard : la réussite
dépend d’une utilisation raisonnée des moyens qu’offre la société.
C’est en fonction de cette conception réaliste et pessimiste que la vicomtesse définit les armes de la vie sociale : il
faut être calculateur, et se comporter en dominateur (prédateur) pour ne pas être dominé.
III Les instruments de la réussite sociale.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Père Goriot Fragment: “Rastignac ou l’appétit de réussite » Rastignac chez Mme de Beauséant
- Ce corpus est composé de trois extraits, Le Rouge et le Noir écrit en 1830 par Stendhal, Le père Goriot écrit en 1835 par Honoré de Balzac, Madame Bovary écrit en 1857 par Gustave Flaubert.
- Etude de Rastignac dans le père Goriot
- Dans cet extrait du Père Goriot de Balzac, Vautrin prodigue à Rastignac des conseils pour réussir dans la société.
- Lecture linéaire : Texte écho, Le père Goriot, « Un défi à la société »?