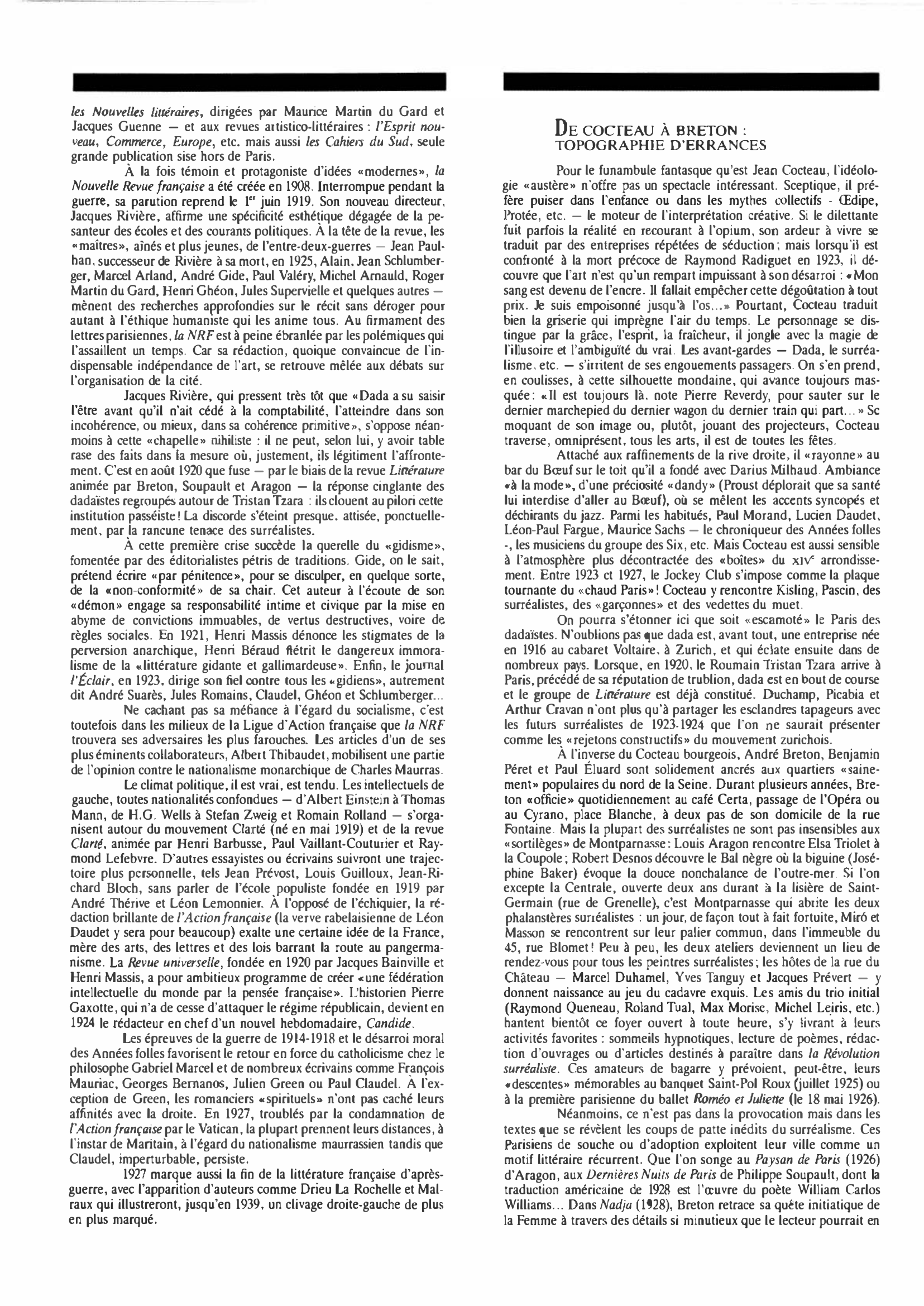LE PARIS Littéraire de 1920 à 1929 : Histoire
Publié le 01/01/2019
Extrait du document

Capitale intellectuelle. Paris a su se placer, depuis le xviie siècle, au cœur du processus d'internationalisation de la vie culturelle, scientifique et politique; mais Paris s'enorgueillit surtout d'être devenu le sanctuaire des libres-penseurs et des artistes. Au fil des âges, les tavernes, les salons et. plus récemment, les cafés ont perpétué cette fonction de sociabilité, mondaine et conviviale à la fois, propre aux cercles littéraires. Cette tradition, vivace jusqu’à la Belle Epoque, sommeille quelques années pour renaître de plus belle après la Grande Guerre. Dès lors, les écrivains délaissent le zinc des bistrots montmartrois, leur préférant les terrasses du boulevard Montparnasse et leur faune pittoresque. Kiki, reine du pavé et modèle légendaire de l'école de Paris, y mène la danse trépidante de la libération et entraîne. dans son sillage, une horde de bohèmes en quête de frivolités licencieuses. Pour les poètes et les écrivains, c'est la ruée sur le Dôme, le Petit Napolitain et, dès son ouverture en 1924, sur le Sélect... Vogue éphémère de ces établissements bientôt éclipsés par la Coupole. dont l'inauguration, le 20 décembre 1927, marque l'apothéose de la folle insouciance. Toutefois le Paris des lettres cache bien ses facettes «sérieuses» et. à ne dresser que le palmarès des excentricités fanfaronnes ou sordides — comme le faisaient complaisamment les gazettes de l'époque —. on risquerait d’édulcorer l'image d'une ville à mi-chemin du mythe et de l'anecdote.
Le parisianisme et ses cénacles
Après les surenchères de la fin du siècle dernier, l'édition française s'effondre. Une relance — précaire — s'annonce au cours des années vingt avec la diffusion, en moyenne, de 9000 à 11000 titres par an. Les succès de librairie portent au pinacle les auteurs de la littérature sentimentale comme Delly (Frédéric et Marie Petitjean de La Rosière) ou Maurice Dekobra (la Madone des sleepings. 1925). En revanche, la veine féministe esquissée en 1922 dans la Garçonne. de Victor Margueritte, fait scandale. Avides de sensations, les lecteurs plébiscitent volontiers le roman policier, d'espionnage ou d'anticipation (notons qu'en 1926 est publiée aux Etats-Unis la première revue de «science-fiction» : Amazing.)
D'autre part, le marché du livre est en pleine mutation. Des maisons aussi importantes, avant 1914. que Calmann-Lévy, Fasquelle, Lemerre ou Ollendorf perdent de leur influence. Seuls prospèrent les éditeurs qui renoncent à l'artisanat et optent pour une gestion rationnelle de leur entreprise. Bernard Grasset, «inventeur» de Radi-guet et support des «quatre M» (Montherlant, Maurois, Mauriac, Morand), illustre bien ce type nouveau du «self-made man». Le succès peut aussi venir d’une politique audacieuse : celle de Jacques Chardonne. par exemple, qui met l'accent, chez Stock, sur les œuvres étrangères (A l'Ouest rien de nouveau). Parmi les maisons florissantes qui se sont entourées de «valeurs sûres», citons Plon (avec Georges Bernanos, Paul Bourget, julien Green). Flammarion (avec Claude Farrère et Maurice Dekobra). Albin Michel (Roland Dorgelès, Francis Carco). etc.
Si l'on excepte Paris-Soir, les journaux à grand tirage connaissent des difficultés de plus en plus accusées. Mais le marché s'ouvre aux hebdomadaires culturels — le 21 octobre 1922 sont créées

«
les
Nou velles liuéraires, dirigées par Maurice Martin du Gard et
Jacques Guenne - et aux revues artistico-littéraires : l'Esprit nou·
veau, Commerce, Europe, etc.
mais aussi les Cahiers du Sud, seule
grande publication sise hors de Paris.
À la fois témoin et protagoniste d'idées «modernes», la
Nouvelle Revue française a été créée en 1908.
Interrompue pendant la
guerre, sa parution reprend le 1" juin 1919.
Son nouveau directeur,
Jacques Rivière, affirme une spécificité esthétique dégagée de la pe
santeur des écoles et des courants politiques.
À la tête de la revue, les
«maitres», aînés et plus jeunes, de l'entre-deux-guerres -Jean Paul
han, successeur de Rivière à sa mort, en 1925, Alain, Jean Schlumber
ger, Marcel Arland, André Gide, Paul Valéry, Michel Arnauld, Roger
Martin du Gard, Henri Ghéon, Jules Supervielle et quelques autres -
mènent des recherches approfondies sur le récit sans déroger pour
autant à l'éthique humaniste qui les anime tous.
Au firmament des
lettres parisiennes, la NRF est à peine ébranlée par les polémiques qui
l'assaillent un temps.
Car sa rédaction, quoique convaincue de l'in
dispensable indépendance de l'art, se retrouve mêlée aux débats sur
l'organisation de la cité.
Jacques Rivière, qui pressent très tôt que «Dada a su saisir
l'être avant qu'il n'ait cédé à la comptabilité, l'atteindre dans son
incohérence, ou mieux, dans sa cohérence primitive», s'oppose néan·
moins à cette «Chapelle» nihiliste : il ne peut, selon lui, y avoir table
rase des faits dans la mesure où, justement, ils légitiment l'affronte
ment.
C'est en août 1920 que fuse -par le biais de la revue Liuérature
animée par Breton, Soupault et Aragon -la réponse cinglante des
dadaïstes regroupés autour de Tristan Tzara : ils clouent au pilori cette
institution passéiste! La discorde s'éteint presque.
attisée, ponctuelle·
ment, par la rancune tenace des surréalistes.
À cette première crise succède la querelle du «gidisme»,
fomentée par des éditorialistes pétris de traditions.
Gide, on le sait,
prétend écrire «par pénitence», pour se disculper, en quelque sorte,
de la «non-conformité>> de sa chair.
Cet auteur à l'écoute de son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FÉMINISME ET FÉMINITÉ Littéraire de 1920 à 1929 : Histoire
- LE SURRÉALISME de 1920 à 1929 : Histoire
- LA MUSIQUE de 1920 à 1929 : Histoire
- Les arts décoratifs de 1920 à 1929 : Histoire
- L'art de l'affiche de 1920 à 1929 : Histoire