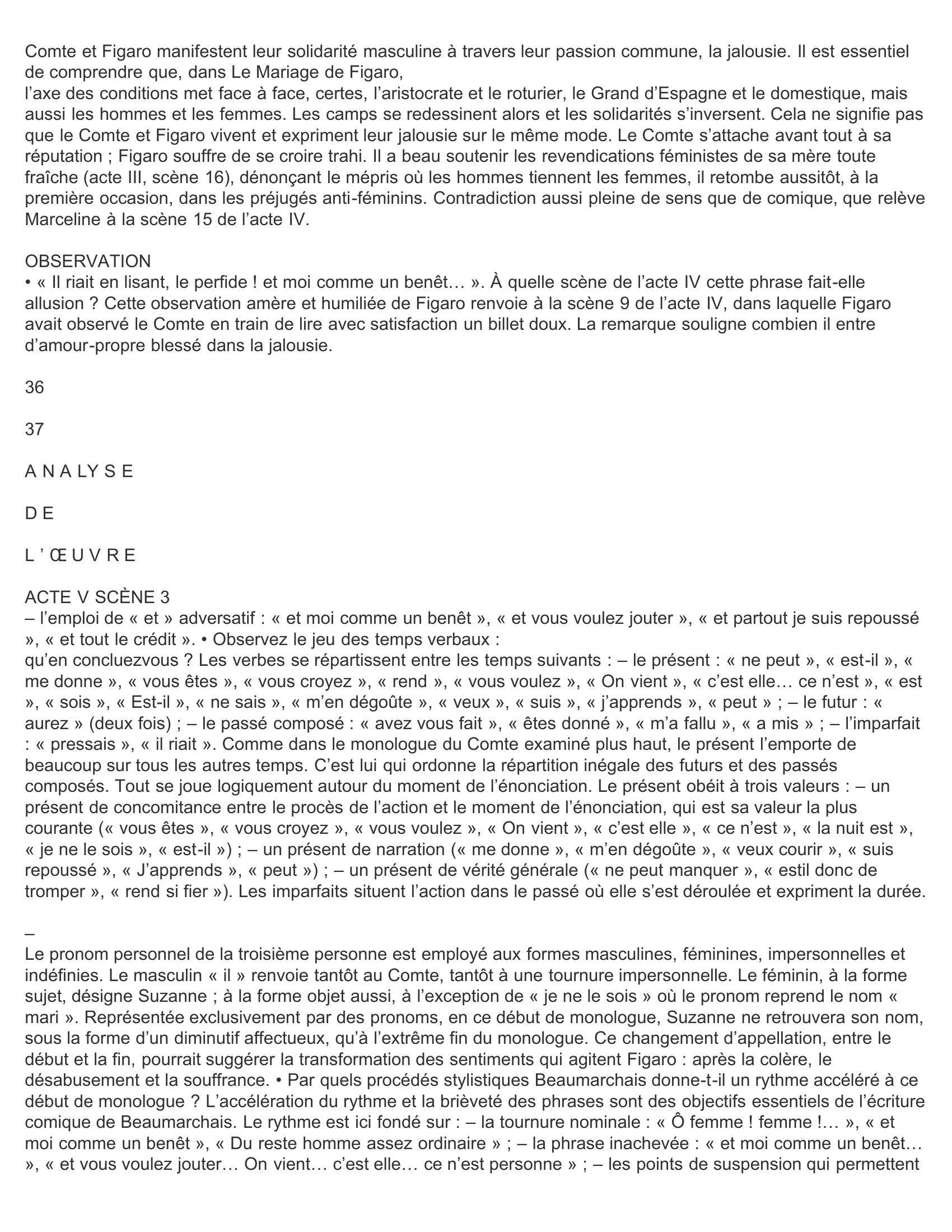Le mariage de figaro - ACTE V SCÈNE 3
Publié le 05/09/2018
Extrait du document
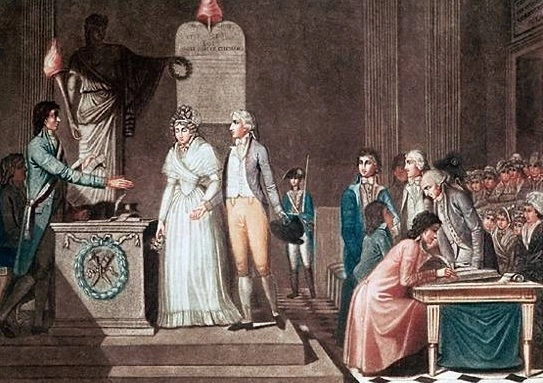
INTERPRÉTATIONS
• Quelle image des femmes Figaro donne-t-il ici ? Figaro assimile la femme, sur le modèle biblique, au serpent rusé, tentateur et trompeur. Mais l’action du Mariage interdit au spectateur des’identifier à ce propos du personnage et l’oblige à considérer ce motif avec une distance ironique. Figaro sera d’ailleurs contraint de se prosterner devant Suzanne et de rendre hommage au sexe féminin (acte V, scène 8), comme le Comte lui-même (acte V, scène 19). • Comment expliquer cette sortie anti-féminine ? La jalousie et l’humiliation poussent ici Figaro à reprendre à son compte une représentation immémoriale de la femme. • L’opposition du Comte et de Figaro est-elle celle de deux caractères ? Conformément à la théorie de Diderot sur les personnages, à laquelle il s’était lui-même rallié dans l’Essai sur le genre sérieux, Beaumarchais n’oppose pas ici deux caractères, mais deux conditions. • En comparant la scène 4 de l’acte III et ce passage, montrez en quoi les deux monologues du Comte et de Figaro n’ont ni le même ton ni la même portée. Comparé au monologue du Comte, celui de Figaro est, bien sûr, d’une tout autre ampleur. C’est sans doute la première fois, dans l’histoire du théâtre français, qu’il est donné à un valet de parler avec une telle passion et une telle gravité de son moi et de sa destinée, jusqu’à devenir, dans le plus long monologue du théâtre classique, le porte-parole de ceux qui n’ont ni noblesse, ni fortune, ni rang, ni places, bref, de tous les spectateurs du parterre, devenu l’image du tiers état.
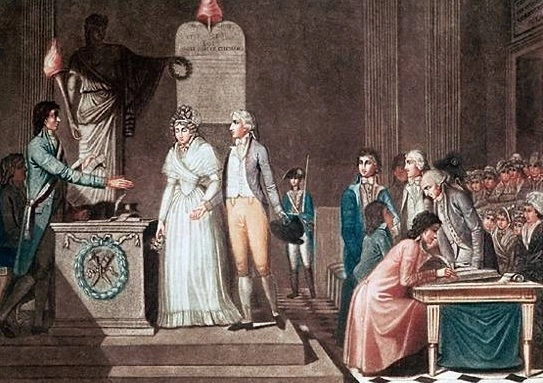
«
Comte et Figaro manifestent leur solidarité masculine à travers leur passion commune, la jalousie.
Il est essentiel
de comprendre que, dans Le Mariage de Figaro,
l’axe des conditions met face à face, certes, l’aristocrate et le roturier, le Grand d’Espagne et le domestique, mais
aussi les hommes et les femmes.
Les camps se redessinent alors et les solidarités s’inversent.
Cela ne signifie pas
que le Comte et Figaro vivent et expriment leur jalousie sur le même mode.
Le Comte s’attache avant tout à sa
réputation ; Figaro souffre de se croire trahi.
Il a beau soutenir les revendications féministes de sa mère toute
fraîche (acte III, scène 16), dénonçant le mépris où les hommes tiennent les femmes, il retombe aussitôt, à la
première occasion, dans les préjugés anti -féminins.
Contradiction aussi pleine de sens que de comique, que relève
Marceline à la scène 15 de l’acte IV.
OBSERVATION
• « Il riait en lisant, le perfide ! et moi comme un benêt… ».
À quelle scène de l’acte IV cette phrase fait -elle
allusion ? Cette observation amère et humiliée de Figaro renvoie à la scène 9 de l’acte IV, dans laquelle Figaro
avait observé le Comte en train de lire avec satisfaction un billet doux.
La remarque souligne combien il entre
d’amour -propre blessé dans la jalousie.
36
37
A N A LY S E
D E
L ’ Œ U V R E
ACTE V SCÈNE 3
– l’emploi de « et » adversatif : « et moi comme un benêt », « et vous voulez jouter », « et partout je suis repoussé
», « et tout le crédit ».
• Observez le jeu des temps verbaux :
qu’en concluezvous ? Les verbes se répartissent entre les temps suivants : – le présent : « ne peut », « est -il », «
me donne », « vous êtes », « vous croyez », « rend », « vous voulez », « On vient », « c’est elle… ce n’est », « est
», « sois », « Est-il », « ne sais », « m’en dégoûte », « veux », « suis », « j’apprends », « peut » ; – le futur : «
aurez » (deux fois) ; – le passé composé : « avez vous fait », « êtes donné », « m’a fallu », « a mis » ; – l’imparfait
: « pressais », « il riait ».
Comme dans le monologue du Comte examiné plus haut, le présent l’emporte de
beaucoup sur tous les autres temps.
C’est lui qui ordonne la répartition inégale des futurs et des passés
composés.
Tout se joue logiquement autour du moment de l’énonciation.
Le présent obéit à trois valeurs : – un
présent de concomitance entre le procès de l’action et le moment de l’énonciation, qui est sa valeur la plus
courante (« vous êtes », « vous croyez », « vous voulez », « On vient », « c’est elle », « ce n’est », « la nuit est »,
« je ne le sois », « est -il ») ; – un présent de narration (« me donne », « m’en dégoûte », « veux courir », « suis
repoussé », « J’apprends », « peut ») ; – un présent de vérité générale (« ne peut manquer », « estil donc de
tromper », « rend si fier »).
Les imparfaits situent l’action dans le passé où elle s’est déroulée et expriment la durée.
–
Le pronom personnel de la troisième personne est employé aux formes masculines, féminines, impersonnelles et
indéfinies.
Le masculin « il » renvoie tantôt au Comte, tantôt à une tournure impersonnelle.
Le féminin, à la forme
sujet, désigne Suzanne ; à la forme objet aussi, à l’exception de « je ne le sois » où le pronom reprend le nom «
mari ».
Représentée exclusivement par des pronoms, en ce début de monologue, Suzanne ne retrouvera son nom,
sous la forme d’un diminutif affectueux, qu’à l’extrême fin du monologue.
Ce changement d’appellation, entre le
début et la fin, pourrait suggérer la transformation des sentiments qui agitent Figaro : après la colère, le
désabusement et la souffrance.
• Par quels procédés stylistiques Beaumarchais donne-t -il un rythme accéléré à ce
début de monologue ? L’accélération du rythme et la brièveté des phrases sont des objectifs essentiels de l’écriture
comique de Beaumarchais.
Le rythme est ici fondé sur : – la tournure nominale : « Ô femme ! femme !… », « et
moi comme un benêt », « Du reste homme assez ordinaire » ; – la phrase inachevée : « et moi comme un benêt…
», « et vous voulez jouter… On vient… c’est elle… ce n’est personne » ; – les points de suspension qui permettent.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le mariage de Figaro Beaumarchais Acte V scène 6
- LA 1 : Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1784, acte I, scène
- Le Mariage du Figaro Beaumarchais Acte V, scène 3 Non, Monsieur le Comte, vous ne l'aurez pas.
- Mariage de Figaro Acte I Scène I
- Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, Acte I Scène 1