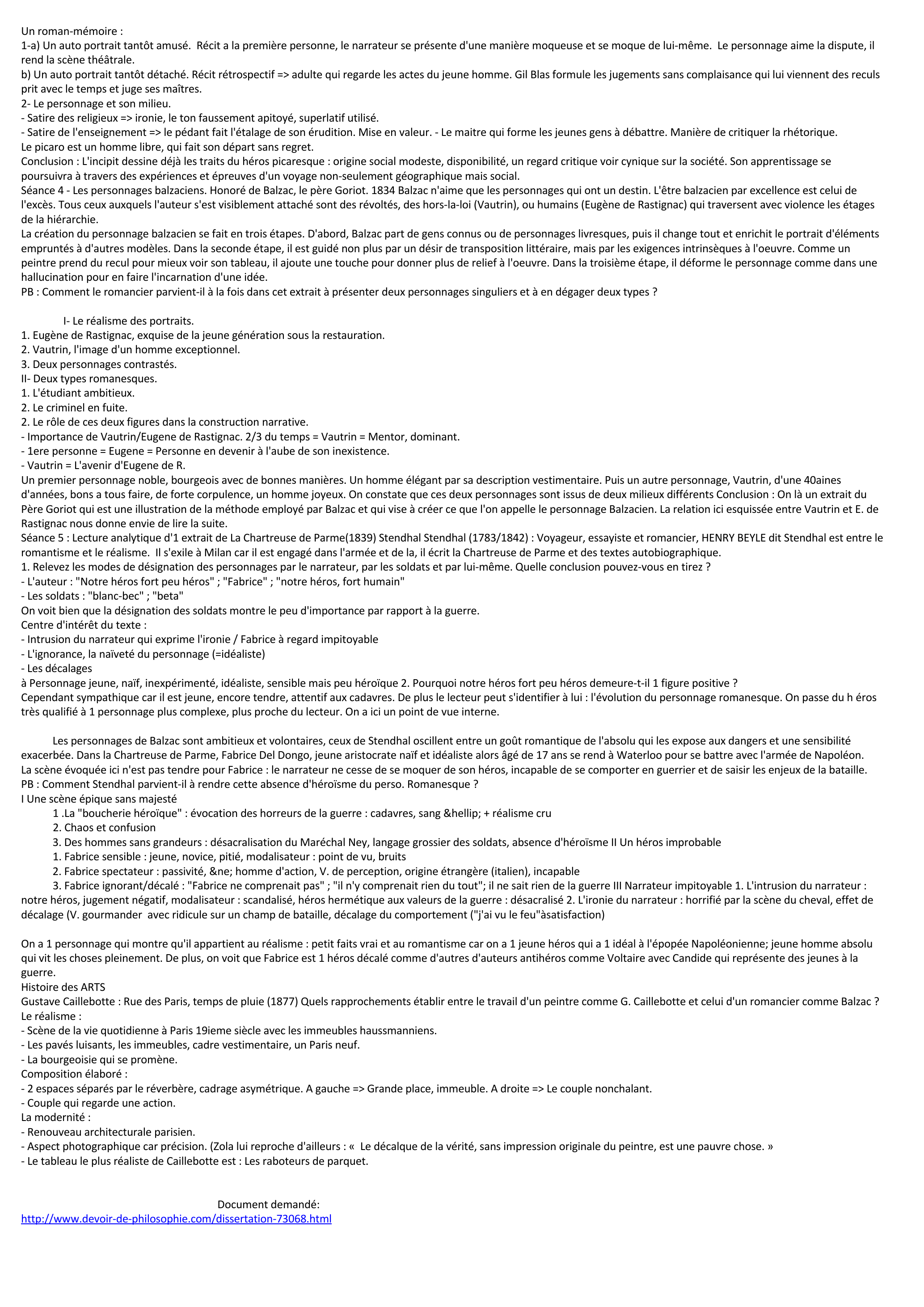Le héros de roman et ses métamorphoses
Publié le 01/07/2012
Extrait du document
I- Le réalisme des portraits.
1. Eugène de Rastignac, exquise de la jeune génération sous la restauration.
2. Vautrin, l'image d'un homme exceptionnel.
3. Deux personnages contrastés.
II- Deux types romanesques.
1. L'étudiant ambitieux.
2. Le criminel en fuite.
2. Le rôle de ces deux figures dans la construction narrative.
- Importance de Vautrin/Eugene de Rastignac. 2/3 du temps = Vautrin = Mentor, dominant.
- 1ere personne = Eugene = Personne en devenir à l'aube de son inexistence.
- Vautrin = L'avenir d'Eugene de R.
Un premier personnage noble, bourgeois avec de bonnes manières. Un homme élégant par sa description vestimentaire. Puis un autre personnage, Vautrin, d'une 40aines d'années, bons a tous faire, de forte corpulence, un homme joyeux. On constate que ces deux personnages sont issus de deux milieux différents Conclusion : On là un extrait du Père Goriot qui est une illustration de la méthode employé par Balzac
«
Un roman-mémoire :1-a) Un auto portrait tantôt amusé.
Récit a la première personne, le narrateur se présente d'une manière moqueuse et se moque de lui-même.
Le personnage aime la dispute, ilrend la scène théâtrale.b) Un auto portrait tantôt détaché.
Récit rétrospectif => adulte qui regarde les actes du jeune homme.
Gil Blas formule les jugements sans complaisance qui lui viennent des reculsprit avec le temps et juge ses maîtres.2- Le personnage et son milieu.- Satire des religieux => ironie, le ton faussement apitoyé, superlatif utilisé.- Satire de l'enseignement => le pédant fait l'étalage de son érudition.
Mise en valeur.
- Le maitre qui forme les jeunes gens à débattre.
Manière de critiquer la rhétorique.Le picaro est un homme libre, qui fait son départ sans regret.Conclusion : L'incipit dessine déjà les traits du héros picaresque : origine social modeste, disponibilité, un regard critique voir cynique sur la société.
Son apprentissage sepoursuivra à travers des expériences et épreuves d'un voyage non-seulement géographique mais social.Séance 4 - Les personnages balzaciens.
Honoré de Balzac, le père Goriot.
1834 Balzac n'aime que les personnages qui ont un destin.
L'être balzacien par excellence est celui del'excès.
Tous ceux auxquels l'auteur s'est visiblement attaché sont des révoltés, des hors-la-loi (Vautrin), ou humains (Eugène de Rastignac) qui traversent avec violence les étagesde la hiérarchie.La création du personnage balzacien se fait en trois étapes.
D'abord, Balzac part de gens connus ou de personnages livresques, puis il change tout et enrichit le portrait d'élémentsempruntés à d'autres modèles.
Dans la seconde étape, il est guidé non plus par un désir de transposition littéraire, mais par les exigences intrinsèques à l'oeuvre.
Comme unpeintre prend du recul pour mieux voir son tableau, il ajoute une touche pour donner plus de relief à l'oeuvre.
Dans la troisième étape, il déforme le personnage comme dans unehallucination pour en faire l'incarnation d'une idée.PB : Comment le romancier parvient-il à la fois dans cet extrait à présenter deux personnages singuliers et à en dégager deux types ? I- Le réalisme des portraits.1.
Eugène de Rastignac, exquise de la jeune génération sous la restauration.2.
Vautrin, l'image d'un homme exceptionnel.3.
Deux personnages contrastés.II- Deux types romanesques.1.
L'étudiant ambitieux.2.
Le criminel en fuite.2.
Le rôle de ces deux figures dans la construction narrative.- Importance de Vautrin/Eugene de Rastignac.
2/3 du temps = Vautrin = Mentor, dominant.- 1ere personne = Eugene = Personne en devenir à l'aube de son inexistence.- Vautrin = L'avenir d'Eugene de R.Un premier personnage noble, bourgeois avec de bonnes manières.
Un homme élégant par sa description vestimentaire.
Puis un autre personnage, Vautrin, d'une 40ainesd'années, bons a tous faire, de forte corpulence, un homme joyeux.
On constate que ces deux personnages sont issus de deux milieux différents Conclusion : On là un extrait duPère Goriot qui est une illustration de la méthode employé par Balzac et qui vise à créer ce que l'on appelle le personnage Balzacien.
La relation ici esquissée entre Vautrin et E.
deRastignac nous donne envie de lire la suite.Séance 5 : Lecture analytique d'1 extrait de La Chartreuse de Parme(1839) Stendhal Stendhal (1783/1842) : Voyageur, essayiste et romancier, HENRY BEYLE dit Stendhal est entre leromantisme et le réalisme.
Il s'exile à Milan car il est engagé dans l'armée et de la, il écrit la Chartreuse de Parme et des textes autobiographique.1.
Relevez les modes de désignation des personnages par le narrateur, par les soldats et par lui-même.
Quelle conclusion pouvez-vous en tirez ?- L'auteur : "Notre héros fort peu héros" ; "Fabrice" ; "notre héros, fort humain"- Les soldats : "blanc-bec" ; "beta"On voit bien que la désignation des soldats montre le peu d'importance par rapport à la guerre.Centre d'intérêt du texte :- Intrusion du narrateur qui exprime l'ironie / Fabrice à regard impitoyable- L'ignorance, la naïveté du personnage (=idéaliste)- Les décalagesà Personnage jeune, naïf, inexpérimenté, idéaliste, sensible mais peu héroïque 2.
Pourquoi notre héros fort peu héros demeure-t-il 1 figure positive ?Cependant sympathique car il est jeune, encore tendre, attentif aux cadavres.
De plus le lecteur peut s'identifier à lui : l'évolution du personnage romanesque.
On passe du h érostrès qualifié à 1 personnage plus complexe, plus proche du lecteur.
On a ici un point de vue interne.
Les personnages de Balzac sont ambitieux et volontaires, ceux de Stendhal oscillent entre un goût romantique de l'absolu qui les expose aux dangers et une sensibilitéexacerbée.
Dans la Chartreuse de Parme, Fabrice Del Dongo, jeune aristocrate naïf et idéaliste alors âgé de 17 ans se rend à Waterloo pour se battre avec l'armée de Napoléon.
La scène évoquée ici n'est pas tendre pour Fabrice : le narrateur ne cesse de se moquer de son héros, incapable de se comporter en guerrier et de saisir les enjeux de la bataille.PB : Comment Stendhal parvient-il à rendre cette absence d'héroïsme du perso.
Romanesque ?I Une scène épique sans majesté 1 .La "boucherie héroïque" : évocation des horreurs de la guerre : cadavres, sang … + réalisme cru 2.
Chaos et confusion 3.
Des hommes sans grandeurs : désacralisation du Maréchal Ney, langage grossier des soldats, absence d'héroïsme II Un héros improbable 1.
Fabrice sensible : jeune, novice, pitié, modalisateur : point de vu, bruits 2.
Fabrice spectateur : passivité, ≠ homme d'action, V.
de perception, origine étrangère (italien), incapable 3.
Fabrice ignorant/décalé : "Fabrice ne comprenait pas" ; "il n'y comprenait rien du tout"; il ne sait rien de la guerre III Narrateur impitoyable 1.
L'intrusion du narrateur :notre héros, jugement négatif, modalisateur : scandalisé, héros hermétique aux valeurs de la guerre : désacralisé 2.
L'ironie du narrateur : horrifié par la scène du cheval, effet dedécalage (V.
gourmander avec ridicule sur un champ de bataille, décalage du comportement ("j'ai vu le feu"àsatisfaction) On a 1 personnage qui montre qu'il appartient au réalisme : petit faits vrai et au romantisme car on a 1 jeune héros qui a 1 idéal à l'épopée Napoléonienne; jeune homme absoluqui vit les choses pleinement.
De plus, on voit que Fabrice est 1 héros décalé comme d'autres d'auteurs antihéros comme Voltaire avec Candide qui représente des jeunes à laguerre.Histoire des ARTSGustave Caillebotte : Rue des Paris, temps de pluie (1877) Quels rapprochements établir entre le travail d'un peintre comme G.
Caillebotte et celui d'un romancier comme Balzac ?Le réalisme :- Scène de la vie quotidienne à Paris 19ieme siècle avec les immeubles haussmanniens.- Les pavés luisants, les immeubles, cadre vestimentaire, un Paris neuf.- La bourgeoisie qui se promène.Composition élaboré :- 2 espaces séparés par le réverbère, cadrage asymétrique.
A gauche => Grande place, immeuble.
A droite => Le couple nonchalant.- Couple qui regarde une action.La modernité :- Renouveau architecturale parisien.- Aspect photographique car précision.
(Zola lui reproche d'ailleurs : « Le décalque de la vérité, sans impression originale du peintre, est une pauvre chose.
»- Le tableau le plus réaliste de Caillebotte est : Les raboteurs de parquet.
Document demandé:http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-73068.html.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Evolution des caractéristiques du héros de roman du XVII ème siècle au XXIème siècle
- Le roman peut-il se passer de héros ?
- SPERELLI André. Héros du roman de Gabrielle D’Annunzio l'Enfant de volupté
- SCHLEMIHL Peter. Héros du roman d’Adalbert von Chamisso
- Le personnage de LOVELACE. Héros du roman de Samuel Richardson