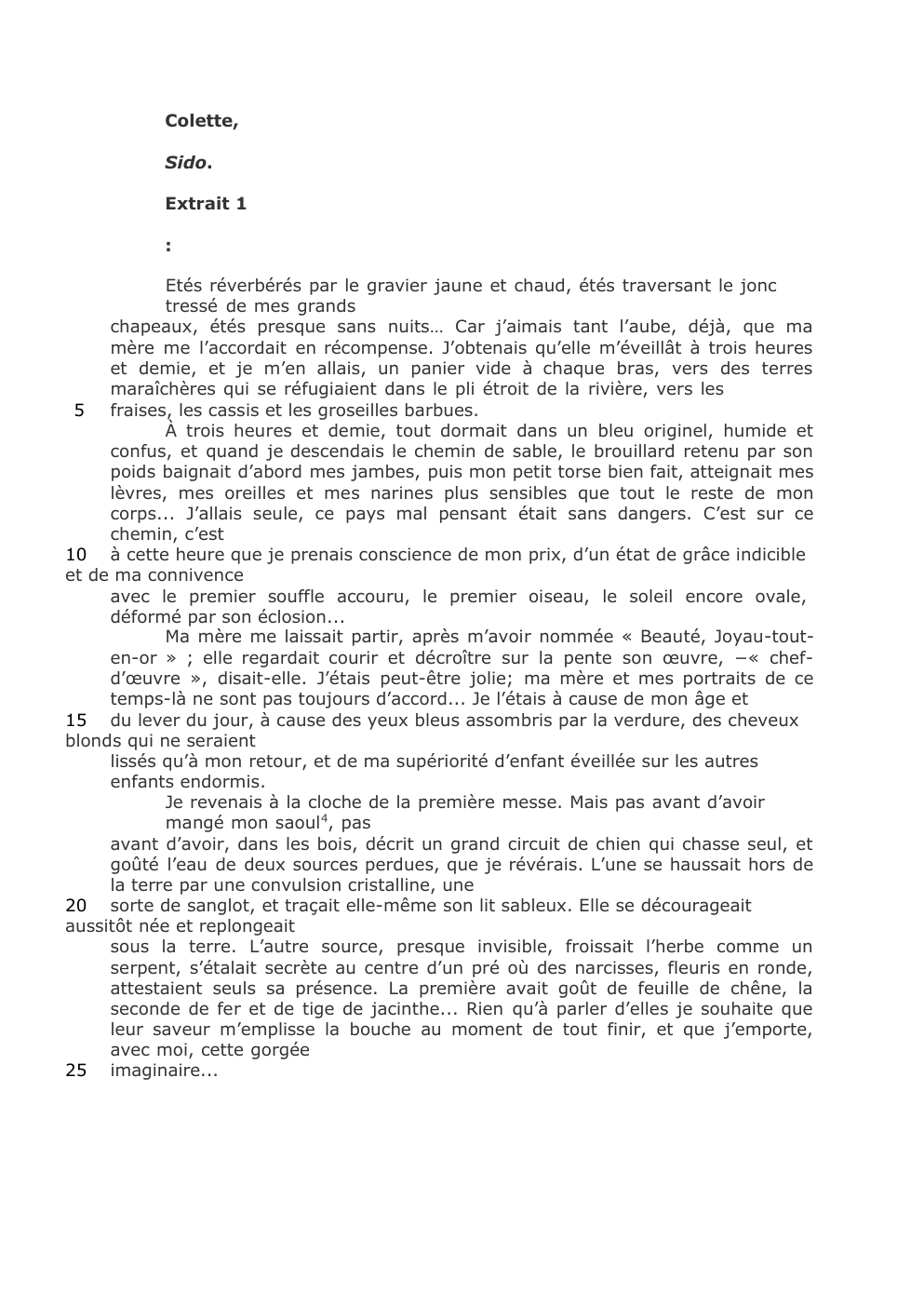Le célébration de l'aube Colette, Sido. Extrait 1
Publié le 08/05/2023
Extrait du document
«
Colette,
Sido.
Extrait 1
:
Etés réverbérés par le gravier jaune et chaud, étés traversant le jonc
tressé de mes grands
chapeaux, étés presque sans nuits… Car j’aimais tant l’aube, déjà, que ma
mère me l’accordait en récompense.
J’obtenais qu’elle m’éveillât à trois heures
et demie, et je m’en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres
maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les
5
fraises, les cassis et les groseilles barbues.
À trois heures et demie, tout dormait dans un bleu originel, humide et
confus, et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son
poids baignait d’abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes
lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon
corps...
J’allais seule, ce pays mal pensant était sans dangers.
C’est sur ce
chemin, c’est
10 à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d’un état de grâce indicible
et de ma connivence
avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale,
déformé par son éclosion...
Ma mère me laissait partir, après m’avoir nommée « Beauté, Joyau-touten-or » ; elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre, −« chefd’œuvre », disait-elle.
J’étais peut-être jolie; ma mère et mes portraits de ce
temps-là ne sont pas toujours d’accord...
Je l’étais à cause de mon âge et
15 du lever du jour, à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux
blonds qui ne seraient
lissés qu’à mon retour, et de ma supériorité d’enfant éveillée sur les autres
enfants endormis.
Je revenais à la cloche de la première messe.
Mais pas avant d’avoir
mangé mon saoul 4, pas
avant d’avoir, dans les bois, décrit un grand circuit de chien qui chasse seul, et
goûté l’eau de deux sources perdues, que je révérais.
L’une se haussait hors de
la terre par une convulsion cristalline, une
20 sorte de sanglot, et traçait elle-même son lit sableux.
Elle se décourageait
aussitôt née et replongeait
sous la terre.
L’autre source, presque invisible, froissait l’herbe comme un
serpent, s’étalait secrète au centre d’un pré où des narcisses, fleuris en ronde,
attestaient seuls sa présence.
La première avait goût de feuille de chêne, la
seconde de fer et de tige de jacinthe...
Rien qu’à parler d’elles je souhaite que
leur saveur m’emplisse la bouche au moment de tout finir, et que j’emporte,
avec moi, cette gorgée
25 imaginaire...
Eléments sur le genre du récit dans tout le chapitre :
Sido s’inscrit dans le genre de l’autobiographie, fondé par Rousseau.
Colette
signe un contrat de vérité avec le lecteur et narre sa propre histoire (« je »
narrant et « je » narré renvoient à la même personne, celle de l’autrice).
Ici,
elle met l’accent sur la formation de sa personnalité.
Elle s’éloigne néanmoins
du modèle en rompant avec la linéarité chronologique.
Le mouvement suit le
fonctionnement aléatoire de la mémoire, selon un enchaînement souple qui
reconstitue la vie au fur et à mesure des voix, des gestes, des souvenirs et
reconstruit sa vie comme une constellation dont le centre est sa mère.
Colette
renouvelle donc le traitement du thème de l’enfance.
Lisez le texte et traitez les questions suivantes.
Première partie du texte : « Car j’aimais….son éclosion ».
1- Débattez du meilleur titre pour cette partie : La solitaire – La grâce de
l’aube – A la rencontre sensuelle de l’aube.
2- Faites l’analyse logique de la première phrase.
Quelle image
donne-t-elle de Colette ? 3- Que révèle cette première phrase sur la
place de Sido pour Colette ?
4- Soulignez ce qui renvoie aux cinq sens.
Quelle description Colette
propose-t-elle de l’aube ? 5- Quels éléments présentent l’aube comme une
initiation ?
Deuxième partie : « Ma mère me laissait partir….enfants endormis ».
1- Que révèlent les surnoms donnés par Sido à sa fille ?
2- La narratrice adulte pense-t-elle la même chose d’elle même que sa mère
à l’époque ? Observez la modélisation employée et les preuves du décalage
entre le « Je narré »et le « je narrant ».
3- A quoi est due la supériorité de Colette-enfant sur
les autres enfants ? 4- Proposez un titre à cette partie.
Troisième partie : « je revenais….gorgée imaginaire.
»
Titre possible : Le retour et le détour par les sources.
1- Quelle est l’importance symbolique de l’eau ? Pensez à ses significations
religieuses et à tout ce qui la relie à la vie.
2- « un grand circuit de chien ».
Dans cette métaphore, l’enfant est
comparée à un chien de chasse.
Que chasse-t-elle ?
3- Quelle est la racine étymologique du verbe « révérer » ? Que révèle-t-elle
sur la manière dont
Colette considère la source ?
4- Entourez les termes qui personnifient la nature et commentez-les.
Que
pouvez-vous dire sur la relation qui unit l’enfant à la nature ?
5- Analysez le changement dans le temps des verbes dans la dernière phrase
du texte.
Mots-clés : autobiographie, célébration, panthéisme, singularité, sensualité,
mémoire.
Analyse :
L’extrait, 1er chapitre, figure centrale, la narratrice et écriture à la 1 ère
personne = écriture autobiographique
Contextualisation :
« Ressusciter ce que je fus ! » Si les premières pages cristallisent la figure
maternelle, souveraine de son foyer et de son jardin, la promenade à l’aube
constitue un épisode autonome au sein duquel l’adulte ressuscite l’enfant
d’autrefois, dans son exploration du monde, à la naissance du jour.
Problématique :
Il s’agira d’analyser en quoi cet épisode, oscillant entre autobiographie, conte
et mythe, célèbre le monde de l’enfance dans sa connivence avec la nature.
Par quel moyen ce texte, proche du poème en prose, révèle-t-il le lien très fort,
qui unit, depuis son plus jeune âge, la narratrice à la nature ?
3 mouvements :
1les deux premiers paragraphes : l’échappée dans la nature ;
description de l’aube comme expérience mémorable
2le second paragraphe : une
éducation hors norme 3- le dernier
paragraphe : un éveil sensoriel
Premier mouvement :
Cet épisode de l’échappée dans la nature, moment-clé de la célébration de
l’enfance, ressuscite le moment vécu en lui conférant une dimension
initiatique, de sorte que le récit oscille entre autobiographie et conte
intemporel.
P remière phrase : la première phrase met en place un décor intemporel et
mystérieux, inscrivant l’épisode de la promenade à l’aube dans un temps
archaïque et sans âge, à l’intersection du monde ordinaire et du merveilleux.
La
narratrice se remémore au pluriel les étés auxquels elle consacre une phrase
non verbale, achevée par des points de suspension et marquée par le rythme
ternaire.
L’anaphore « étés » permet d’évoquer à la fois, la chaleur du soleil,
des graviers chauds mais d’introduire aussi, grâce à un glissement « étés
presque sans nuit », les promenades effectuées par la fillette à l’aube.
Si l’enfant est présente par métonymie, elle n’est pas décrite physiquement et
disparaît sous son couvre-chef.
Deuxième phrase : la narratrice explique sa fascination pour l’aube à travers
la conjonction « car » et l’adverbe d’intensité « tant ».
ces expéditions se
présentent comme rituelles grâce à l’imparfait et l’adverbe « déjà » rappelle
l’une des caractéristiques du récit autobiographique, la superposition du
« je » narré et du « je » narrant ; l’adulte reconnaît en elle un goût pour
l’aube qu’elle avait déjà enfant.
La métaphore fait de l’aube une récompense, un cadeau palpable, instaurant
dès lors Sido comme une divinité bienfaisante, offrant la nature à sa fille.
Troisième phrase : elle ouvre le récit de l’expédition dont la singularité est
renforcée par la précision temporelle, soulignant l’éducation hors norme – les
enfants n’ayant pas l’habitude de se lever tôt.
Or l’imparfait d’habitude signale
au contraire le caractère itératif de la promenade à l’aube initiée par Sido.
La fillette est décrite comme une néophyte partant à la découverte du monde,
ce que suggère l’image des paniers vides.
Le regard amusé de la narratrice
adulte sur les destinations a priori assez banales, mais envisagées comme de
véritables exploits pour l’enfant d’alors ; l’énumération « es fraises, les cassis
et les groseilles barbues » ; rythme ternaire qui donne l’impression d’une
amplification.
La phrase bien cadencée mime le pas de la jeune fille qui se
dirige vers des lieux secrets : les terres maraîchères « se réfugiaient dans le
pli étroit de la rivière ».
Le regard que porte l’enfant sur la nature est à la fois naïf et révélateur de
sa connivence avec la nature personnifiée :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Colette, Sido (extrait).
- Plaisir de l’aube de Colette, Sido. Commentaire
- Plaisir de l'aube: SIDO, Colette
- Plaisir de l'aube. Colette, Sido.
- SIDO de Colette : Fiche de lecture