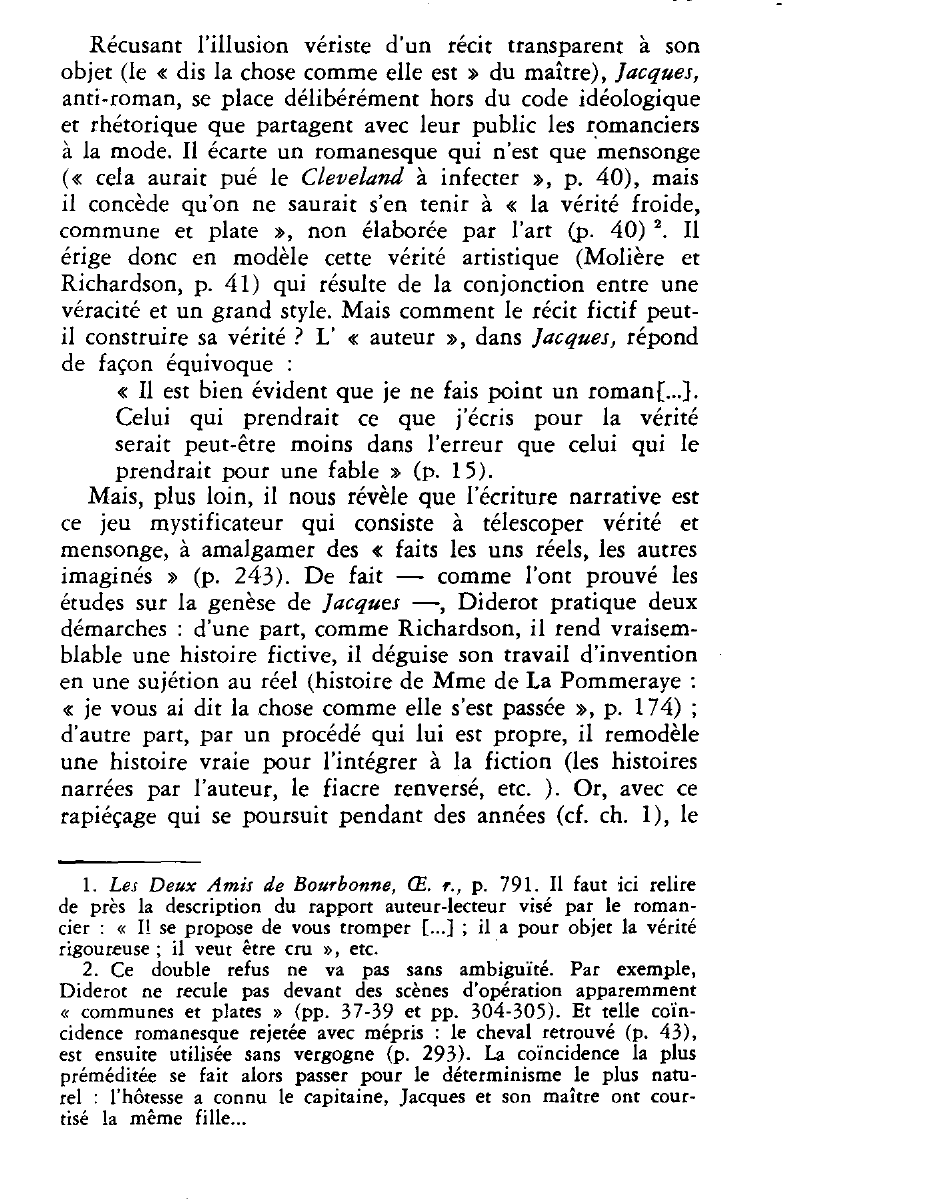L'art du mentir vrai : réalisme et mystification
Publié le 30/06/2015
Extrait du document


«
55
Récusant l'illusion venste d'un reCit transparent à son
objet (le « dis la chose comme elle est » du maître), Jacques, anti-roman, se place délibérément hors du code idéologique
et rhétorique que partagent avec leur public les romanciers
à la mode.
Il écarte un romanesque qui n'est que 'mensonge ( « cela aurait pué le Cleveland à infecter », p.
40), mais
il concède qu'on ne saurait s'en tenir à « la vérité froide,
commune et plate », non élaborée par l'art (p.
40) 2
• Il
érige donc en modèle cette vérité artistique (Molière et
Richardson, p.
41) qui résulte de la conjonction entre une
véracité et
un grand style.
Mais comment le récit fictif peut il construire sa vérité ? L' « auteur », dans Jacques, répond
de façon équivoque :
« Il est bien évident que je ne fais point un roman[.
..
}.
Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vente serait peut-être moins dans l'erreur que celui qui le
prendrait pour une fable» (p.
15).
Mais, plus loin, il nous révèle que l'écriture narrative est ce jeu mystificateur qui consiste à télescoper vérité et mensonge, à amalgamer des « faits les uns réels, les autres
imaginés » (p.
243).
De fait -comme l'ont prouvé les
études sur la genèse de Jacques -, Diderot pratique deux
démarches : d'une part, comme Richardson, il rend vraisem blable une histoire fictive, il déguise son travail d'invention
en une sujétion au réel (histoire de Mme de La Pommeraye : « je vous ai dit la chose comme elle s'est passée »,p.
174) ;
d'autre part, par un procédé qui lui est propre, il remodèle
une histoire vraie pour l'intégrer à la fiction (les histoires
narrées par l'auteur, le fiacre renversé, etc.
).
Or, avec ce
rapiéçage qui se poursuit pendant des années (cf.
ch.
1), le
1.
Les Deux Amis de Bourbonne, Œ.
r., p.
791.
Il faut ici relire
de près la description du rapport auteur-lecteur visé par le roman cier : « Il se propose de vous tromper [ ...
] ; il a pour objet la vérité rigoureuse ; il veut être cru », etc.
2.
Ce double refus ne va pas sans ambiguïté.
Par exemple,
Diderot ne recule pas devant des scènes d'opération apparemment
« communes et plates » (pp.
37-39 et pp.
304-305).
Et telle coïn cidence romanesque rejetée avec mépris : le cheval retrouvé (p.
43), est ensuite utilisée sans vergogne (p.
293).
La coïncidence la plus
préméditée se fait alors passer pour le déterminisme le plus natu rel : l'hôtesse a connu le capitaine, Jacques er son maître ont cour tisé la même fille ....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ART D’ARRIVER AU VRAI — Philosophie pratique Jaime Balmes (résumé & analyse)
- L’art dit-il vrai ?
- Le réalisme, s'il a traversé l'art de toutes les époques comme démarche s'attachant à reproduire la réalité, n'est devenu un véritable mouvement qu'au XIXe siècle.
- L'art doit-il être beau ou vrai ?
- Schopenhauer, extrait de l'Art d'avoir toujours raison. « La vanité innée, particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas accepter que notre affirmation se révèle fausse, ni que celle de l'adversaire soit juste. Par conséquent, chacun devrait simplement s'efforcer de n'exprimer que des jugements justes, ce qui devrait inciter à penser d'abord et à parler ensuite. Mais chez la plupart des hommes, la vanité innée s'accompagne d'un besoin de bavard