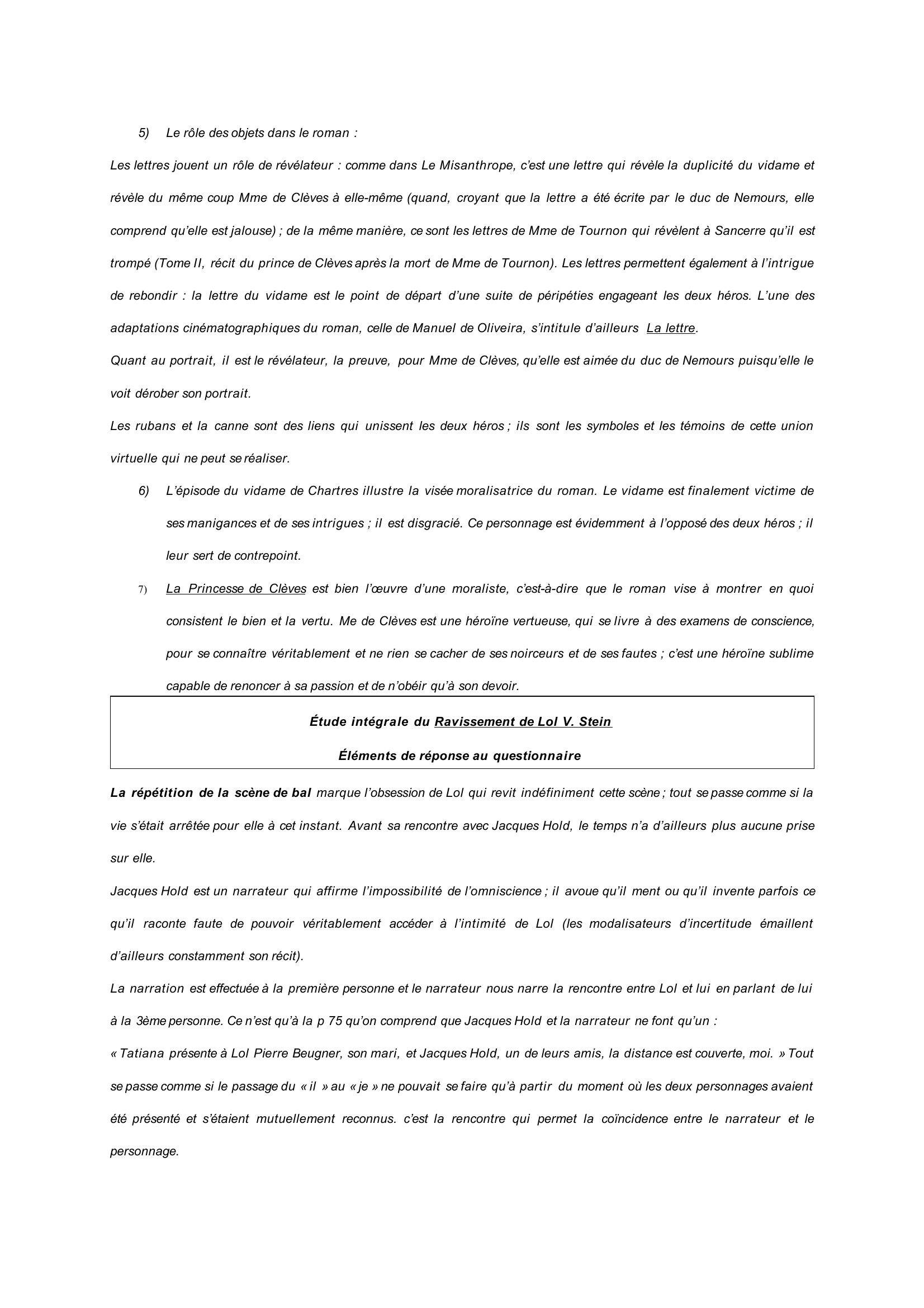l'amour du mensonge
Publié le 05/06/2013
Extrait du document


«
5) Le rôle des objets dans le roman :
Les lettres jouent un rôle de révélateur : comme dans Le M isanth rope, c’est une lett re qui révèle la dupl ic ité du vidame et
révèle du même coup Mme de Clèves à elle-même (quand, croyant que la lettre a été écrite par le duc de Nemours, elle
comprend qu’elle est jalouse) ; de la même manière, ce sont les lett res de Mme de Tournon qui révèlent à Sancerre qu’il est
trompé (Tome I I, récit du prince de Clèves après la mort de Mme de Tournon).
Les lett res permettent également à l’int r ig ue
de rebondi r : la lettre du vidame est le point de départ d’une suite de péripéties engageant les deux héros.
L’une des
adaptat ions cinématograph iques du roman, celle de Manuel de Oliveira, s’int i t u le d’ail leurs La lettre .
Quant au port ra i t , i l est le révélateur, la preuve, pour Mme de Clèves, qu’elle est aimée du duc de Nemours puisqu’elle le
voit dérober son port ra i t.
Les rubans et la canne sont des liens qui unissent les deux héros ; i ls sont les symboles et les témoins de cette union
vir t uel le qui ne peut se réaliser.
6) L’épisode du vidame de Chart res i l l ust re la visée moral isat r ice du roman.
Le vidame est fina lement vict ime de
ses manigances et de ses int r i gues ; i l est disgracié.
Ce personnage est évidemment à l’opposé des deux héros ; i l
leur sert de contrepoint.
7)
La Princesse de Clèves est bien l’œuvre d’une moral iste, c’est-à-dire que le roman vise à mont rer en quoi
consistent le bien et la vertu.
Me de Clèves est une héroïne vertueuse, qui se l iv re à des examens de conscience,
pour se connaît re véritablement et ne rien se cacher de ses noirceurs et de ses fautes ; c’est une héroïne sublime
capable de renoncer à sa passion et de n’obéir qu’à son devoir.
Étude intégr a le du Rav issement de Lol V.
Stein
Éléments de réponse au questionn a i r e
La répéti t ion de l a scène de bal marque l’obsession de Lol qui revit indéfin i ment cette scène ; tout se passe comme si la
vie s’était arrêtée pour elle à cet instant.
Avant sa rencont re avec Jacques Hold, le temps n’a d’ail leurs plus aucune prise
sur elle.
Jacques Hold est un narra teur qui aff i r me l’impossibi l i té de l’omniscience ; i l avoue qu’il ment ou qu’il invente parfois ce
qu’il raconte faute de pouvoir véritablement accéder à l’in t i m i té de Lol (les modalisateurs d’incerti t ude émail lent
d’ai l leurs constamment son récit).
La nar rat ion est effectuée à la première personne et le nar rateur nous nar re la rencontre entre Lol et lu i en par lan t de lu i
à la 3ème personne.
Ce n’est qu’à la p 75 qu’on comprend que Jacques Hold et la nar rateur ne font qu’un :
« Tat iana présente à Lol Pierre Beugner, son mar i, et Jacques Hold, un de leurs amis, la distance est couverte, moi.
» Tout
se passe comme si le passage du « il » au « je » ne pouvait se fai re qu’à part i r du moment où les deux personnages avaient
été présenté et s’étaient mutuellement reconnus.
c’est la rencontre qui permet la coïncidence entre le nar rateur et le
personnage..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir profond de l'homme. Car il s'agit bien du même monde. La souffrance est la même, le mensonge et l'amour. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin et il n'est même jamais de si bouleversants héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion. »
- L'Amour du Mensonge de Baudelaire (commentaire)
- En vous aidant de votre expérience personnelle et de vos lectures, expliquez et commentez cette formule de Camus : « Le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir profond de l'homme. Car il s'agit bien du même monde. La souffrance est la même et le mensonge et l'amour. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre. Mais eux du moins courent jusqu'au bout de leur destin. »
- l'amour et l'amitié dans une si longue lettre
- La morale et l'amour, un mariage impossible avec le roman le diable au corps de raymond radiguet