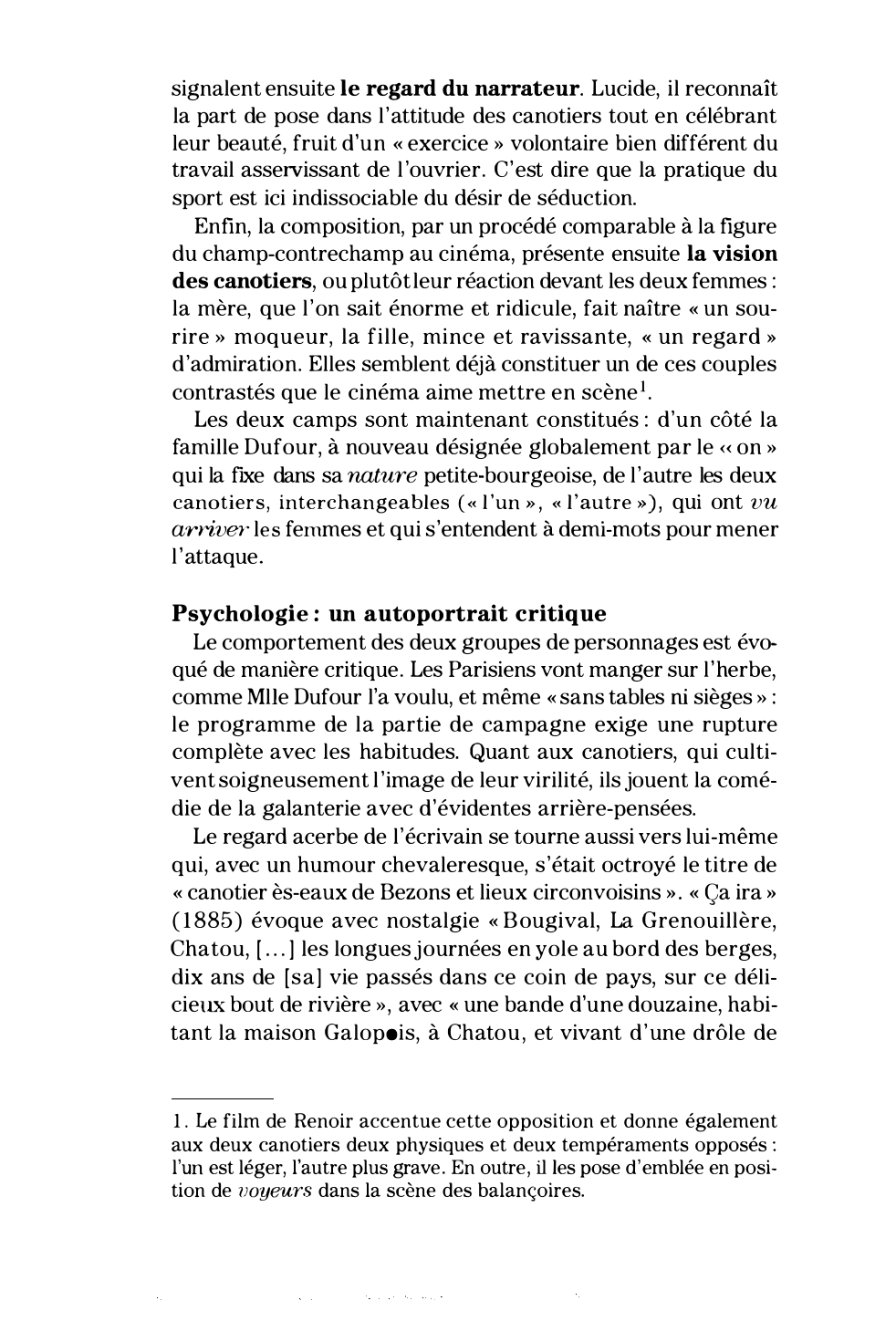La rencontre des canotiers: de << "C'est prêt" >> à << sans table ni sièges >> - Une partie de campagne de Maupassant
Publié le 14/09/2018
Extrait du document
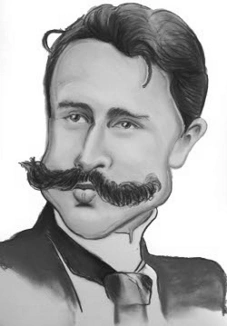
Narration : le jeu des regards
La famille Dufour ayant été longuement - mais inégalement - décrite dans la séquence initiale, le narrateur doit maintenant présenter les personnages nouveaux. Jusque dans la séquence suivante (C), ils vont rester anonymes, indistincts et n’exister que comme les représentants d’un type sociologique (le canotier de 1880) et comme les détenteurs d’un rôle (le séducteur). Pour le lecteur de Maupassant (et pour le lecteur d’aujourd’hui, qui a pu trouver dans la littérature l'expérience de cette époque révolue), leur comportement restera, jusqu'à l’épilogue (E), conforme à leur fonction.
Le texte donne d’abord la vision limitée des Dufour sur les propriétaires des yoles (c’est ce qu’indique le modalisateur << sans doute >>). Il s’agit plutôt de la vision de la mère, la première à s’avancer vers la place qu’elle voudrait occuper : elle s’intéresse au teint, à la (relative) nudité et à la musculature des deux hommes, c’est-à-dire à tout ce qui les distingue de son << bonhomme » de mari. Ces qualifications les rapprochent des ouvriers (<< des forgerons ») et les rendent, aux yeux d’une bourgeoise, inquiétants (l'ouvrier appartient à une classe inférieure, dangereuse) et désirables (l'ouvrier détient une puissance virile dont le bourgeois est dépourvu). Cette vision est à la fois objective (les caractéristiques physiques des canotiers sont bien exactes), subjective (le regard de Mme Dufour n'est pas neutre) et incomplète (on ne sait rien d’autre d’eux).
L'emploi du démonstratif (<< cette grâce ») et la formulation d’une observation plus générale (valeur du << on » et du présent)
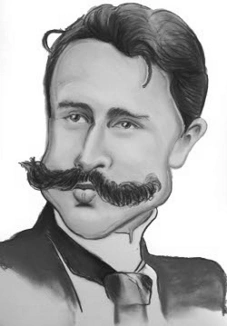
«
signalent
ensuite le regard du narrat eur.
Lucide, il reconnaît
la part de pose dans l'attitude des canotiers tout en célébrant
leur beau té, fruit d'un volontaire bien différent du
travail asservissant de l'ouvrie r.
C'e st dire que la pratique du
sport est ici indissociable du désir de séduction.
Enfin, la composition, par un procédé comparable à la figure
du champ-contrechamp au cinéma, présente ensuite la vision
des canotiers, ou plutôt leur réaction devant les deux femmes :
la mère, que l'on sait énorme et ridicule, fait naître > moqueur, la fille, mince et ravi ssante,
d' admirati on.
Elles semblent déjà constituer un de ces couples
contrastés que le cinéma aime mettre en scèn e1.
Les deux camps sont maintenant constitu és: d'un côté la
fa mille Dufour, à nouveau désignée globalement par le >
qui la fixe dans sa nature petite-bourgeoise, de l'autre les deux
canotiers, interchangeables (>) , qui ont vu
arriver les femmes et qui s'entendent à demi-mots pour mener
l'a ttaque .
Psychologie : un autop ortrait critique
Le comportement des deux groupes de personnages est évo
qué de manière critique.
Les Parisiens vont manger sur l'herbe,
comme Mlle Dufour l'a voulu, et même >:
le programme de la partie de campagne exige une rupture
comp lète avec les habitudes.
Quant aux canotiers, qui culti
vent soigneusement l'image de leur virilité, ils jouent la comé
die de la galanterie avec d'évidentes arrière-pensées.
Le regard acerbe de l'écrivain se tourne aussi vers lui-même
qui, avec un humour chevaleresque, s'était octroyé le titre de
>.
>
(1 885) évoque avec nostalgie , avec.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse comparée de la rencontre finale dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Les canotiers dans Une partie de Campagne (Maupassant et Renoir)
- Partie de campagne Maupassant
- commentaire partie de campagne de maupassant
- Une partie de campagne de Maupassant, extrait des lignes 18 – 48.