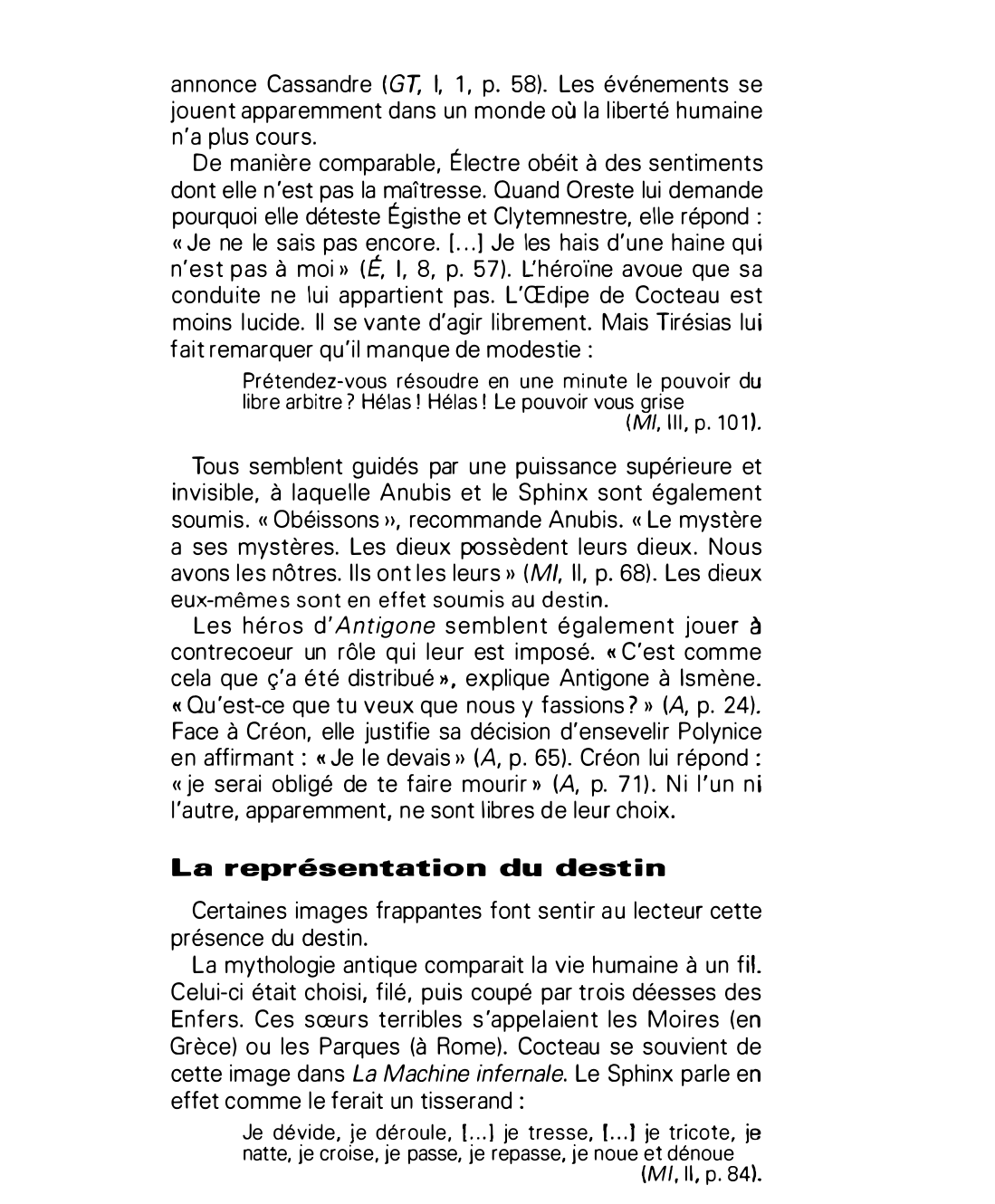La remise en cause du destin dans les mythes
Publié le 18/09/2018
Extrait du document
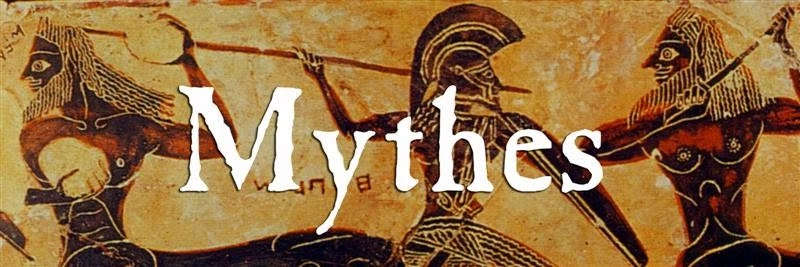
Dans Électre, la foi d'Égisthe laisse une très grande place à la liberté humaine. Pour lui, les dieux sont «inconscients au sommet de l'échelle de toutes les créatures» (É, 1, 3, p. 28). Il serait absurde de les imaginer «occupés sans relâche de cette moisissure suprême et mobile de la terre qu'est l'humanité» (ibid.). «Rien n'est plus opposé à la notion de destin, de fatalité, de tragique, que cette conception des dieux», commente Michel Raimond1. L'humanité, livrée à elle-même, n'est le jouet d'aucune force aveugle.
La vision de Sartre, dans Les Mouches, est proche de l'athéisme2. Certes, Jupiter est présent sur scène. Mais ce Jupiter est privé de pouvoir. « Quand une fois la liberté a explosé dans une âme d'homme», avoue-t-il en songeant à Oreste, « les Dieux ne peuvent plus rien contre cet homme-là » (LM, Il, Deuxième tableau, 5, p. 203). Dieu n'existe, en somme, que si l'on croit en lui. La liberté que peut s'accorder tout homme fait échec au destin.
Le destin : un terme trop vague
Dans l es cinq pièces, le terme de destin recouvre une réalité très vague. Le mot revient souvent dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Mais si Hector ne parvient pas à imposer la paix, la faute n'en revient nullement au destin. Elle tient à l'indolence de Pâris, à la sotte fascination des vieillards pour Hélène, au fanatisme du poète Demokos. C'est la somme des volontés humaines qui décide de la guerre. Celle-ci a d'ailleurs des causes très matérielles, qui n'ont rien à voir avec le destin. Ulysse l'explique très franchement à Hector : « l'or de vos temples, celui de vos blés et de votre colza, ont fait à chacun de nos navires, de vos promontoires, un signe qu'il n'oublie pas» (GT. Il, 13, p. 157).
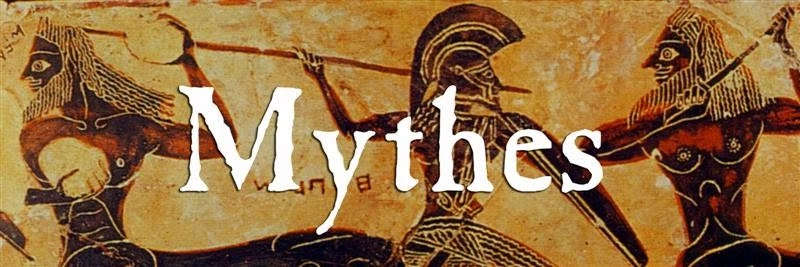
«
annonce
Cassandre (GT, 1, 1, p.
58).
Les événements se
jouent apparemment dans un monde où la liberté humaine
n'a plus cours.
De man ière compar able, Ëlectre obéit à des sentiments
dont elle n'est pas la maître sse.
Quand Oreste lui demande
pourquoi elle déteste Ëgisthe et Clytemn estre, elle répond :
«J e ne le sais pas encore.
[ ...
] Je les hais d'une haine qui
n'est pas à moi )) (�.
1, 8, p.
57).
L'héroïne avoue que sa
condu ite ne lui appar tient pas.
L'Œdipe de Coct eau est
moins lucide.
Il se vante d'agir librement.
Mais Tirésias lui
fait remarquer qu'il manque de modestie :
Prétendez-vous résoudre en une mi nute le pouvoir du
libre arbitre ? Hélas ! Hélas ! Le pouvoir vous grise
(M /, Ill, p.
101) .
To us semblent guidés par une puissance supérieure et
invisi ble, à laquelle Anubis et le Sph inx sont également
soumis.
«Obéissons )), reco mmande Anubis.
«Le mystère
a ses mystères.
Les dieux possèdent leurs dieux.
Nous
avons les nôtres.
Ils ont les leurs)) (M /, Il, p.
68) .
Les dieux
eu x-m êm es sont en effet sou mis au des tin.
Les héros d'An tigone semblent également jouer à
contrecoeur un rôle qui leur est imposé.
«C'est com me
cela que ç'a été distribué », explique Antigone à Ismène.
«Q u'e st-ce que tu veux que nous y fassions ?)) (A, p.
24).
Face à Créon, elle justifie sa décision d'ensevel ir Polynice
en affirmant : «J e le dev ais)) (A, p.
65).
Créon lui répond :
«j e serai obligé de te faire mourir>) (A, p.
71 ).
Ni l'un ni
l'au tre, apparemment, ne sont libres de leur choix.
La représenta tion du des tin
Certa ines images frappantes font sentir au lecteur cette
présence du des tin.
La mythologie antique comparait la vie humaine à un fil.
Celu i-ci était choisi, filé, puis coupé par trois déesses des
Enfers.
Ces sœurs terribles s'app elaient les Moires (en
Grèce) ou les Parques (à Rome).
Cocteau se souvient de
cette image dans La Machine infe rnale.
Le Sphinx parle en
effet comme le ferait un tisserand :
Je dévide, je déroule, [ ..
.
) je tresse, [ ..
.
) je tricote, je
natte, je croise, je passe, je repasse, je noue et dénoue
(M/, ll,p.
84)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La prétention de toute théorie scientifique à la vérité doit-elle s'accompagner d'un système défensif cherchant à contrer toute forme de remise en cause de cette vérité ?
- La remise en cause de l'état providence
- Peut on systématiquement dire d'une théorie qu'elle est toujours inachevée voire erronée et qu'un jour obligatoirement elle sera remise en cause ?
- Remise en cause de la tradition cartésienne par la psychanalyse freudienne ?
- L'obligation morale chez KANT et sa remise en cause ?