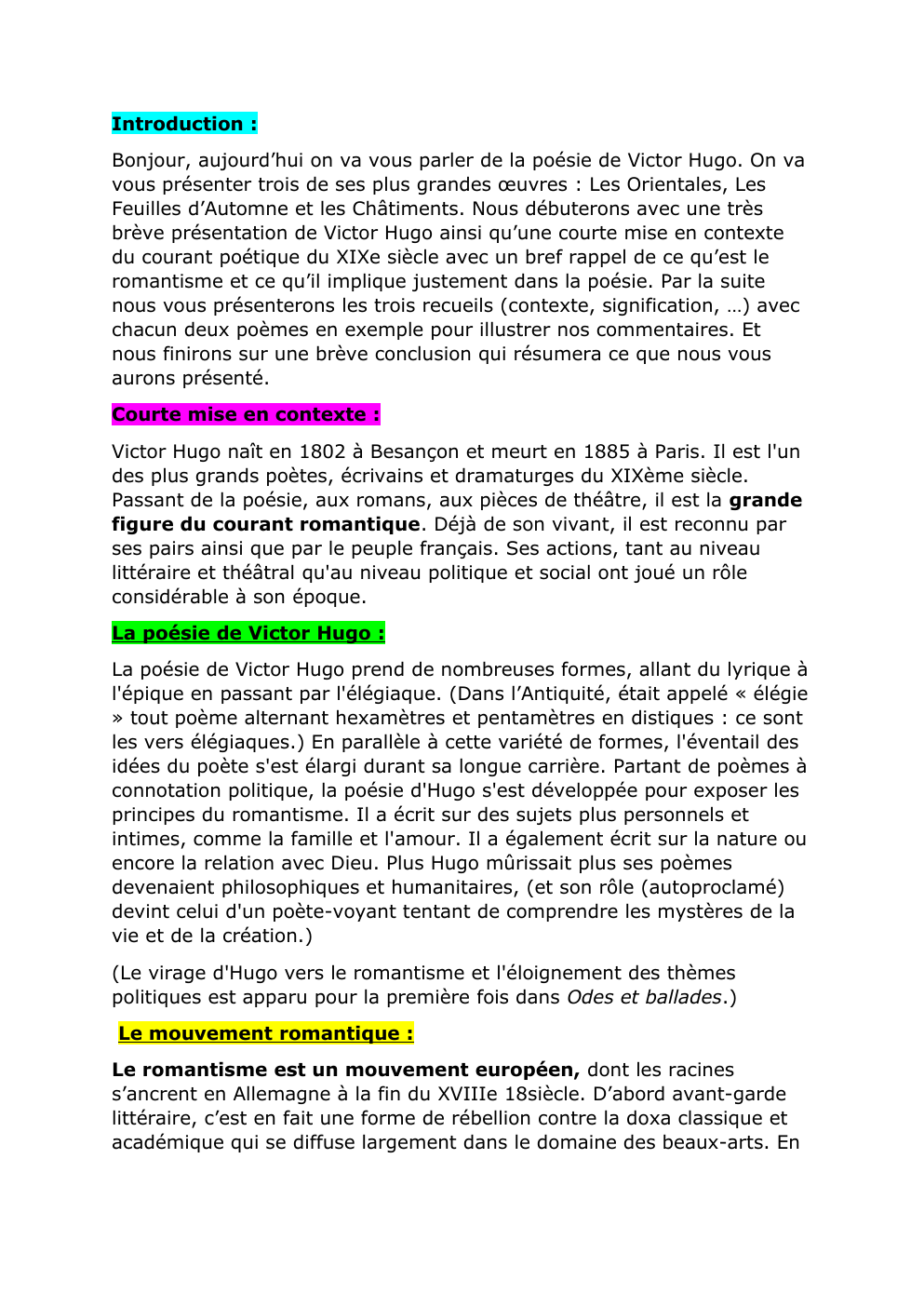la poésie de Victor Hugo
Publié le 24/01/2023
Extrait du document
«
Introduction :
Bonjour, aujourd’hui on va vous parler de la poésie de Victor Hugo.
On va
vous présenter trois de ses plus grandes œuvres : Les Orientales, Les
Feuilles d’Automne et les Châtiments.
Nous débuterons avec une très
brève présentation de Victor Hugo ainsi qu’une courte mise en contexte
du courant poétique du XIXe siècle avec un bref rappel de ce qu’est le
romantisme et ce qu’il implique justement dans la poésie.
Par la suite
nous vous présenterons les trois recueils (contexte, signification, …) avec
chacun deux poèmes en exemple pour illustrer nos commentaires.
Et
nous finirons sur une brève conclusion qui résumera ce que nous vous
aurons présenté.
Courte mise en contexte :
Victor Hugo naît en 1802 à Besançon et meurt en 1885 à Paris.
Il est l'un
des plus grands poètes, écrivains et dramaturges du XIXème siècle.
Passant de la poésie, aux romans, aux pièces de théâtre, il est la grande
figure du courant romantique.
Déjà de son vivant, il est reconnu par
ses pairs ainsi que par le peuple français.
Ses actions, tant au niveau
littéraire et théâtral qu'au niveau politique et social ont joué un rôle
considérable à son époque.
La poésie de Victor Hugo :
La poésie de Victor Hugo prend de nombreuses formes, allant du lyrique à
l'épique en passant par l'élégiaque.
(Dans l’Antiquité, était appelé « élégie
» tout poème alternant hexamètres et pentamètres en distiques : ce sont
les vers élégiaques.) En parallèle à cette variété de formes, l'éventail des
idées du poète s'est élargi durant sa longue carrière.
Partant de poèmes à
connotation politique, la poésie d'Hugo s'est développée pour exposer les
principes du romantisme.
Il a écrit sur des sujets plus personnels et
intimes, comme la famille et l'amour.
Il a également écrit sur la nature ou
encore la relation avec Dieu.
Plus Hugo mûrissait plus ses poèmes
devenaient philosophiques et humanitaires, (et son rôle (autoproclamé)
devint celui d'un poète-voyant tentant de comprendre les mystères de la
vie et de la création.)
(Le virage d'Hugo vers le romantisme et l'éloignement des thèmes
politiques est apparu pour la première fois dans Odes et ballades.)
Le mouvement romantique :
Le romantisme est un mouvement européen, dont les racines
s’ancrent en Allemagne à la fin du XVIIIe 18siècle.
D’abord avant-garde
littéraire, c’est en fait une forme de rébellion contre la doxa classique et
académique qui se diffuse largement dans le domaine des beaux-arts.
En
Europe, celui-ci encore largement conservateur, la tentation romantique
est celle de la liberté, du désir, de l’exaltation et de la spiritualité
Le romantisme se caractérise par la représentation de la subjectivité,
(l’Individualisme).
À travers les œuvres on peut ressentir les sentiments
des personnages, du narrateur, de l'auteur.
On remarque que la nature et
le divin sont des sujets privilégiés.
En poésie on peut noter que le romantisme est l'exaltation des sentiments
du poète accompagné d’une remise en question des thèmes usuels et peu
à peu d'une nécessité grandissante de remettre en question la
construction de la forme poétique.
(doxa = ensemble des opinions reçues sans discussion, comme évidentes, dans une civilisation
donnée.)
Les Orientales la représentation de l'Orient
Dans le recueil Les Orientales, Hugo va prouver que tout est possible
pour l'artiste.
Les Orientales est un recueil de poèmes écrit par Victor
Hugo en 1828 et publié en 1829.
Il regroupe 41 poèmes marqués par
l’attrait de la Grèce et l’Orient au XIX 19e siècle.
Dans son recueil de
poème, Hugo s’oppose aux règles de littérature ; il partage son opinion
sur la guerre d’indépendance grecque ; il décrit avec émotion l’Orient au
travers des thèmes de la violence et la guerre, de la nature ainsi que de
l’espoir.
Hugo semble en effet user de tous ses moyens de virtuose
comme dans les célèbres Djinns, poème conçu comme un crescendo et un
decrescendo ; l’Orient est ainsi prétexte aux jeux de l’imaginaire, à
l’inventivité verbale et à la diversité rythmique
Lorsque Les Orientales paraît en 1829, le romantisme français est
imprégné par l'orientalisme, sujet rendu très populaire suite à la guerre
d'indépendance grecque (1821-1829).
Victor Hugo suit donc le mouvement.
Pourtant, son recueil est très
remarqué, car il utilise des mots mystérieux, luxuriants.
Les images sont
très fortes, et la langue est très variée.
Victor Hugo comme de nombreux d’auteurs ont parlé de l’Orient sans
jamais y être allé.
Il rédige dans ces poésies une vision lumineuse et
magique d’un lieu retransmise à l’écrit.
On peut presque y voir une
description de certains tableaux orientalistes.
Hugo utilise l'imaginaire
oriental et le monde occulte.
Il utilise des créatures de la culture orientale
et aussi des mots relatifs à l’Orient, il parle ainsi des djinns.
L'exotisme
des poèmes a beaucoup plu.
Le poète créé un monde somptueux, qui semble être un fantasme.
Les
scènes que compte le poète sont sensuelles, ardentes.
Le désir est au
cœur de l'ouvrage.
Hugo raconte aussi le combat entre chrétiens et
musulmans.
Il soutient l'indépendance grecque et assure sa fascination
pour l'Orient.
Le recueil n'est pas focalisé uniquement sur l'Orient, ce n'est pas
simplement un fantasme occidental sur les pays étrangers.
Victor Hugo lie
celui-ci avec l'Occident.
Il met en avant les relations qui existent entre les
mondes.
Il parle évidemment des problèmes, mais aussi de la richesse
des échanges.
Thèmes
La violence et la guerre
La Grèce est en lutte contre l'Empire ottoman.
Une bataille est donc livrée
entre chrétiens et musulmans.
Pourtant, Victor Hugo ne présente pas les
deux religions comme deux cultures différentes.
Il parle d'une guerre
interne à l'Orient.
Pour lui, les deux religions peuvent apprendre à vivre
ensemble.
La nature
Dans ses poèmes, la nature est magnifiée.
Il en fait l'éloge.
Le recueil
révèle l'auteur comme étant un grand poète lyrique (il exprime ses
sentiments intimes au moyen de rythmes et d'images propres à
communiquer au lecteur ses émotions) et romantique, nourri par des
images merveilleuses, des visions épiques, des sentiments exaltés.
La
nature, l'amour, le droit au rêve, sont des thèmes que Hugo aime
particulièrement.
Lorsqu'il décrit la nature, il s'attarde longuement sur sa
beauté, sur son caractère extraordinaire.
Il l'associe, comme souvent, à la
femme, à l'image maternelle.
La nature est un refuge.
Elle promet l'espoir.
Elle s'oppose farouchement à la guerre.
Elle est un
havre de paix.
La nature est l'endroit où l'on peut le mieux voir Dieu.
En Orient, elle
regorge de plantes exotiques, d'animaux étranges.
L'espoir
La nature est donc porteuse de paix.
C'est le bien-être et la tranquillité
qu'elle apporte.
Victor Hugo met en avant la jeunesse, l'innocence.
Ce sont les symboles
de l'humanité, son avenir.
La vie continue, la nature continue.
La guerre
est terrible, les morts sont nombreux, mais l'humanité va vers le meilleur.
Malgré certains poèmes pessimistes, Victor Hugo assure finalement que la
vie et la joie vont triompher.
La douceur est symbolisée par les enfants, les femmes et les jeunes gens.
La renaissance est possible car ils existent.
Pour les orientales nous avons choisi deux poèmes qui sont les
Djinns et Clair de lune.
« Djinns » est un poème particulier de Victor Hugo.
Ce long poème a
pour thème les djinns donc, les fameux démons musulmans.
Ils ne sont
pas forcément toujours infernaux et destructeurs.
Cependant, ici c'est ce
caractère qui est choisi.
Hugo décrit une meute de Djinns à l'assaut d'une ville.
Leur puissance
destructrice, la peur qu'ils inspirent traversent tout le poème.
Ils sont
comparés à un groupe de sauterelle ravageant tout sans but, qui sonne
l'alarme d'une ville en proie à l'urgence devant le danger.
L'originalité du poème tient à plusieurs éléments.
Tout d'abord, il s'appuie
uniquement sur le bruit, sur l'ouïe pour décrire la meute féroce des
Djinns.
Leur attaque de nuit ne permet de les discerner qu'au vacarme
qui se rapproche.
Le fantastique, le mystère et l'épouvante gagnent le
lecteur à cette évocation juste sonore.
Ensuite, le poème se développe.
Le début voit l'approche avec un bruit
qui croît, la fin, le départ avec un bruit qui décroît.
Surtout, les strophes
comptent des vers avec de plus en plus de syllabes qui rythment
l'approche, jusqu'à la strophe du milieu, la huitième.
Puis, la taille des
vers baisse à la même vitesse que dans les sept premières strophes pour
les sept dernières.
Au fur et à mesure du rapprochement des Djinns, les
vers prennent une syllabe supplémentaire, jusqu'à en prendre deux entre
la septième et huitième strophe (passage d'un octosyllabe à un
décasyllabe).
En miroir, l'éloignement des Djinns se traduit par la perte
de deux syllabes entre la huitième et neuvième strophe, puis d'une
syllabe pour les vers de chaque strophe suivante.
L'augmentation régulière du nombre de syllabes dans les vers de la
première moitié du poème fait ressentir la montée du danger.
À l'inverse,
la baisse régulière observée dans la seconde partie exprime le
soulagement de plus en plus présent au fur et à mesure que les féroces
démons laissent la ville derrière eux.
Dans clair de lune, Hugo dénonce la barbarie des Turcs envers les Grecs,
qui alors luttaient pour leur indépendance.
Le poème Clair de lune
traduit donc un exotisme élaboré de toute pièce.
Certains éléments du
poème nous permettent de montrer cet exotisme et la présence de
l’orient.
Les mots “sultane”, ”djinn”, “sérail”, “eaux de Cos” nous
indiquent la situation de la scène.
Dans ce poème, une sultane regarde par sa fenêtre, intrigué par un bruit
venant de la mer.
Elle découvrira à la fin du poème que ce sont des Turcs
jetant à la mer des sacs remplis de femmes grecques vivantes.
Ces
femmes qui ont été réduites en esclavage ont perdu toute dignité
humaine en étant transportées comme des objets dans des sacs.
Le vers : “La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise,” a plusieurs sens
hormis le côté positif et rêveur du vers, le fait que l’auteur emploie les
mots “enfin libre” laisse penser à une longue captivité.
De plus la
répétition des mots “sourd”, “lourd” et l’utilisation des verbes “frappe” et
“battant” sous-entend les violences que les Turcs infligent aux Grecs.
Le
vers : “Et coupent l'eau, qui roule en perles sur leur aile” contient une
mise en garde pour ceux qui voudraient s'échapper car ils se feraient
décapiter aussitôt.
Le poète use de questions rhétoriques pour témoigner
de l’inquiétude, renforcée par le verbe “troubler” : “Qui trouble ainsi les
flots près du sérail des femmes ?”
En effet c’est à la dernière strophe que l’on comprend : “Ce sont des sacs
pesants, d'où partent des sanglots.” De plus le vers “Se mouvoir dans
leurs flancs comme une forme humaine…” montre que ces femmes ont
été transportées comme des objets dans des sacs.
C’est la découverte de
la cruauté d’un châtiment infligé aux Grecs par les Turcs (référence au
titre).
Hugo en mettant en évidence l’horreur de vrais faits historiques
lance un appel implicite en faveur de l’indépendance grecque.
Les feuilles d’automnes : (Le second recueil dont nous allons parler est
‘’les feuilles d’automne’’)
Écrits lorsque Victor Hugo avait 28 ans, les feuilles d'automne, composées
de 40 pièces sont une œuvre de transition publiée en 1831.
La voix
lyrique d'Hugo atteint sa maturité.
Bien que le style soit moins
spectaculaire que celui des Orientales, Hugo atteint un effet poétique
profond par une plus grande simplicité.
Thèmes :
Selon Hugo, ce sont des poèmes sereins et paisibles, des poèmes en
lien avec la famille (avec ses émotions), du foyer domestique, de la
vie privée ; des poèmes de l'intérieur de l'âme.
Le poème d'ouverture est un hommage à l'amour et au dévouement de la
mère du poète.
Ceci est suivi d'une chaleureuse reconnaissance de son
père, dans laquelle Hugo rappelle la maison du général à Blois et pleure la
mort de son père.
Ces panégyriques (éloges) à ses parents donnent le ton
à toute la collection.
Moins d'une poignée de poèmes traitent du thème de l'enfance, pourtant
Hugo fut le premier à introduire ce sujet dans la poésie française.
Le chef-
d'œuvre de la collection est l'un de ces poèmes, « Lorsque l'enfant parait
» dont on va parler plus tard.
Un autre développement, mais sur un plan différent, consacre le souci du
poète des correspondances entre l'homme et la nature, comme dans le
poème « Ce qu'on entend sur la montagne »
C'est donc une suite de poèmes dominés par la mélancolie.
Ce sont des
vers sereins de l'intérieur de l'âme, souvenirs de sa mère qui a protégé
son enfance chétive (évoqué dans le poème : ce siècle avait deux ans),
de son père, des âges de la vie (évoqué dans : où est le bonheur), des
déshérités (évoqué dans : ce qu'on entend sur la montagne).
Un
attendrissement face aux enfants de la part de Hugo (dans : lorsque
l'enfant parait).
Pour les feuilles d’automne, nous avons choisi d’aborder plus en détail
Soleils Couchants et Ce siècle avait deux ans.
Soleils Couchants
En somme, ce recueil est dominé par le thème de la fuite du temps
comme on le constate dans ce dernier poème.
Il est composé de 4
quatrains en alexandrins aux rimes suffisantes et croisées.
Le poème
Soleils Couchants présente une méditation sur la condition humaine face
à la nature et plus particulièrement au coucher de soleil d’où....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- BAUDELAIRE écrit dans son grand article sur Victor Hugo : Quand on se figure ce qu'était la poésie française avant qu'il apparût, et quel rajeunissement elle a subi depuis qu'il est venu, quand on imagine le peu qu'elle eût été s'il n'était pas venu, combien de sentiments mystérieux et profonds, qui ont été exprimés, seraient restés muets; combien d'intelligences il a accouchées, il est impossible de ne pas le considérer comme un de ces esprits rares et providentiels qui opèrent, dans
- « La poésie n'est pas un ornement, elle est un instrument », Victor Hugo
- Dissertation : commentez la sitation suivante : "à voir les choses d'un peu haut il n'y a en poésie ni bon ni mauvais sujets mais de bons et de mauvais poètes" Victor Hugo, préface des "Orientales".
- Imaginer un dialogue entre Victor Hugo et Francis Ponge, chacun défendant avec enthousiasme sa conception de la poésie
- Théâtre et poésie : le lyrisme dans Hernani de Victor HUGO