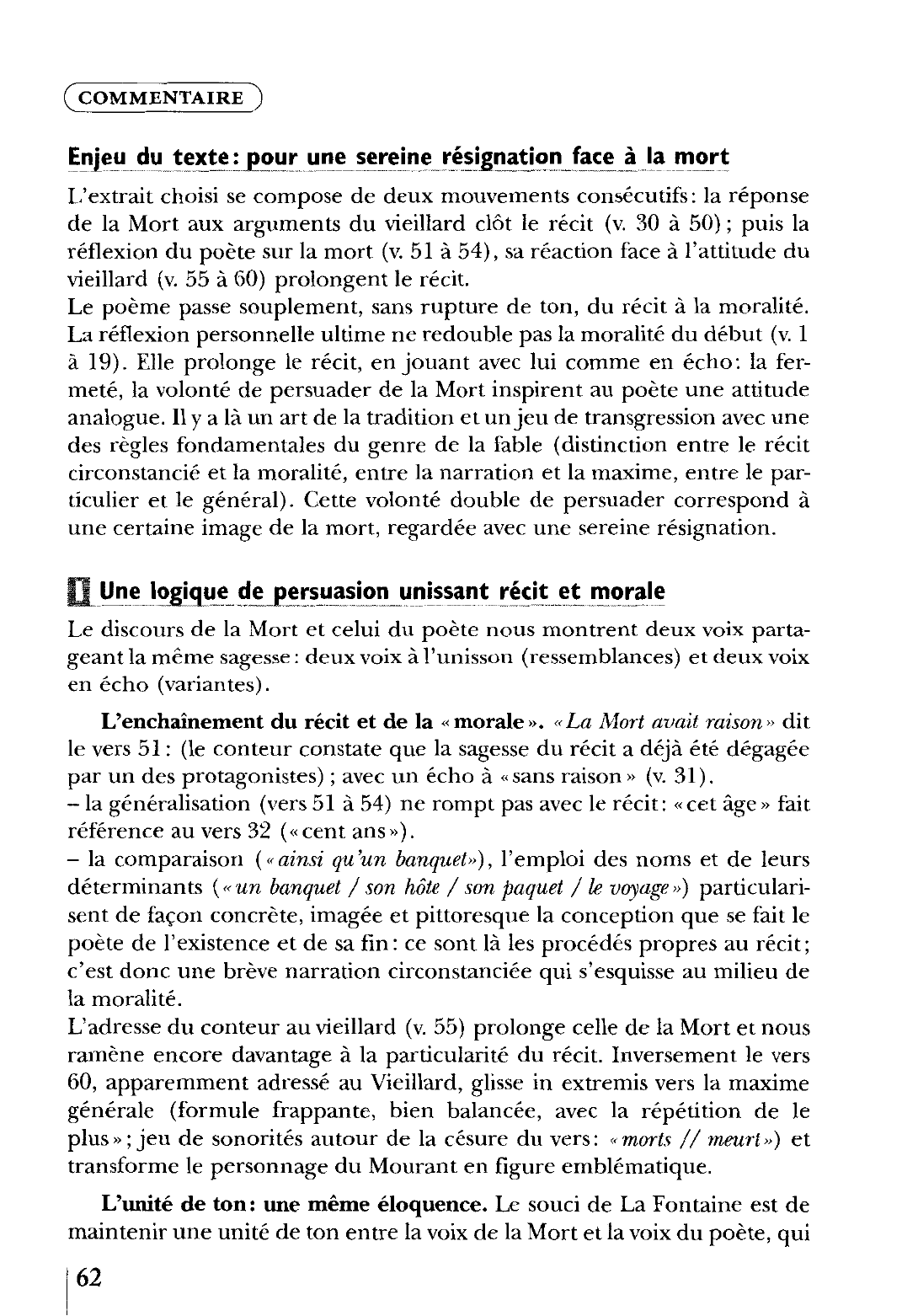La Mort et le Mourant Livre VIII, fable I, vers 30 à 60
Publié le 27/03/2015
Extrait du document

Reprenant un thème traité dans le premier recueil des Fables, La Fontaine élabore ici un poème beaucoup plus virtuose dans son agencement. Il commence par une <‹ moralité« (v. 1 à 19) développant un lieu commun de la réflexion morale : la sagesse consiste à avoir une attitude résolue, stoïque, face à la mort.
Puis il fait entendre la singularité de sa voix (v. 18), une voix qui tempère la maxime du vers 1 ( « La Mort ne surprend point le sage «) en insinuant que les sages ne courent pas les rues. Le récit (v. 20 à 50), vient illustrer ce motif : voici la Mort confrontée à un vieillard qui refuse de la suivre et argumente en faveur de sa survie.
30 — Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris.
Tu te plains sans raison de mon impatience.
Eh n'as-tu pas cent ans? trouve-moi dans Paris
Deux mortels aussi vieux, trouve-m'en dix en France.
Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis
35 Qui te disposât à la chose:
J'aurais trouvé ton testament tout fait, Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait; Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause Du marcher et du mouvement,
40 Quand les esprits, le sentiment,
Quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'ouïe:
Toute chose pour toi semble être évanouie:
Pour toi l'astre du jour prend des soins superflus:
Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus.
45 Je t'ai fait voir tes camarades,
Ou morts, ou mourants, ou malades.
Qu'est-ce que tout cela, qu'un avertissement?
Allons, vieillard, et sans réplique;
Il n'importe à la république
50 Que tu fasses ton testament.
La Mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge On sortît de la vie ainsi que d'un banquet, Remerciant son hôte, et qu'on fit son paquet; Car de combien peut-on retarder le voyage?
55 Tu murmures, vieillard; vois ces jeunes mourir,
Vois-les marcher, vois-les courir
A des morts, il est vrai, glorieuses et belles,
Mais sûres cependant, et quelquefois cruelles.
J'ai beau te le crier; mon zèle est indiscret:
60 Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.

«
(COMMENTAIRE )
Eni~IJ- du texte: ~~IJI' llne sereine ré~ig11~tion face à la mort
L'extrait choisi se compose de deux mouvements consécutifs: la réponse
de la Mort aux arguments du vieillard clôt le récit (v.
30 à 50); puis la
réflexion du poète sur la mort (v.
51 à 54), sa réaction face à l'attitude du
vieillard (v.
55 à 60) prolongent le récit.
Le poème passe souplement, sans rupture de ton, du récit à la moralité.
La réflexion personnelle ultime ne redouble pas la moralité du début (v.
1
à
19).
Elle prolonge le récit, en jouant avec lui comme en écho: la fer
meté, la volonté de persuader de la Mort inspirent au poète une attitude
analogue.
Il y a là un art de la tradition et un jeu de transgression avec une
des règles fondamentales du genre de la fable (distinction entre le récit
circonstancié et la moralité, entre la narration et la maxime, entre le par
ticulier et le général).
Cette volonté double de persuader correspond à
une certaine image de la mort, regardée avec une sereine résignation.
Une l~giqtJ_e_ .c:f!_P!f'S_ll~sion unissant récit et morale
Le discours de la Mort et celui du poète nous montrent deux voix parta
geant la même sagesse: deux voix à l'unisson (ressemblances) et deux voix
en écho (variantes).
L'enchaînement du récit et de la «morale».
«La Mort avait raison» dit
le vers 51: (le conteur constate que la sagesse du récit a déjà été dégagée
par un des protagonistes) ; avec un écho à «sans raison » ( v.
31).
- la
généralisation (vers 51à54) ne rompt pas avec le récit: «cet âge» fait
référence au vers 32 («cent ans»).
-la comparaison («ainsi qu'un banquet»), l'emploi des noms et de leurs
déterminants («un banquet I son hôte I son paquet I le voyage») particulari
sent de façon concrète, imagée et pittoresque la conception que se fait le
poète de l'existence et de sa fin: ce sont là les procédés propres au récit;
c'est donc une brève narration circonstanciée qui s'esquisse au milieu de
la moralité.
L'adresse du conteur au vieillard (v.
55) prolonge celle de la Mort et nous
ramène encore davantage à la particularité du récit.
Inversement le vers
60, apparemment adressé au Vieillard, glisse in extremis vers la maxime
générale (formule frappante, bien balancée, avec la répétition de le
plus»; jeu de sonorités autour de la césure du vers: «morts 11 meurt») et
transforme le personnage du Mourant en figure emblématique.
L'unité de ton: une même éloquence.
Le souci de La Fontaine est de
maintenir une unité de ton entre la voix de la Mort et la voix du poète, qui
62.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Résumé Fable L.F. Livre VIII, fables 10 à 27
- LIVRE DES PLAISANTERIES DE LA MORT
- Du Contrat social, livre I, chapitre VIII
- La République, Platon, Livre VIII
- Henri VIII Henri VIII succéda à son père, Henri VII, à la mort de son frère Arthur dont il épousa la veuve, Catherine d'Aragon, dans le respect de la volonté paternelle.