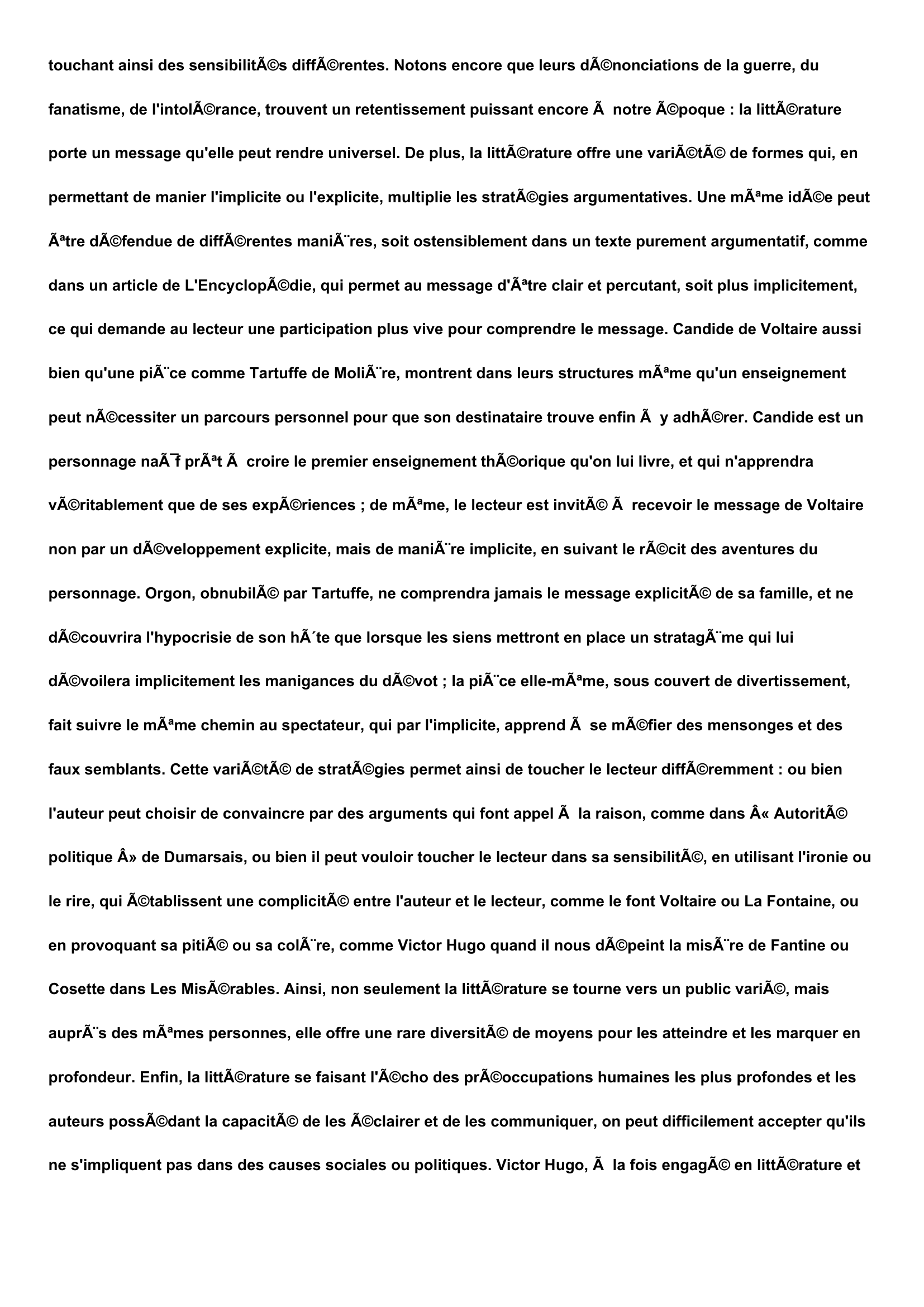La littérature présente le paradoxe inhérent au fait qu’elle soit à la fois art et langage, de s’inscrire dans une dimension universelle mais aussi actuelle.
Publié le 25/10/2021
Extrait du document


«
touchant ainsi des sensibilités différentes.
Notons encore que leurs dénonciations de la guerre, du
fanatisme, de l'intolérance, trouvent un retentissement puissant encore à notre époque : la littérature
porte un message qu'elle peut rendre universel.
De plus, la littérature offre une variété de formes qui, en
permettant de manier l'implicite ou l'explicite, multiplie les stratégies argumentatives.
Une même idée peut
être défendue de différentes manières, soit ostensiblement dans un texte purement argumentatif, comme
dans un article de L'Encyclopédie, qui permet au message d'être clair et percutant, soit plus implicitement,
ce qui demande au lecteur une participation plus vive pour comprendre le message.
Candide de Voltaire aussi
bien qu'une pièce comme Tartuffe de Molière, montrent dans leurs structures même qu'un enseignement
peut nécessiter un parcours personnel pour que son destinataire trouve enfin à y adhérer.
Candide est un
personnage naïf prêt à croire le premier enseignement théorique qu'on lui livre, et qui n'apprendra
véritablement que de ses expériences ; de même, le lecteur est invité à recevoir le message de Voltaire
non par un développement explicite, mais de manière implicite, en suivant le récit des aventures du
personnage.
Orgon, obnubilé par Tartuffe, ne comprendra jamais le message explicité de sa famille, et ne
découvrira l'hypocrisie de son hôte que lorsque les siens mettront en place un stratagème qui lui
dévoilera implicitement les manigances du dévot ; la pièce elle-même, sous couvert de divertissement,
fait suivre le même chemin au spectateur, qui par l'implicite, apprend à se méfier des mensonges et des
faux semblants.
Cette variété de stratégies permet ainsi de toucher le lecteur différemment : ou bien
l'auteur peut choisir de convaincre par des arguments qui font appel à la raison, comme dans « Autorité
politique » de Dumarsais, ou bien il peut vouloir toucher le lecteur dans sa sensibilité, en utilisant l'ironie ou
le rire, qui établissent une complicité entre l'auteur et le lecteur, comme le font Voltaire ou La Fontaine, ou
en provoquant sa pitié ou sa colère, comme Victor Hugo quand il nous dépeint la misère de Fantine ou
Cosette dans Les Misérables.
Ainsi, non seulement la littérature se tourne vers un public varié, mais
auprès des mêmes personnes, elle offre une rare diversité de moyens pour les atteindre et les marquer en
profondeur.
Enfin, la littérature se faisant l'écho des préoccupations humaines les plus profondes et les
auteurs possédant la capacité de les éclairer et de les communiquer, on peut difficilement accepter qu'ils
ne s'impliquent pas dans des causes sociales ou politiques.
Victor Hugo, à la fois engagé en littérature et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Gabriel Rey écrit dans Humanisme et surhumanisme (1951): «Dire que la littérature classique est le fait d'une élite pour une élite est sans doute plus exact historiquement qu'en soi. Rien n'empêche de concevoir un classicisme de masse ; c'est une simple question d'éducation et de pensée régnante, de mode enfin. [...] Prétendre que le «peuple» - entité d'ailleurs plus mythique que réelle - est voué à jamais à sa vie intellectuelle et artistique actuelle, à la pensée (si l'on peut dire)
- Que pensez-vous de cette idée de J. Bayet : «Le classicisme est un équilibre, de pensée, de sensibilité et de forme, qui assure à l'œuvre d'art un intérêt humain et une diffusion universelle. L'ordre, la clarté, la plénitude, la maîtrise consciente en sont les signes apparents. Mais on ne saurait parler d'«époque classique»; en un temps donné, une littérature offre, à côté des «classiques», des retardataires et des novateurs. Il n'y a que des «auteurs classiques», ou même parfois seule
- L'historien des idées Roger Paultre voit ainsi le passage de l'écriture préclassique à celle qui suit 1650 : «L'art de la rhétorique ; sa pratique et sa typologie aux subdivisions sans cesse augmentées, débordent largement la période qui nous occupe, et la culture antérieure à 1650 lui assigne une place qui va bien au-delà d'une simple technique littéraire : c'est parce que le monde est formé d'un réseau de ressemblances qu'il est possible de substituer à un mot un autre mot qui, par a
- Que pensez-vous de cette présentation de l'influence actuelle du surréalisme : «Ces poètes (surréalistes) trouvent aujourd'hui de nombreux exé-gètes, sensibles à la beauté du spectacle que déploie le langage et explorant avec patience le jeu des relations, des tropes, qui constitue le texte et en assure la communication. Paradoxalement, l'intérêt que suscite le surréalisme est ainsi littéraire avant tout. Ce qui est acquis, c'est que le texte surréaliste ne peut être abordé selon les c
- Étudiez ce bilan du surréalisme proposé par Gaétan Picon (Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1960) : «Qu'avons-nous conservé, qu'avons-nous rejeté du Surréalisme ? Dans une large mesure, il est encore et toujours notre poésie : la poésie moderne tout entière prenant conscience d'elle-même, et allant jusqu'au bout. Toute poésie, à l'heure actuelle, veut être autre chose que poème, fabrication rythmique, jeu inoffensif d'images et de mots : confusion ardente avec l