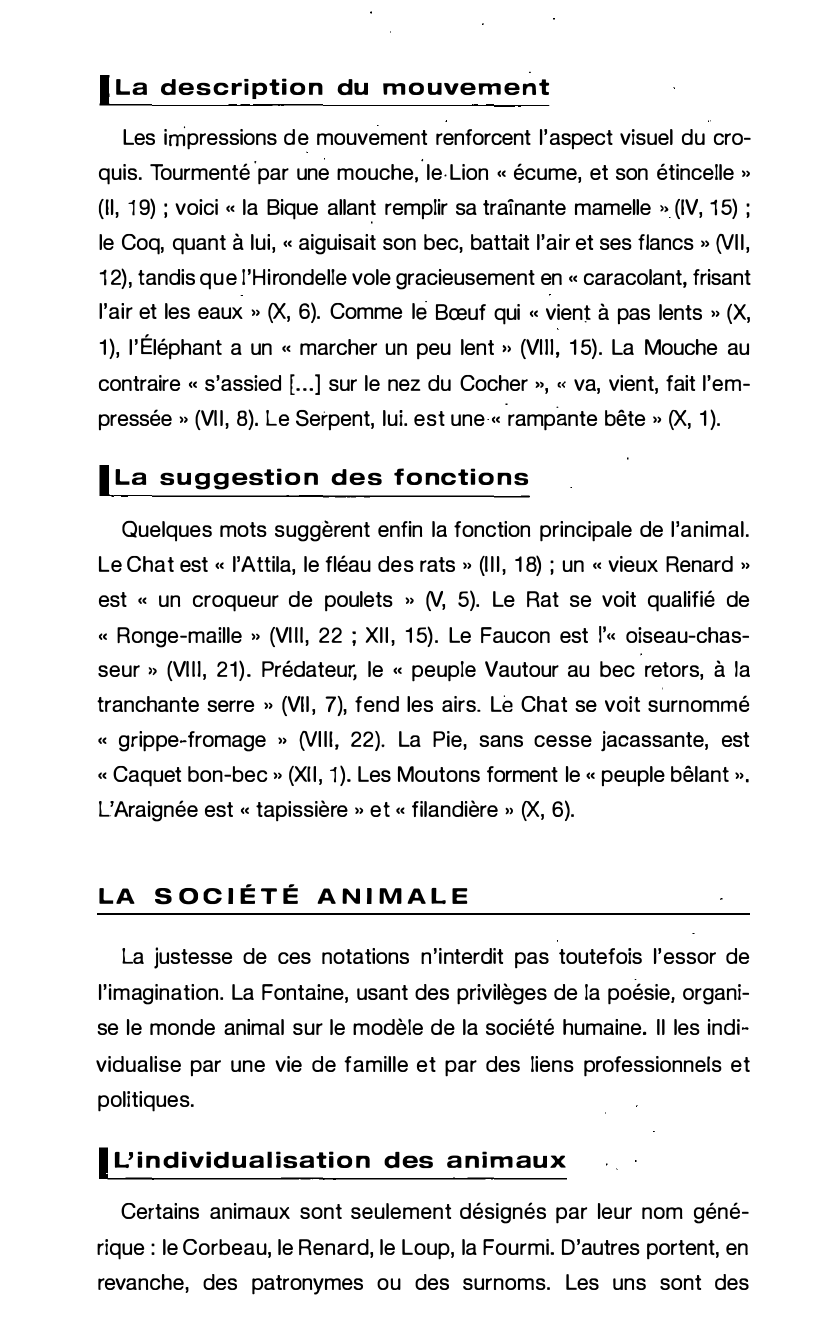La Fontaine, peintre des animaux
Publié le 12/09/2019
Extrait du document
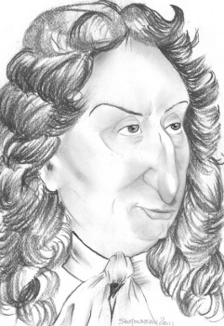
Le privilège du langage
Ainsi que le note La Fontaine dans l'Epilogue du Livre Xl,
[...] tout parle dans l'Univers ;
Il n'est rien qui n'ait son langage.
Preuve absolue de leur humanisation, les animaux accèdent au langage articulé, selon les règles de la plus parfaite grammaire, privilège jusque-là réservé au monde des humains.
Appliquées à des bêtes ou prononcées par celles-ci, certaines formules prennent dès lors une saveur amusante. La fabuliste joue à plaisir sur les différents sens des mots. Le Geai, qui s'est affublé des plumes d'un Paon, \" se panada » (IV, 9) On dirait aujourd'hui \" se pavaner \"• Le verbe \" se panader » rappelle le mot « paon >>• Le \" caquet » désigne par exemple le cri de la poule qui va pondre et, par extension, ün babil (bavardage)' importun et indiscret. Appliqué à un Coq qui fait le \" coquet » parmi les Poules, le mot crée l'humour1. \"Le Serpent, en sa langue, s'exprime du mieux qu'il peut» (X, 1); et l'ours réplique « à sa manière » (Xli, 1).
Il arrive même que les animaux maîtrisent l'écriture, à l'exemple de \" sa Majesté la Lionne » qui convoque ses \" vassaux » en
Envoyant de tous les côtés
Une circulaire écriture2,
' Avec son sceau.
■ (La Cour du Lion, VII, 6).
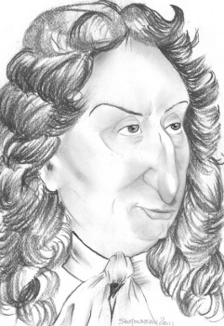
«
La desc ription du mouvement
Les im pressions de mouvement renforcent l'aspect visuel du cro
quis.
Tourmenté .par une mouche.
' le- Lion " écume, et son étincelle "
(Il, 1 9) ; voici " la Bique allant remplir sa traînante mamelle " (IV, 15) ;
le Coq, quant à lui, "aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs "{VI l,
12 ), tandis que l'Hirondelle vole gracieusement en" caracolant, frisant
l'air et les eaux " (X, 6).
Comme le Bœuf qui " vient à pas lents " {X,
1) , l'É léphant a un " marcher un peu lent •• (VI II, 15).
La Mouche au
contraire " s'a ssied [ ...
] sur le nez du Cocher "• " va, vient, fait l'em
pressée " (VI l, 8).
Le Serpent, lui.
est une " ramp ante bête" (X, 1).
La suggestion des fonction s
Quelques mots suggèr ent enfin la fonction principale de l'animal.
Le Chat est " l'Attila, le fléau des rats " {Ill, 18) ; un " vieux Renard "
est " un croqueur de poulets " (V, 5).
Le Rat se voit qualifié de
" Ronge-maille " (VI II, 22 ; Xl i, 15 ).
Le Faucon est l'« oiseau-chas
seur » (VI II, 21).
Prédateur, le " peuple Vautour au bec retors, à la
tranchante serre " (VI l, 7), fend les airs.
Le Chat se voit surnommé
" grip pe-fromage " {VI II, 22).
La Pie, sans cesse jacassante, est
" Caque t bon-bec " {Xl i, 1) .
Les Moutons forment le " peuple bêlant "·
L'Ar aignée est " tapissièr e " et " filandi ère " (X, 6).
LA SOC IÉTÉ ANI MALE
La justesse de ces notations n'interdit pas toutefois l'essor de
l'ima gination.
La Fontaine, usant des privilèges de la poésie, organi
se le monde animal sur le modèle de la société humaine.
Il les indi
vidualise par une vie de famille et par des liens professionnels et
politiques.
L'in dividua lisation des anim aux
Certains animaux sont seulement désignés par leur nom géné
rique : le Corbeau, le Renard, le Loup, la Fourmi.
D'autres portent, en
rev anche, des patronymes ou des surnoms.
Les uns sont des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- la fontaine les animaux malades de la peste
- CHARDIN, Jean-Baptiste Siméon (2 novembre 1699-6 décembre 1779) Peintre Deux de ses tableaux, La Raie et Le Dressoir, valent à Chardin d'être admis à l'Académie royale de peinture et de sculpture, le 25 septembre 1728, en tant que " peintre dans le talent des animaux et des fruits ".
- La Fontaine définit ses Fables comme « Une ample comédie à cent actes divers / Et dont la scène est l'univers / Hommes, dieux, animaux tout y fait quelque rôle.» Dans quelle mesure les fables que vous avez étudiées, justifient-elles cette affirmation du poète ?
- « Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés ; par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l'abrégé de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables », écrit La Fontaine dans sa Préface au premier recueil de ses Fables (1668). Trouve-t-on encore dans les Livres VII à XII de quoi justifier cette affirmation du fabuliste ?
- ?La Fontaine, « Les Animaux malades de la Peste », Fables, Livre