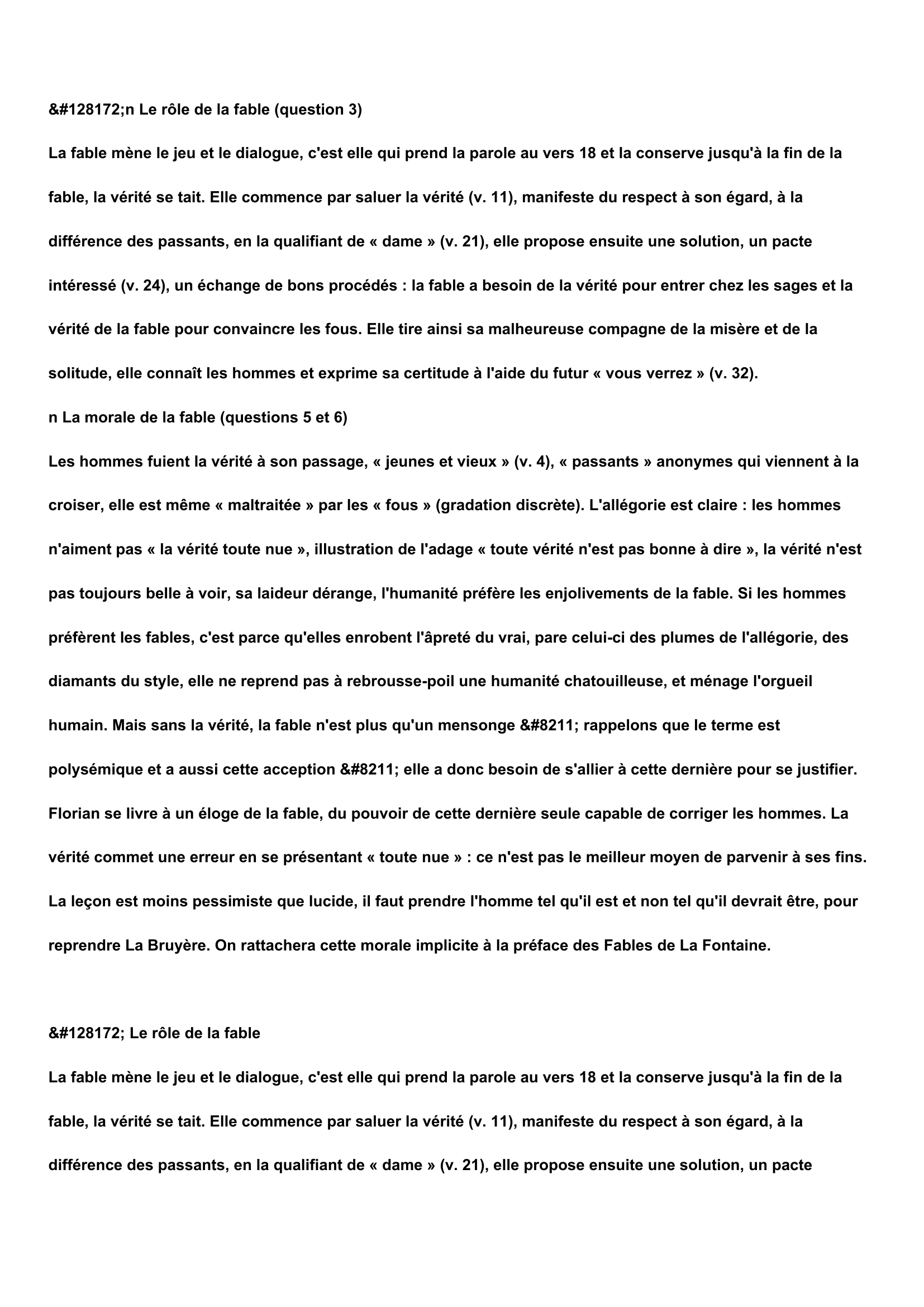La fable et le conte ne sont que des représentations plaisantes de la réalité qui ne peuvent prétendre délivrer un message sérieux. Partagez-vous ce jugement ?
Publié le 09/06/2013
Extrait du document

Français dissertation Marylou 💬La fable et le conte ne sont que des représentations plaisantes de la réalité qui ne peuvent prétendre délivrer un message serieux.Partagez-vous ce jugement? La fable est un court récit ayant une portée moralistique,le conte lui est le genre littéraire le plus proche de l’ homme,il tend à initier le lecteur à la sagesse avec humour et dérision.Prochainement nous verrons si la fable et le conte ne servent qu’a amuser le lecteur ou bien si ils on un double enjeux qui n’est pas seulement de distraire mais également de faire passer un message serieux,dénoncer des erreurs. Ces genres littéraires peuvent sembler puérils pour les lecteurs en raison des personnages crées qui appartiennent la plupart du temps au registre merveilleux.Les oeuvres qui emploient l'argumentation indirecte donnent souvent l'impression d'appartenir à un genre peu sérieux car leurs récit fait appel à l’imagination.Pourquoi prendre au sérieux des oeuvres qui empruntent matière à la fiction et non à la réalité? Comment ne pas esquisser un léger sourire lorsque dans un conte comme “Jacques et le aricot magique” les personnages et objets présents sont des graines magiques se transformant en un aricot géant qui mènent Jacques dans un univers magique où sont présents un ogre et une poule aux oeufs d’or,le contenu est totalement imaginaire et impropre à la réalité tout comme dans le conte “hansel et Gretel “Où deux enfants sont abandonés dans la forêt et trouvent refuge dans une maison en pin d’épice où ils sont engraissés pour être mangés par une vieille femme.Evidemment ceci est fait pour divertir les lecteurs et ne se passerait pas réelement.De plus dans les oeuvres de fiction la réalité est transfigurée il peut s’agir d’animaux qui parlent comme dans “le corbeau et le renard écrit par le poète francais Jean de La Fontaine (1621-1695).Dans cette fable le renard,rusé soutire le fromage du corbeau en le flattant ,il adopte une attitude humaine doté de qualité et de... 💬n Le rôle de la fable (question 3) La fable mène le jeu et le dialogue, c’est elle qui prend la parole au vers 18 et la conserve jusqu’à la fin de la fable, la vérité se tait. Elle commence par saluer la vérité (v. 11), manifeste du respect à son égard, à la différence des passants, en la qualifiant de « dame « (v. 21), elle propose ensuite une solution, un pacte intéressé (v. 24), un échange de bons procédés : la fable a besoin de la vérité pour entrer chez les sages et la vérité de la fable pour convaincre les fous. Elle tire ainsi sa malheureuse compagne de la misère et de la solitude, elle connaît les hommes et exprime sa certitude à l’aide du futur « vous verrez « (v. 32). n La morale de la fable (questions 5 et 6) Les hommes fuient la vérité à son passage, « jeunes et vieux « (v. 4), « passants « anonymes qui viennent à la croiser, elle est même « maltraitée « par les « fous ...

«
💬n Le rôle de la fable (question 3)
La fable mène le jeu et le dialogue, c'est elle qui prend la parole au vers 18 et la conserve jusqu'à la fin de la
fable, la vérité se tait.
Elle commence par saluer la vérité (v.
11), manifeste du respect à son égard, à la
différence des passants, en la qualifiant de « dame » (v.
21), elle propose ensuite une solution, un pacte
intéressé (v.
24), un échange de bons procédés : la fable a besoin de la vérité pour entrer chez les sages et la
vérité de la fable pour convaincre les fous.
Elle tire ainsi sa malheureuse compagne de la misère et de la
solitude, elle connaît les hommes et exprime sa certitude à l'aide du futur « vous verrez » (v.
32).
n La morale de la fable (questions 5 et 6)
Les hommes fuient la vérité à son passage, « jeunes et vieux » (v.
4), « passants » anonymes qui viennent à la
croiser, elle est même « maltraitée » par les « fous » (gradation discrète).
L'allégorie est claire : les hommes
n'aiment pas « la vérité toute nue », illustration de l'adage « toute vérité n'est pas bonne à dire », la vérité n'est
pas toujours belle à voir, sa laideur dérange, l'humanité préfère les enjolivements de la fable.
Si les hommes
préfèrent les fables, c'est parce qu'elles enrobent l'âpreté du vrai, pare celui-ci des plumes de l'allégorie, des
diamants du style, elle ne reprend pas à rebrousse-poil une humanité chatouilleuse, et ménage l'orgueil
humain.
Mais sans la vérité, la fable n'est plus qu'un mensonge – rappelons que le terme est
polysémique et a aussi cette acception – elle a donc besoin de s'allier à cette dernière pour se justifier.
Florian se livre à un éloge de la fable, du pouvoir de cette dernière seule capable de corriger les hommes.
La
vérité commet une erreur en se présentant « toute nue » : ce n'est pas le meilleur moyen de parvenir à ses fins.
La leçon est moins pessimiste que lucide, il faut prendre l'homme tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, pour
reprendre La Bruyère.
On rattachera cette morale implicite à la préface des Fables de La Fontaine.
💬 Le rôle de la fable
La fable mène le jeu et le dialogue, c'est elle qui prend la parole au vers 18 et la conserve jusqu'à la fin de la
fable, la vérité se tait.
Elle commence par saluer la vérité (v.
11), manifeste du respect à son égard, à la
différence des passants, en la qualifiant de « dame » (v.
21), elle propose ensuite une solution, un pacte.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La fable pour La Fontaine n'a été le plus souvent qu'un prétexte au récit, au conte, à la rêverie; la moralité s'y ajuste à la fin comme elle peut,», écrit le critique Sainte-Beuve (Lundis, VII). A la lumière des fables que vous avez étudiées, vous direz si vous partagez ce jugement. ?
- Comment La Fontaine et d’autres écrivains du XVIIème siècle font-ils passer un message à travers un conte, une fable, une histoire ou même une fiction et dans quel but ?
- La Fontaine a évoqué son apport personnel dans le domaine de la fable en décla¬rant qu'il y avait introduit la gaieté. Il précise ainsi cette notion : « Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire ; mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux » (Préface du pre¬mier recueil, 1668). Votre lecture des Fables (livres VII à XII) vous permet-elle de souscrire à ce jugement ?
- « La faculté de désirer est la faculté d'être, par ses représenta¬tions, cause de la réalité des objets de ces représentations. » (KANT, Critique du Jugement.). Commentez cette citation.
- La Fontaine a évoqué son apport personnel dans le domaine de la fable en déclarant qu'il y avait introduit la gaieté. Il précise ainsi cette notion : « Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire ; mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux » (Préface du premier recueil, 1668). Votre lecture des Fables (livres VII à XII) vous permet-elle de souscrire à ce jugement ?