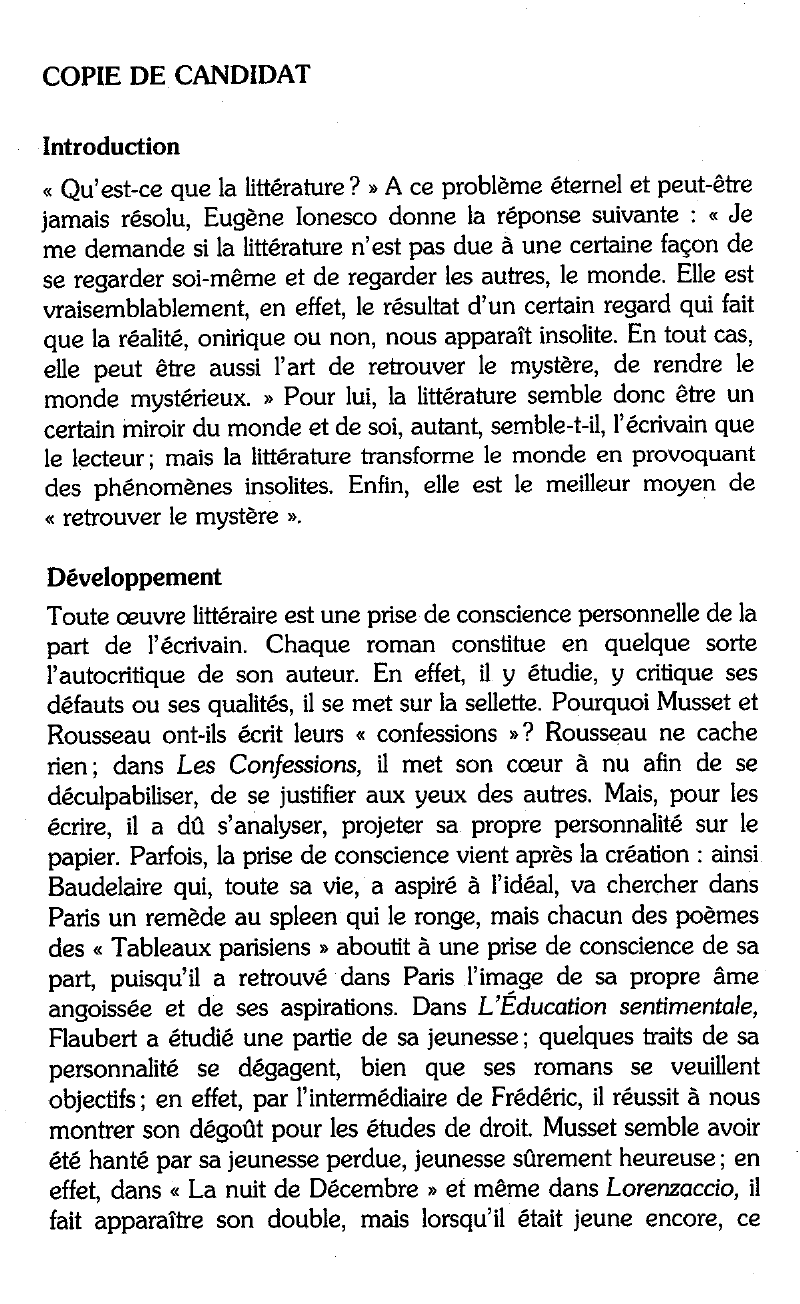Je me demande si la littérature n'est pas due à une certaine façon de se regarder soi-même et de regarder les autres, le monde. Elle est, vraisemblablement, en effet, le résultat d'un certain regard qui fait que la réalité, onirique ou non, nous apparaît insolite. En tout cas, elle peut être aussi l'art de retrouver le mystère, de rendre le monde mystérieux. Ionesco, Discours de réception à l'Académie française. Vous discuterez cette opinion en vous appuyant sur des exemples précis.
Publié le 01/09/2012

Extrait du document
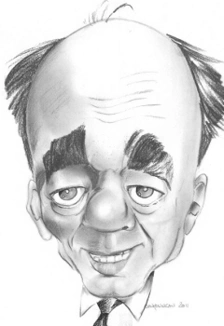
Même si une oeuvre contient souvent en grande partie la personnalité de l'auteur, elle n'en est pas moins un regard sur les autres, un écran d'une société déterminée ou non. Ce regard est parfois une vengeance mue par un plaisir malin à décrire ou à détruire ceux que l'on n'aime pas; ainsi les personnages de Balzac, dans leur description ridicule, sont le résultat d'une caricature digne de Daumier et où Balzac a déchaîné sa haine des petits-bourgeois. De même, Zola, dans Pot-Bouille, décrit le monde bourgeois corrompu et cruel...
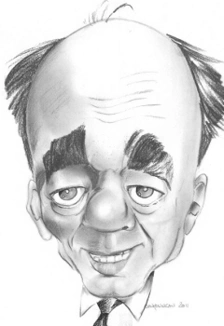
«
COPIE DE CANDIDAT
Introduction
,, Qu'est-ce que la littérature?» A ce problème éternel et peut-être
jamais résolu, Eugène Ionesco donne
la réponse suivante : « Je
me demande si la littérature n'est pas due à une certaine façon de
se regarder soi-même et de regarder
les autres, le monde.
Elle est
vraisemblablement, en
effet, le résultat d'un certain regard qui fait
que la réalité, onirique ou non, nous apparaît insolite.
En tout cas,
elle peut être aussi l'art de retrouver
le mystère, de rendre le
monde mystérieux.
» Pour lui, la littérature semble donc être un
certain miroir du monde et de
soi, autant, semble-t-il, l'écrivain que
le lecteur ; mais la littérature transforme le monde en provoquant
des phénomènes insolites.
Enfin, elle est le meilleur moyen de
« retrouver
le mystère "·
Développement
Tou te œuvre littéraire est une prise de conscience personnelle de la
part de l'écrivain.
Chaque roman constitue en quelque sorte
l'autocritique de son auteur.
En effet, il y étudie, y critique ses
défauts ou ses qualités,
il se met sur la sellette.
Pourquoi Musset et
Rousseau ont-ils écrit leurs « confessions
»? Rousseau ne cache
rien ; dans Les
Confessions, il met son cœur à nu afin de se
déculpabiliser, de se justifier aux yeux des autres.
Mais, pour les
écrire, il a dü s'analyser, projeter sa propre personnalité sur le
papier.
Parfois, la prise de conscience vient après la création : ainsi
Baudelaire qui, toute sa vie, a aspiré à l'idéal, va chercher dans
Paris un remède au spleen qui le ronge, mais chacun des poèmes
des« Tableaux parisiens» aboutit à une prise de conscience de sa
part, puisqu'il a retrouvé dans
Paris l'image de sa propre âme
angoissée et de ses aspirations.
Dans
L'Éducation sentimentale,
Flaubert a étudié une partie de sa jeunesse ; quelques traits de sa
personnalité se dégagent, bien que ses romans se veuillent
objectifs; en
effet, par l'intermédiaire de Frédéric, il réussit à nous
montrer son dégoüt pour les études de
droit.
Musset semble avoir
été hanté par sa jeunesse perdue, jeunesse sürement heureuse ; en
effet, dans « La nuit de Décembre » et même dans Lorenzaccio, il
fait apparaître son double, mais lorsqu'il était jeune encore, ce.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- «Pour douer notre littérature d'une action efficace, il fallait trouver le secret de l'action sur les esprits : ce secret est la clarté. Comprenons ce mot : il faut évidemment le soustraire à des interprétations grossièrement faciles. Paul Valéry a insisté souvent sur le fait que de nombreuses gens la confondent avec leur propre paresse d'esprit. Il ne s'agit pas d'être compris par les distraits. La clarté de Racine n'est qu'une apparence ; je défie un lecteur moyen d'expliquer tout ce
- Fénelon a, en 1693, défini de la manière suivante, la littérature de son temps : « On n'abuse plus, comme on le faisait autrefois, de l'esprit et de la parole. On a pris un genre d'écrire plus simple, plus naturel, plus court, plus nerveux, plus précis. On ne s'attache plus aux paroles que pour exprimer toute la force des pensées, et on n'admet que les pensées vraies, solides, concluantes pour le sujet où l'on se renferme... L'esprit même se cache, parce que toute la perfection de l'ar
- Jean Giraudoux a écrit ; « Mes camarades avec moi ont quitté leurs bancs d'élèves, les uns vers le droit, les autres vers les lettres, tous persuadés qu'ils connaissaient dans ses plus hermétiques ressorts la littérature française. Ils n'en connaissaient rien. Moi non plus. Les morceaux choisis ne sont qu'une des formes du complot qui travaille depuis des siècles à dissimuler à chaque Français la réalité de cet héritage dont il est, quel qu'il soit, le légataire universel. » Explique
- « Le secret de la poésie ne consiste pas tant à offrir de la beauté qu'à unir, à faire communiquer intimement l'âme des hommes. » Ainsi s'exprimait dans son discours de réception à l'Académie espagnole en 1960 Vicente Aleixandre, Prix Nobel de Littérature 1977. Vous vous demanderez si cette conception de la poésie correspond à la vôtre et vous essayerez de préciser ce que vous cherchez dans la lecture des poètes, en vous appuyant toujours sur des exemples et des citations.
- On pouvait lire dans Les Lettres françaises du 25 février 1954 (Gallimard) ces lignes de Thomas Mann : «Le classicisme, ce n'est pas quelque chose d'exemplaire ; en général, et hors du temps, même s'il a beaucoup et tout à faire avec les deux idées implicites ici, celle d'une forme, et celle de la précellence de cette forme. Bien loin de là, le classicisme est plutôt cet exemple tel qu'il a été réalisé, la première création d'une forme de vie spirituelle se manifestant dans la vie indi