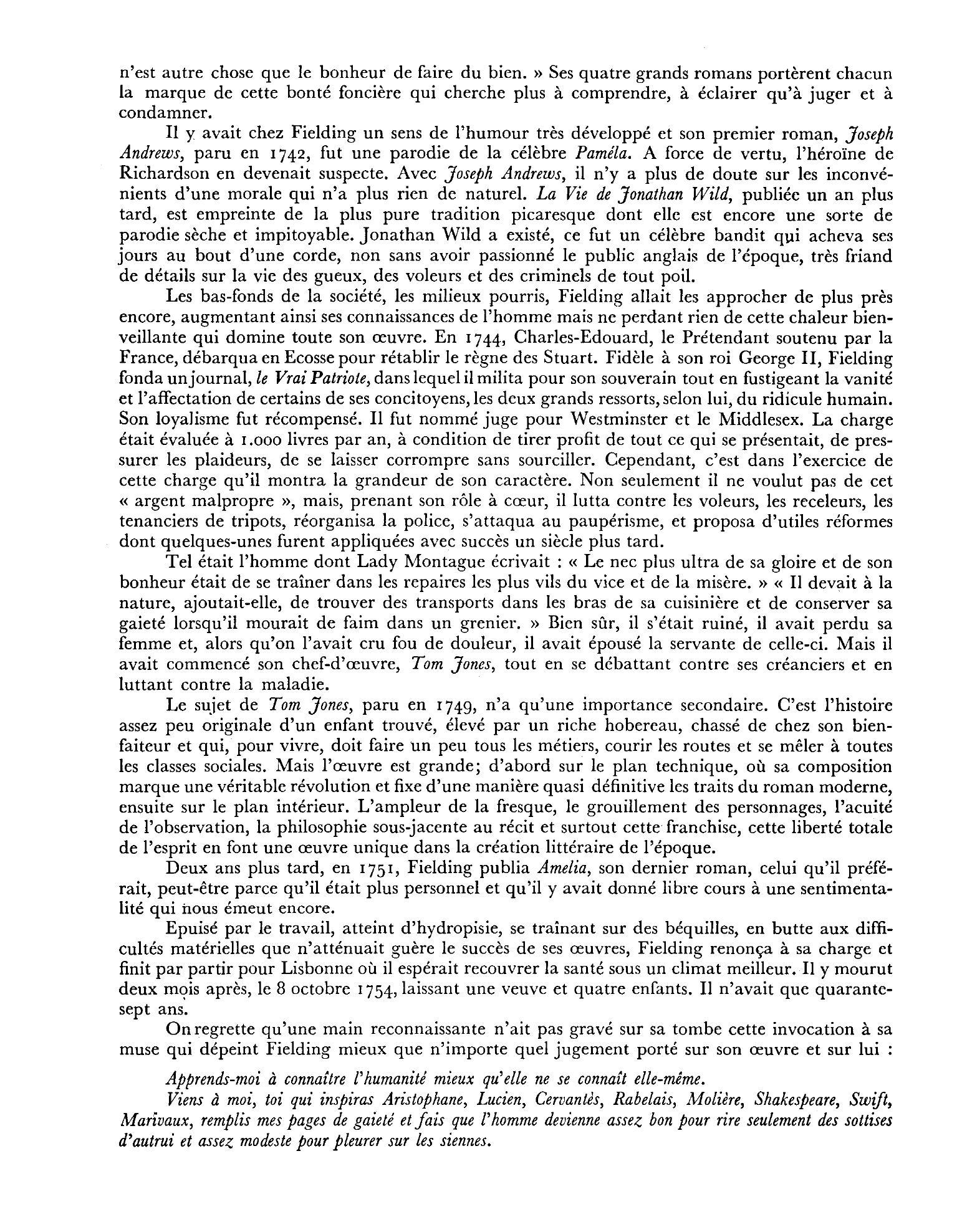Henry Fielding
Publié le 19/04/2012
Extrait du document
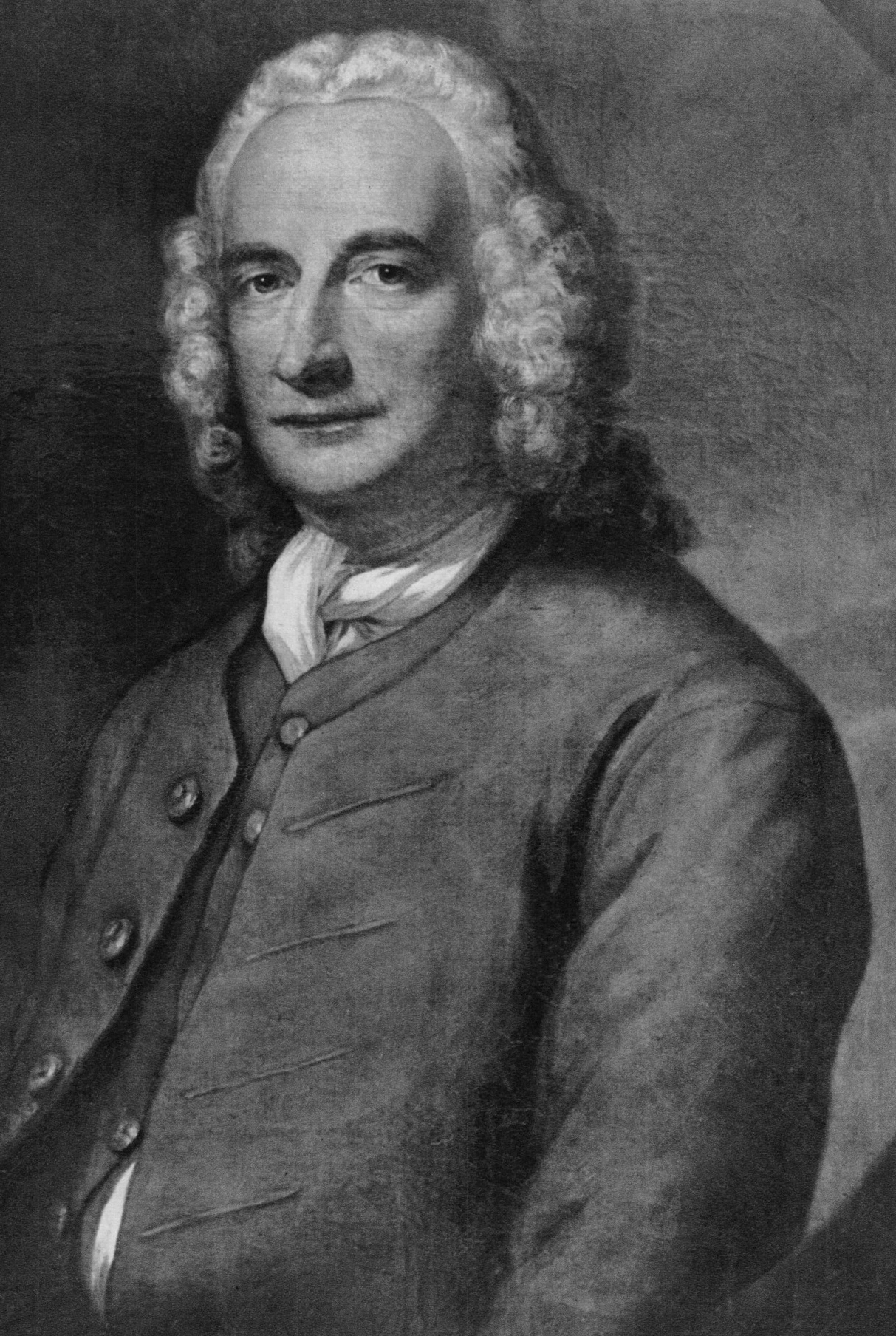
Descendant d'une noble famille anglaise, Fielding est né dans le Somerset. Orphelin de mère à dix ans, il fut élevé par son père et sa nouvelle épouse italienne, qui l'envoyèrent à Eton acquérir une éducation classique et littéraire. Il étudia le droit à Leyde jusqu'en 1728, puis rentra à Londres. Fielding cultivait une passion pour l'écriture et il composa une vingtaine de comédies dont le modeste succès lui permit tout juste de vivre. Tom Pouce, sa seule pièce vraiment remarquée, fut jouée au Haymarket Theatre en 1729. Il épousa en 1734 Charlotte Cradock qui lui inspirera le sujet du roman Amélie. Mais son activité théâtrale fut stoppée nette en 1737, par l'adoption du Licensing Act du gouvernement Walpole visant à mettre un terme aux satires politiques. Muselé par la loi, il reprit ses études de droit, dirigea le journal politique The Champion, et obtint une charge d'avocat (1740). Avide de littérature, il se lança dans l'écriture de romans, parodiant dans son premier livre Joseph Andrew, la Pamela sentimentaliste de Richardson. En 1743, il publia les trois volumes de poésie et de prose Mélanges. Remarié trois ans après le décès de sa femme bien-aimée, il rédigea son chef-d'œuvre Tom Jones, histoire d'un enfant trouvé (1749), récit initiatique d'un héros à la conquête de l'amour. Devenu juge de paix dans le Middlesex, Fielding, malade, se rapprocha de la religion et de l'idée de la “ nature bonne ”. Il partit chercher la clémence du climat de Lisbonne, où il mourut à quarante-sept ans.
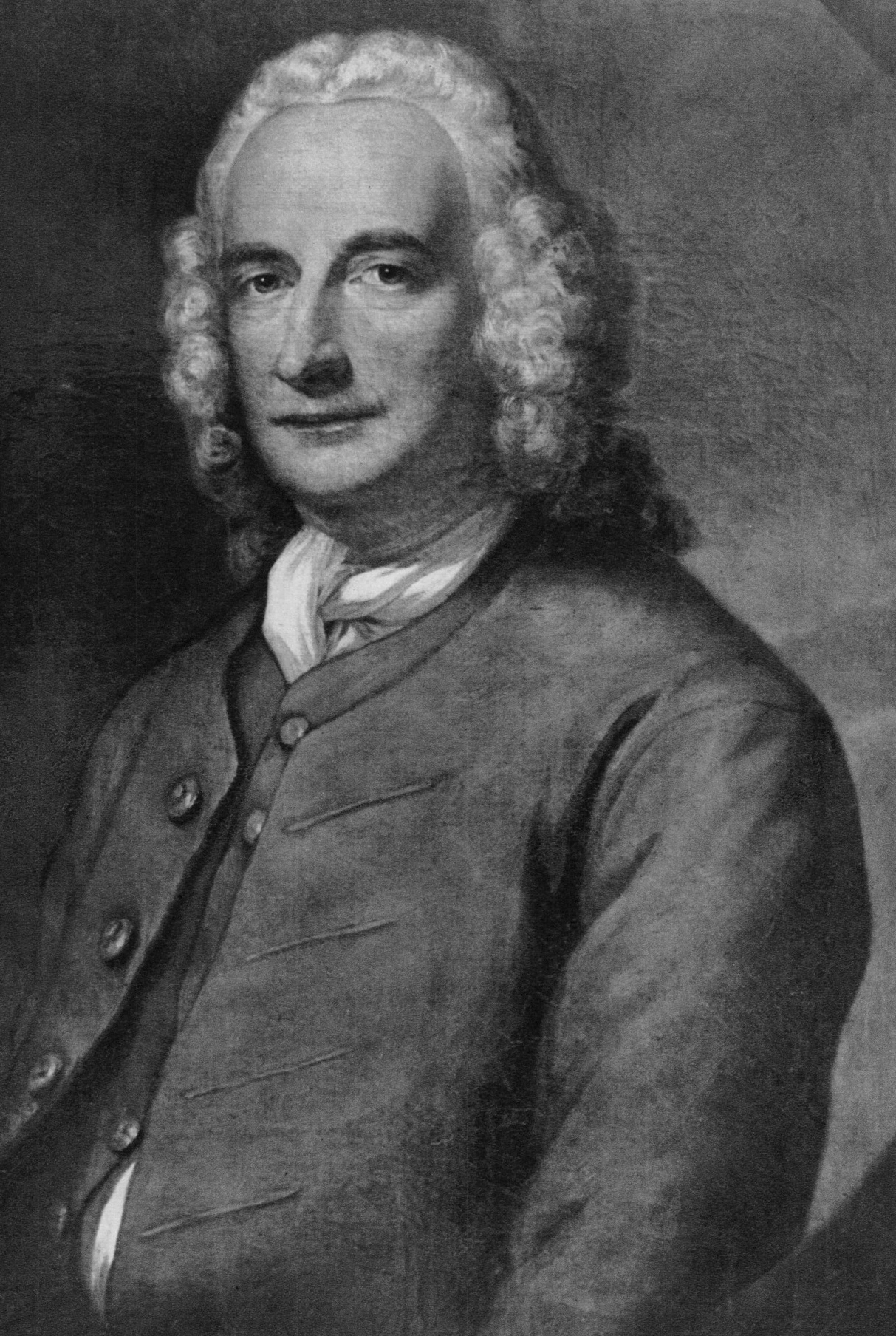
«
n'est autre chose que le bonheur de faire du bien.
» Ses quatre grands romans portèrent chacun
la marque de cette bonté foncière qui cherche plus à comprendre, à éclairer qu'à juger et à
condamner.
Il y avait chez Fielding un sens de l'humour très développé et son premier roman, Joseph
Andrews, paru en 1742, fut une parodie de la célèbre Paméla.
A force de vertu, l'héroïne de
Richardson en devenait suspecte.
Avec Joseph Andrews, il n'y a plus de doute sur les inconvé
nients
d'une morale qui n'a plus rien de naturel.
La Vie de Jonathan Wild, publiée un an plus
tard, est empreinte de la plus pure tradition picaresque dont elle est encore une sorte de
parodie sèche et impitoyable.
Jonathan Wild a existé, ce fut un célèbre bandit qui acheva ses
jours au bout d'une corde, non sans avoir passionné le public anglais de l'époque, très friand
de détails sur la vic des gueux, des voleurs et des criminels de tout poil.
Les bas-fonds de
la société, les milieux pourris, Fielding allait les approcher de plus près
encore,
augmentant ainsi ses connaissances de l'homme mais ne perdant rien de cette chaleur bien
veillante
qui domine toute son œuvre.
En 1744, Charles-Edouard, le Prétendant soutenu par la
France, débarqua en Ecosse pour rétablir le règne des Stuart.
Fidèle à son roi George II, Fielding
fonda
un journal, le Vrai Patriote, dans lequel il milita pour son souverain tout en fustigeant la vanité
et l'affectation de certains de ses concitoyens, les deux grands ressorts, selon lui, du ridicule humain.
Son loyalisme fut récompensé.
Il fut nommé juge pour Westminster et le Middlesex.
La charge
était évaluée à 1 .ooo livres par an, à condition de tirer profit de tout ce qui se présentait, de pres
surer les plaideurs, de
se laisser corrompre sans sourciller.
Cependant, c'est dans l'exercice de
cette charge qu'il montra la grandeur de son caractère.
Non seulement il ne voulut pas de cet
« argent malpropre >>, mais, prenant son rôle à cœur, il lutta contre les voleurs, les receleurs, les
tenanciers
de tripots, réorganisa la police, s'attaqua au paupérisme, et proposa d'utiles réformes
dont quelques-unes furent appliquées avec succès un siècle plus tard.
Tel était l'homme dont Lady Montague écrivait : « Le nec plus ultra de sa gloire et de son
bonheur était de se traîner dans les repaires les plus vils du vice et de la misère.
» « Il devait à la
nature, ajoutait-elle, de trouver des transports dans les bras de sa cuisinière et de conserver sa
gaieté lorsqu'il
mourait de faim dans un grenier.
» Bien sûr, il s'était ruiné, il avait perdu sa
femme et, alors
qu'on l'avait cru fou de douleur, il avait épousé la servante de celle-ci.
Mais il
avait commencé son chef-d'œuvre, Tom Jones, tout en se débattant contre ses créanciers et en
luttant contre la maladie.
Le sujet de Tom Jones, paru en 1749, n'a qu'une importance secondaire.
C'est l'histoire
assez
peu originale d'un enfant trouvé, élevé par un riche hobereau, chassé de chez son bien
faiteur
et qui, pour vivre, doit faire un peu tous les métiers, courir les routes et se mêler à toutes
les classes sociales.
Mais
l'œuvre est grande; d'abord sur le plan technique, où sa composition
marque une véritable révolution et fixe d'une manière quasi définitive les traits du roman moderne,
ensuite
sur le plan intérieur.
L'ampleur de la fresque, le grouillement des personnages, l'acuité
de l'observation, la philosophie sous-jacente au récit et surtout cette franchise, cette liberté totale
de l'esprit
en font une œuvre unique dans la création littéraire de l'époque.
Deux ans plus tard, en 1751, Fielding publia Amelia, son dernier roman, celui qu'il préfé
rait,
peut-être parce qu'il était plus personnel et qu'il y avait donné libre cours à une sentimenta
lité
qui nous émeut encore.
Epuisé
par le travail, atteint d'hydropisie, se traînant sur des béquilles, en butte aux diffi
cultés matérielles
que n'atténuait guère le succès de ses œuvres, Fielding renonça à sa charge et
finit
par partir pour Lisbonne où il espérait recouvrer la santé sous un climat meilleur.
Il y mourut
deux mçis après, le 8 octobre 1754, laissant une veuve et quatre enfants.
Il n'avait que quarante
sept ans.
On regrette qu'une main reconnaissante n'ait pas gravé sur sa tombe cette invocation à sa
muse
qui dépeint Fielding mieux que n'importe quel jugement porté sur son œuvre et sur lui :
Apprends-moi à connaître l'humanité mieux qu'elle ne se connaît elle-même.
Viens à moi, toi qui inspiras Aristophane, Lucien, Cervantès, Rabelais, Molière, Shakespeare, Swift,
Marivaux, remplis mes pages de gaieté et fais que l'homme devienne asse;:; bon pour rire seulement des sottises
d'autrui et asse;:; modeste pour pleurer sur les siennes..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- AMÉLIE Henry Fielding (résumé & analyse)
- AVENTURES DE JOSEPH ANDREWS (Les) Henry Fielding (résumé & analyse)
- Le personnage de TOM JONES d’Henry Fielding Tom Jones
- Henry Fielding: The History of Tom Jones, a Foundling (Sprache & Litteratur).
- Tom Jones (1749) Henry Fielding Book I -- Chapter 1 An author ought to consider himself, not as a gentleman who gives a private or eleemosynary treat, but rather as one who keeps a public ordinary, at which all persons are welcome for their money.