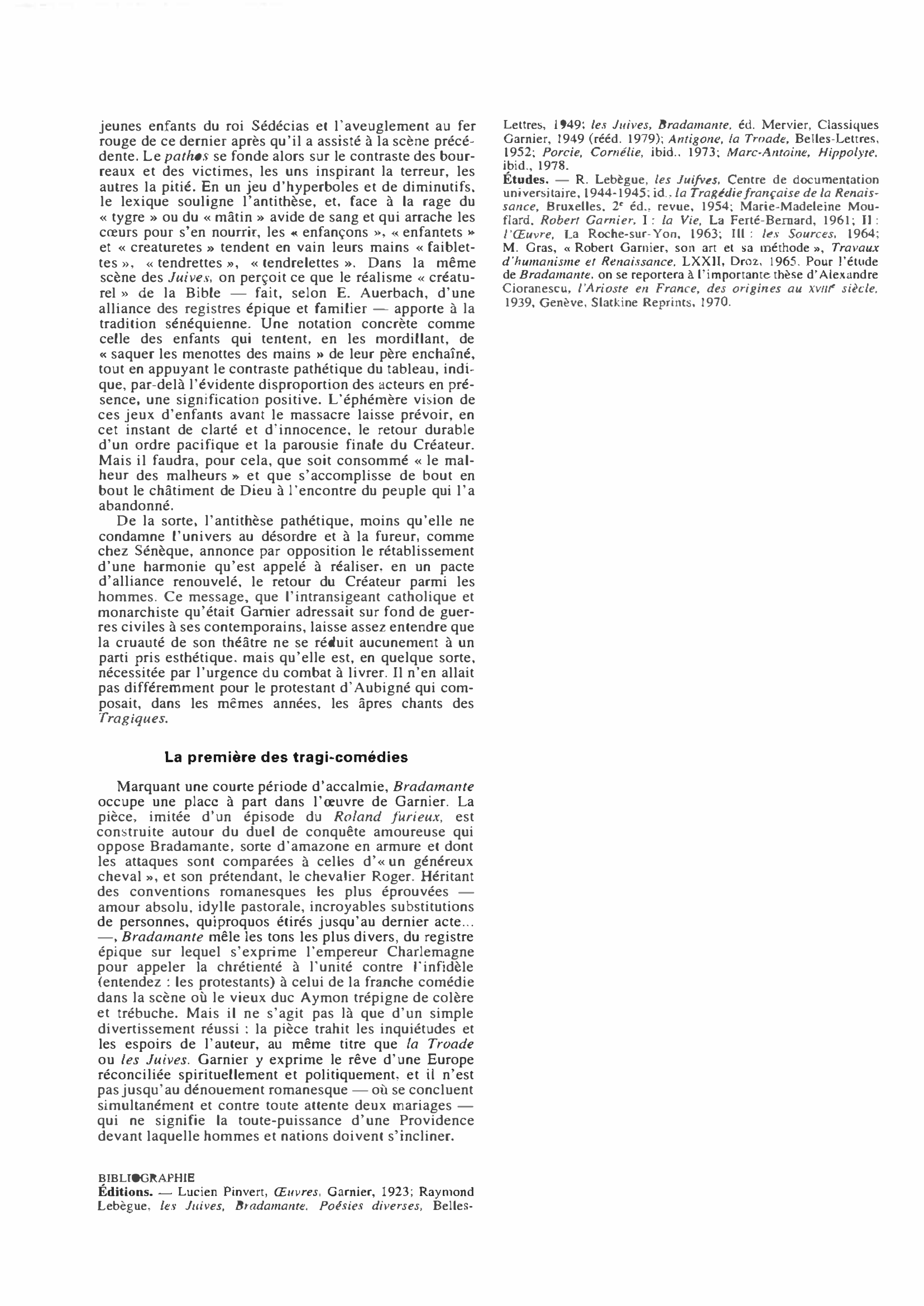GARNIER Robert : sa vie et son oeuvre
Publié le 13/12/2018
Extrait du document
GARNIER Robert (1545-1590). Les huit compositions dramatiques de Robert Garnier — sept tragédies, une tragi-comédie —, écrites sur une quinzaine d’années, de 1567 à 1583, constituent l’œuvre théâtrale la plus étendue, à la fois par ses dimensions et l’ampleur de son registre, qu’ait produite la Renaissance française. On a souvent voulu voir dans ces pièces les ébauches encore imparfaites des chefs-d’œuvre classiques qui fleurirent au siècle suivant. En fait, il s'agit là d’une erreur de perspective : même si Garnier a fourni à Corneille ou à Racine plusieurs sujets tragiques (la Mort de Pompée inspirée de Marc-Antoine, Phèdre héritant d’Hippolyte sa trame et ses ténèbres) et une frappe toute nouvelle de l’alexandrin, son œuvre appartient, dans son ensemble, à un système original, voire à une culture, dont les préoccupations fondamentales sont en grande partie étrangères à celles de la dramaturgie classique. Comme chez ses contemporains Jodelle, Grévin ou La Taille, l'univers dramatique de Garnier apparaît comme ce théâtre de l’effroi et de la cruauté qui trouve dans Sénèque son modèle et dans la réalité présente sa toile de fond et ses images obsédantes.
Un magistrat dramaturge
Né à La Ferté-Bernard, Robert Garnier fait ses études de droit à Toulouse, où il se lie avec Guy du Faur de Pibrac. Auteur, dès cette époque, de quelques poèmes de circonstance, composés, notamment, à l’occasion de l’entrée de Charles IX à Toulouse (1565), il manifeste, dans ses « Chants royaux en allégorie » (1564 et 1566), son espoir d’un retour à l’ordre en matière politique et religieuse. Avocat au parlement de Paris en 1567, où il a rejoint son ami Pibrac, il célèbre le règne du jeune Charles IX dans son Hymne de la monarchie — forme de gouvernement où il voit, dans l'alliance de l'harmonie et de la force, le bien suprême. Sa tragédie romaine de Porcie (1569), qui évoque la période d’anarchie préludant à l'avènement d’Auguste, traduit les mêmes orientations politiques. Établi au Mans à partir de 1569 comme conseiller au présidial et marié quelques années plus tard avec la poétesse Françoise Hubert (1573), il publie coup sur coup les tragédies d'Hippolyte (1573) — dont Racine se souviendra pour Phèdre —, de Cornélie (1574) et de Marc-Antoine (1578), qui évoquent les malheurs des deux triumvirats et contiennent des allusions aux troubles civils contemporains, ainsi que la Troade (1579) et Antigone (1580). Cependant que l’œuvre dramatique rencontre son apothéose avec la tragi-comédie de Brada-mante, inspirée de l’Arioste (1582), et surtout avec la tragédie des Juives (1583), la carrière du magistrat culmine en 1586, lors de sa nomination au Grand Conseil du roi. Proche un instant de la Ligue, mais bientôt effrayé par ses excès et par l’assassinat en 1589 de Henri III, Garnier serait, dit-on, mort de chagrin.
«
jeunes
enfants du roi Sédécias et l'aveuglement au fer
rouge de ce dernier après qu'il a assisté à la scène précé
dente.
Le pathos se fonde alors sur le contraste des bour
reaux et des victimes, les uns inspirant la terreur, les
autres la pitié.
En un jeu d'hyperboles et de diminutifs.
le lexique souligne l'antithèse, et, face à la rage du
« tygre » ou du « mâtin » avide de sang et qui arrache les
cœurs pour s'en nourrir, les >, >
et « creaturetes >> tendent en vain leurs mains « faiblet
tes », « tendrettes », « tendrelettes ».
Dans la même
scène des Juives, on perçoit ce que le réalisme « créatu
re! >> de la Bible -fait, selon E.
Auerbach, d'une
aJliance des registres épique et familier -apporte à la
tradition sénéquienne.
Une notation concrète comme
celle des enfants qui tentent, en les mordillant, de
« saquer les menottes des mains >> de leur père enchainé,
tout en appuyant le contraste pathétique du tableau, indi
que, par-delà l'évidente disproportion des acteurs en pré
sence, une signification positive.
L'éphémère vision de
ces jeux d'enfants avant le massacre laisse prévoir, en
cet instant de clarté et d'innocence, le retour durable
d'un ordre pacifique et la parousie finale du Créateur.
Mais il faudra, pour cela, que soit consommé « le mal
heur des malheurs>> et que s'accomplisse de bout en
bout le châtiment de Dieu à l'encontre du peuple qui l'a
abandonné.
De la sorte, l'antithèse pathétique, moins qu'elle ne
condamne l'univers au désordre et à la fureur, comme
chez Sénèque, annonce par opposition le rétablissement
d'une harmonie qu'est appelé à réaliser, en un pacte
d'alliance renouvelé, le retour du Créateur parmi les
hommes.
Ce message, que l'intransigeant catholique et
monarchiste qu'était Garnier adressait sur fond de guer
res civiles à ses contemporains, laisse assez entendre que
la cruauté de son théâtre ne se réduit aucunement à un
parti pris esthétique, mais qu'elle est, en quelque sorte,
nécessitée par l'urgence du combat à livrer.
Il n'en allait
pas différemment pour le protestant d'Aubigné qui com
posait, dans les mêmes années, les âpres chants des
Tragiques.
La première des tragi-comédies
Marquant une courte période d'accalmie, Bradamante
occupe une place à part dans l'œuvre de Garnier.
La
pièce, imitée d'un épisode du Roland jitrieux, est
construite autour du duel de conquête amoureuse qui
oppose Bradamante, sorte d'amazone en armure et dont
les attaques sont comparées à celles d'« un généreux
cheval », et son prétendant, le chevalier Roger.
Héritant
des conventions romanesques les plus éprouvées -
amour absolu, idylle pastorale, incroyables substitutions
de personnes, quiproquos étirés jusqu'au dernier acte ..
.
-, Bradamante mêle les tons les plus divers, du registre
épique sur lequel s'exprime l'empereur Charlemagne
pour appeler la chrétienté à l'unité contre l'infidèle
(entendez : les protestants) à celui de la franche comédie
dans la scène où le vieux duc Aymon trépigne de colère
et trébuche.
Mais il ne s'agit pas là que d'un simple
divertissement réussi : la pièce trahit les inquiétudes et
les espoirs de l'auteur, au même titre que la Troade
ou les Juives.
Garnier y exprime le rêve d'une Europe
réconciliée spirituellement et politiquement, et il n'est
pas jusqu'au dénouement romanesque-où se concluent
simultanément et contre toute attente deux mariages -
qui ne signifie la toute-puissance d'une Providence
devant laquelle hommes et nations doivent s'incliner.
BIBLJOGRAPHIE
Éditions.
-Lucien Pinvert, Œuvres, Garnier, 1923; Raymond
Lebègue, les Juives, Bradamante, Poésies diverses, Belles- Lettres,
1949; les Juives, Bradamante.
éd.
Mervier, Classiques
Garnier, 1949 (rééd.
1979): Amig one .
la Troade, Belles-Lettres.
1952; Porcie, Cornélie, ibid., 1973; Marc-Antoine, Hippolyte.
ibid., 1978.
Études.
-R.
Lebègue, les Juifves, Centre de documentation
universitaire, 1944-1945; id., la Tragédie françai se de la Renais
sance, Bruxelles, 2• éd., revue, 1954; Marie-Madeleine Mou
fl ard , Robert Garnier.
1 : la Vie , La Fené-Bemard, 1961; II :
l'Œuvre.
La Roche-sur- Yon, 1963; Ill : les Sources, 1964;
M.
Gras, « Robert Garnier, son art et sa méthode>>, Travaux
d'humanisme et Renaissance.
LXXII, Droz, 1965.
Pour l'étude
de Bradamante.
on se reportera à l'importante thèse d'Alexandre
Cioranescu, l'Arioste en France, des orig in es au xvur< si�c le.
1939, Genève.
Slatkine Reprints.
1970..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Juives (les). Tragédie en cinq actes et en vers, avec chœurs, de Robert Garnier (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Motherwell, Robert - vie et oeuvre du peintre.
- Indiana, Robert - vie et oeuvre du peintre.
- Robert, Hubert - vie et oeuvre du peintre.
- Combas, Robert - vie et oeuvre du peintre.