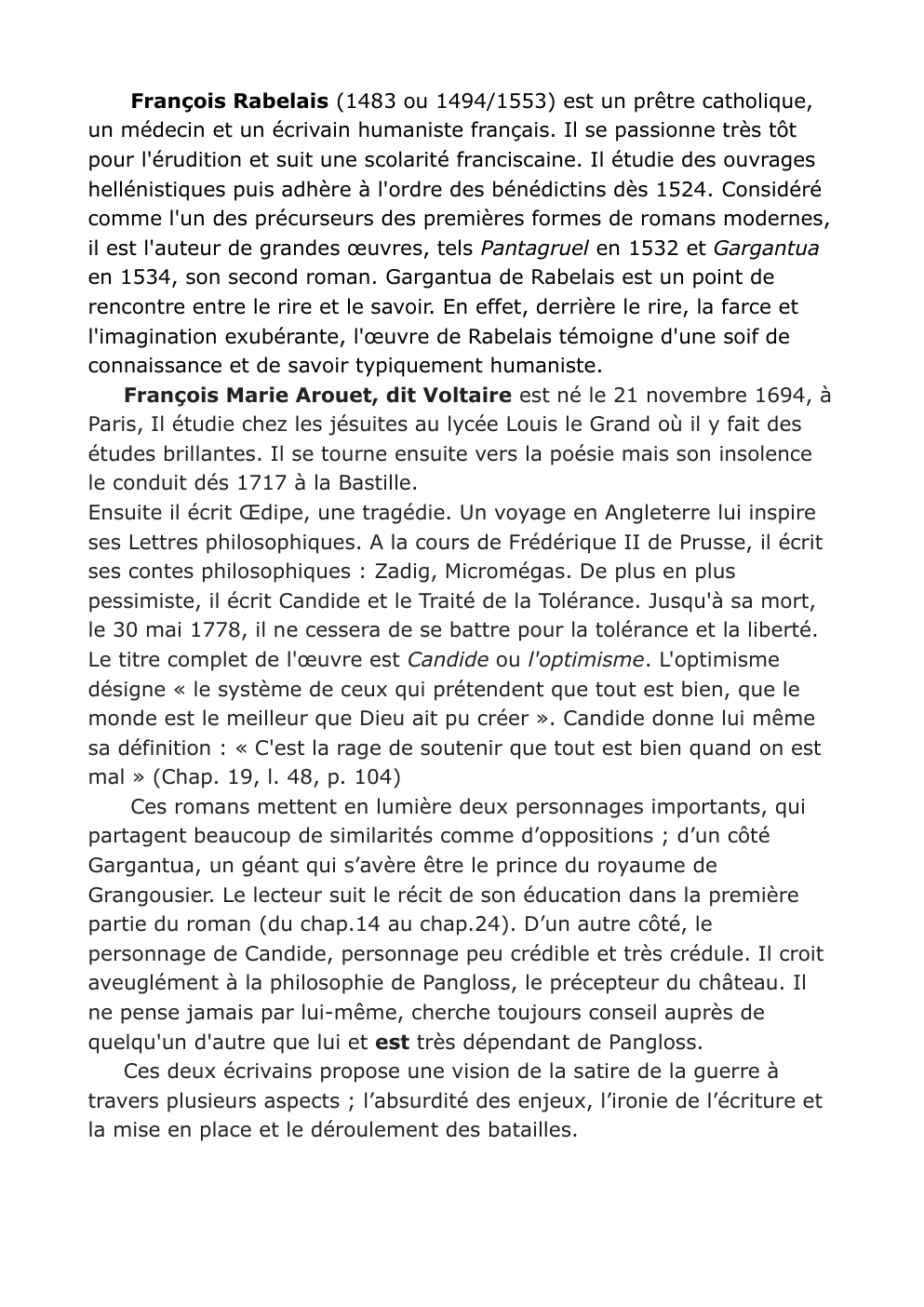Gargantua, rire et savoir
Publié le 11/02/2024
Extrait du document
«
François Rabelais (1483 ou 1494/1553) est un prêtre catholique,
un médecin et un écrivain humaniste français.
Il se passionne très tôt
pour l'érudition et suit une scolarité franciscaine.
Il étudie des ouvrages
hellénistiques puis adhère à l'ordre des bénédictins dès 1524.
Considéré
comme l'un des précurseurs des premières formes de romans modernes,
il est l'auteur de grandes œuvres, tels Pantagruel en 1532 et Gargantua
en 1534, son second roman.
Gargantua de Rabelais est un point de
rencontre entre le rire et le savoir.
En effet, derrière le rire, la farce et
l'imagination exubérante, l'œuvre de Rabelais témoigne d'une soif de
connaissance et de savoir typiquement humaniste.
François Marie Arouet, dit Voltaire est né le 21 novembre 1694, à
Paris, Il étudie chez les jésuites au lycée Louis le Grand où il y fait des
études brillantes.
Il se tourne ensuite vers la poésie mais son insolence
le conduit dés 1717 à la Bastille.
Ensuite il écrit Œdipe, une tragédie.
Un voyage en Angleterre lui inspire
ses Lettres philosophiques.
A la cours de Frédérique II de Prusse, il écrit
ses contes philosophiques : Zadig, Micromégas.
De plus en plus
pessimiste, il écrit Candide et le Traité de la Tolérance.
Jusqu'à sa mort,
le 30 mai 1778, il ne cessera de se battre pour la tolérance et la liberté.
Le titre complet de l'œuvre est Candide ou l'optimisme.
L'optimisme
désigne « le système de ceux qui prétendent que tout est bien, que le
monde est le meilleur que Dieu ait pu créer ».
Candide donne lui même
sa définition : « C'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est
mal » (Chap.
19, l.
48, p.
104)
Ces romans mettent en lumière deux personnages importants, qui
partagent beaucoup de similarités comme d’oppositions ; d’un côté
Gargantua, un géant qui s’avère être le prince du royaume de
Grangousier.
Le lecteur suit le récit de son éducation dans la première
partie du roman (du chap.14 au chap.24).
D’un autre côté, le
personnage de Candide, personnage peu crédible et très crédule.
Il croit
aveuglément à la philosophie de Pangloss, le précepteur du château.
Il
ne pense jamais par lui-même, cherche toujours conseil auprès de
quelqu'un d'autre que lui et est très dépendant de Pangloss.
Ces deux écrivains propose une vision de la satire de la guerre à
travers plusieurs aspects ; l’absurdité des enjeux, l’ironie de l’écriture et
la mise en place et le déroulement des batailles.
L’Absurdité de la guerre se traduit par des enjeux conflictuels dont le
sens est ironique ou bien inexistant ;
Après l’écriture de Gargantua, une expression fait surface « Guerre
picrocholine » elle désigne un conflit, une guerre que se mènent des
personnes ou des institutions, et dont les causes sont soient peu ou pas
connues, ou bien ridicules.
Dans cette oeuvre, en effet, le roi Picrochole entre en conflit avec
Grandgousier pour une simple histoire de « fouaces », les bergers de
Grandgousier qui se sont emparés d'un ou deux paniers de fouaces suite
au refus des fouaciers de les leur vendre.
Ceux-ci proposent de leur acheter quelques-unes de leurs belles fouaces,
dorées et moelleuses.
Les fouaciers refusent et s'ensuit une bagarre qui
aboutit à une déclaration de guerre par Picrochole à Grandgousier.
Un
conflit dérisoire entre marchands de fouace, de ce conflit commercial, les
mauvais conseillers du roi Picrochole en ont fait le prétexte pour une
guerre de conquête.
Rabelais considère la guerre vaine et inutile puisque d’elle est provoquée
par des raisons absurdes et qu’elle ne résout pas les conflits, Jean Giono
partage cet avis et l’exprime dans son ouvrage, Lettre aux paysans sur
la pauvreté et la paix, parue en 1938, il explique ;
« Je refuse tout ce qui est inutile et en premier lieu toutes les guerres
car c'est un travail dont l'inutilité pour l'homme est aussi claire que le
soleil.
» avec une beauté d’écriture évidente, il remet en cause les
conflits de la Guerre 14-18 et met en avant la perte de nombreuses vies
irremplaçables et surtout plus importantes que l’impérialisme.
De plus, Rabelais joue de cette absurdité en nommant le chapitre 25,
« Comment un moine de Seuillé sauva l’enclos de l’abbaye du saccage
des ennemis », l'adresse au lecteur permet de montrer le point de vue
négatif et réprobateur de Rabelais à l'encontre de ce massacre, il crée
une complicité avec celui-ci, ce qui permet de favoriser l'adhésion à son
point de vue sur la guerre, un titre absurde qui prête a penser que le
texte qui suit n’est qu’un ramassis insensé, et c’est cette imagination
hors pair qui permet à Rabelais d’utiliser l’humour comme outil de porte
parole.
Voltaire lui aussi, partage son opinion sur la guerre, qui est du même
ordre,mais l’exprime différemment ; « La guerre est le fruit de la
dépravation des hommes […] dépeuple les Etats et elle y fait régner le
désordre ».
Après avoir été chassé du château, Candide est enrôlé dans
l'armée Bulgare.
Il se retrouve dans une guerre dont il ne comprend pas
le but.
Évidemment, la crédulité de Candide ne lui permet pas d’avoir son
propre avis sur la guerre pour laquelle il combat, enfermé dans les
conflits, il combat sans but comme de nombreux autres soldats.
Voltaire
fait lui aussi référence à l’histoire puisqu’il met en lumière la nature de
l’humanité à foncer tête baisser dans de la violence inexpliquée.
L’Ironie, est réalisée à ce goût puisque dans Gargantua, la mise en place
du personnage du Frère Jean est l’apogée des allusions ironiques.
Moine
pas héros avec sa croix, Frère Jean apparaît dans le vingt-septième
chapitre du roman, alors que les troupes de Picrochole attaquent le clos
et les vignes de l’abbaye de Seuillé, dont le nom évoque l' abbaye de Seuilly
près de la Devinière.
Le protagoniste est présenté comme un moine
brave et habile, « jeune gaillard, pimpant, enjoué, adroit, hardi,
entreprenant, décidé, grand, maigre, bien fendu de gueule, bien
avantagé en nez, bel expéditeur d'heures, beau débrideur de messes,
beau décrotteur de vigiles, »Tandis que les troupes de Picrochole pillent
la ville et dévastent maintenant la vigne de l'abbaye (le « clos auquel
était leur boire de toute l'année »…), Frère Jean sort puis retourne vers
« l'église, où étaient les autres moines », pour les en informer.
Il les
interrompt et termine par ces mots : « Ventre saint....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation sur Gargantua Sujet : Où se situe Gargantua entre rire et savoir ?
- En quoi peut on dire que Gargantua de Rabelais prête autant a rire qu’il donne à penser ?
- Dissertation sur œuvre Gargantua, RABELAIS: Le rire
- dissertation Gargantua: le savoir est-il pris au sérieux dans Gargantua ?
- Que pensez-vous de ces affirmations de Jean Ferniot : Il faut être devenu citadin depuis quelques décennies pour avoir oublié à quel point la nature est inhumaine et pour détester la ville, cette ville que justement les hommes édifièrent pour se protéger et pour vivre un peu plus confortablement ensemble. Il faut savoir, du reste, ce que les habitants des villes entendent par week-end à la belle saison, dans une demeure agréablement installée et entourée de fleurs. Si la civilisation i