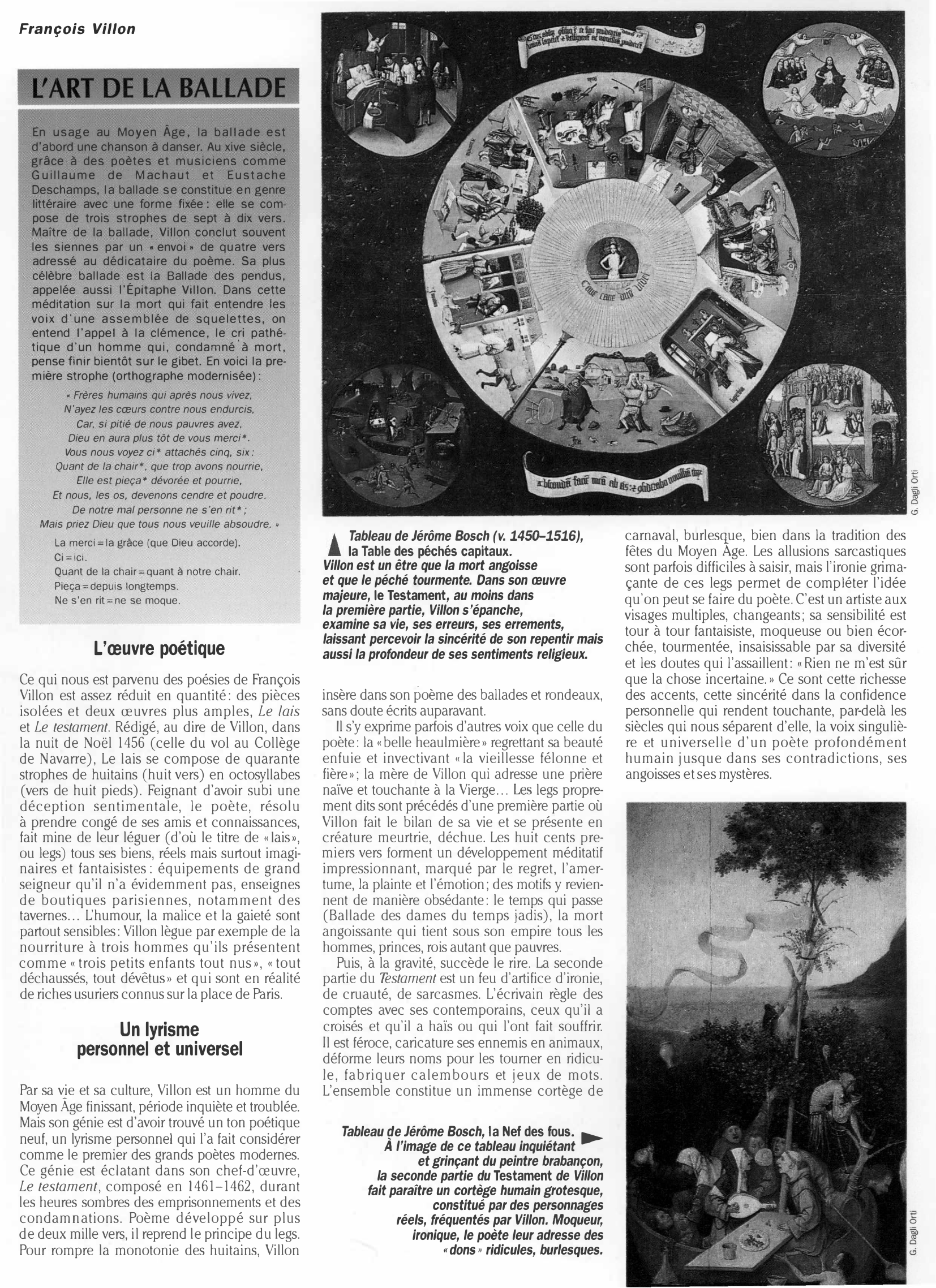FRANÇOIS VILLON
Publié le 05/02/2019
Extrait du document

Tableau de Jérôme Bosch (v. 1450-1516), la Table des péchés capitaux.
Villon est un être que la mort angoisse et que le péché tourmente. Dans son œuvre majeure, le Testament, au moins dans la première partie, Villon s’épanche, examine sa vie, ses erreurs, ses errements, laissant percevoir la sincérité de son repentir mais aussi la profondeur de ses sentiments religieux.
insère dans son poème des ballades et rondeaux, sans doute écrits auparavant.
Il s’y exprime parfois d’autres voix que celle du poète: la «belle heaulmière» regrettant sa beauté enfuie et invectivant «la vieillesse félonne et fière»; la mère de Villon qui adresse une prière naïve et touchante à la Vierge... Les legs proprement dits sont précédés d’une première partie où Villon fait le bilan de sa vie et se présente en créature meurtrie, déchue. Les huit cents premiers vers forment un développement méditatif impressionnant, marqué par le regret, l’amertume, la plainte et l’émotion ; des motifs y reviennent de manière obsédante: le temps qui passe (Ballade des dames du temps jadis), la mort angoissante qui tient sous son empire tous les hommes, princes, rois autant que pauvres.
Puis, à la gravité, succède le rire. La seconde partie du Testament est un feu d’artifice d’ironie, de cruauté, de sarcasmes. L’écrivain règle des comptes avec ses contemporains, ceux qu’il a croisés et qu’il a haïs ou qui l’ont fait souffrir. Il est féroce, caricature ses ennemis en animaux, déforme leurs noms pour les tourner en ridicule, fabriquer calembours et jeux de mots. L’ensemble constitue un immense cortège de
Tableau de Jérôme Bosch, la Nef des fous.
À l’image de ce tableau inquiétant et grinçant du peintre brabançon, la seconde partie du Testament de Villon fait paraître un cortège humain grotesque, constitué par des personnages réels, fréquentés par Villon. Moqueur, ironique, le poète leur adresse des «dons» ridicules, burlesques.
G. Dagli Orti q Dagli Orti
carnaval, burlesque, bien dans la tradition des fêtes du Moyen Âge. Les allusions sarcastiques sont parfois difficiles à saisir, mais l’ironie grimaçante de ces legs permet de compléter l’idée qu’on peut se faire du poète. C’est un artiste aux visages multiples, changeants; sa sensibilité est tour à tour fantaisiste, moqueuse ou bien écorchée, tourmentée, insaisissable par sa diversité et les doutes qui l’assaillent: «Rien ne m’est sûr que la chose incertaine. » Ce sont cette richesse des accents, cette sincérité dans la confidence personnelle qui rendent touchante, par-delà les siècles qui nous séparent d’elle, la voix singulière et universelle d’un poète profondément humain jusque dans ses contradictions, ses angoisses et ses mystères.
L'ART DE LA BALLADE
En usage au Moyen Âge, la ballade est d'abord une chanson à danser. Au xive siècle, grâce à des poètes et musiciens comme Guillaume de Machaut et Eustache Deschamps, la ballade se constitue en genre littéraire avec une forme fixée : elle se compose de trois strophes de sept à dix vers. Maître de la ballade, Villon conclut souvent les siennes par un «envoi» de quatre vers adressé au dédicataire du poème. Sa plus célèbre ballade est la Ballade des pendus, appelée aussi l’Épitaphe Villon. Dans cette méditation sur la mort qui fait entendre les voix d’une assemblée de squelettes, on entend l’appel à la clémence, le cri pathétique d’un homme qui, condamné à mort, pense finir bientôt sur le gibet.

«
François
Villon
En usage au Moyen Âge, la ballade est
d'abord une chanson a danser.
Au xive siècle,
grâce à des poètes et musiciens comme
Guillaume de Machaut et Eustache
Deschamps, la ballade se constitue en genre
littéraire avec une forme fixée : elle se com
pose de trois strophes de sept à dix vers.
Maitre de la ballade, Villon conclut souvent
les siennes par un • envoi • de quatre vers
adressé au dédicataire du poème.
Sa plus
célèbre ballade est la Ballade des pendus,
appelée aussi I'Ëpitaphe Villon.
Dans cette
méditation sur la mort qui fait entendre les
voix d'une assemblée de squelettes, on
entend l'appel à la clémence, le cri pathé·
tique d'un homme qui, condamné · à mort,
pense finir bientôt sur le gibet.
En voici la pre·
miêre strophe (orthographe modernisée):
• Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous merci*.
Vous nous voyez ci* attachés cinq, six:
Quant de la chair*, que trop avons nourrie,
Elle est pieça* dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s'en rit*;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.
•
La merci= la grâce (que Dieu accorde).
Ci=ici.
Quant de la chair= quant à notre chair.
Pieça =depuis longtemps.
Ne s'en rit=ne se moque.
L'œuvre poétique
Ce qui nous est parvenu des poésies de François
Villon est assez réduit en quantité: des pièces
isolées et deux œuvres plus amples, Le lais
et Le testament.
Rédigé, au dire de Villon, dans
la nuit de Noël 1456 (celle du vol au Collège
de Navarre), Le lais se compose de quarante
strophes de huitains (huit vers) en octosyllabes
(vers de huit pieds).
Feignant d'avoir subi une
déception sentimentale , le poète , résolu
à prendre congé de ses amis et connaissances,
fait mine de leur léguer (d'où le titre de > et qui sont en réalité
de riches usuriers connus sur la place de Paris.
Un lyrisme
personnel et universel
Par sa vie et sa culture, Villon est un homme du
Moyen Âge finissant, période inquiète et troublée.
Mais son génie est d'avoir trouvé un ton poétique
neuf, un lyrisme personnel qui l'a fait considérer
comme le premier des grands poètes modernes.
Ce génie est éclatant dans son chef-d'œuvre,
Le testament, composé en 1461-1462, durant
les heures sombres des emprisonnements et des
condamnations.
Poème développé sur plus
de deux mille vers, il reprend le principe du legs.
Pour rompre la monotonie des huitains, Villon i Tableau de Jérôme Bosch (v.
1450-1516), a la Table des péchés capitaux.
Villon est un être que la mort angoisse
et que le péché tourmente.
Dans son œuvre
majeure, le Testament, au moins dans
la première partie, Villon s'épanche,
examine sa vie, ses erreurs, ses errements,
laissant percevoir la sincérité de son repentir mais
aussi la profondeur de ses sentiments religieux.
insère dans son poème des ballades et rondeaux,
sans doute écrits auparavant.
Il s'y exprime parfois d'autres voix que celle du
poète: la «belle heaulmière >> regrettant sa beauté
enfuie et invectivant «la vieillesse félonne et
fière»; la mère de Villon qui adresse une prière
naïve et touchante à la Vierge ...
Les legs propre
ment dits sont précédés d'une première partie où
Villon fait le bilan de sa vie et se présente en
créature meurtrie, déchue.
Les huit cents pre
miers vers forment un développement méditatif
impressionnant, marqué par le regret, l'amer
tume, la plainte et l'émotion; des motifs y revien
nent de manière obsédante: le temps qui passe
(Ballade des dames du temps jadis), la mor t
angoissante qui tient sous son empire tous les
hommes, princes, rois autant que pauvres.
Puis, à la gravité, succède le rire.
La seconde
partie du Testament est un feu d'artifice d'ironie,
de cruauté, de sarcasmes.
L'écrivain règle des
comptes avec ses contemporains, ceux qu'il a
croisés et qu'il a haïs ou qui l'ont fait souffrir.
Il est féroce, caricature ses ennemis en animaux,
déforme leurs noms pour les tourner en ridicu
le, fabriquer calembours et jeux de mots.
L'ensemble constitue un immense cortège de
Tableau �e Jérôme Bosch, la Nef des fous.
...,._
A l'image de ce tableau inquiétant
et grinçant du peintre brabançon,
la seconde partie du Testament de Villon
fait paraître un cortège humain grotesque,
constitué par des personnages
réels, fréquentés par Villon.
Moqueur,
ironique, le poète leur adresse des
"dons • ridicules, burlesques.
carnaval,
burlesque, bien dans la tradition des
fêtes du Moyen Age.
Les allusions sarcastiques
sont parfois difficiles à saisir, mais l'ironie grima
çante de ces legs permet de compléter l'idée
qu'on peut se faire du poète.
C'est un artiste aux
visages multiples, changeants; sa sensibilité est
tour à tour fantaisiste, moqueuse ou bien écor
chée, tourmentée, insaisissable par sa diversité
et les doutes qui l'assaillent: «Rien ne m'est sûr
que la chose incertaine.>> Ce sont cette richesse
des accents, cette sincérité dans la confidence
personnelle qui rendent touchante, par-delà les
siècles qui nous séparent d'elle, la voix singuliè
re et universe lle d'un poète profondément
humain jusque dans ses contradictions, ses
angoisses et ses mystères..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Ballade des Pendus, François Villon (1431 - après 1463)
- Deuxième axe du commentaire: François Villon, la Ballade des pendus, 1461
- TESTAMENT (Le) de François Villon : Fiche de lecture
- LAIS (le), de François Villon
- Testament (le), dit le Grand Testament par François Villon