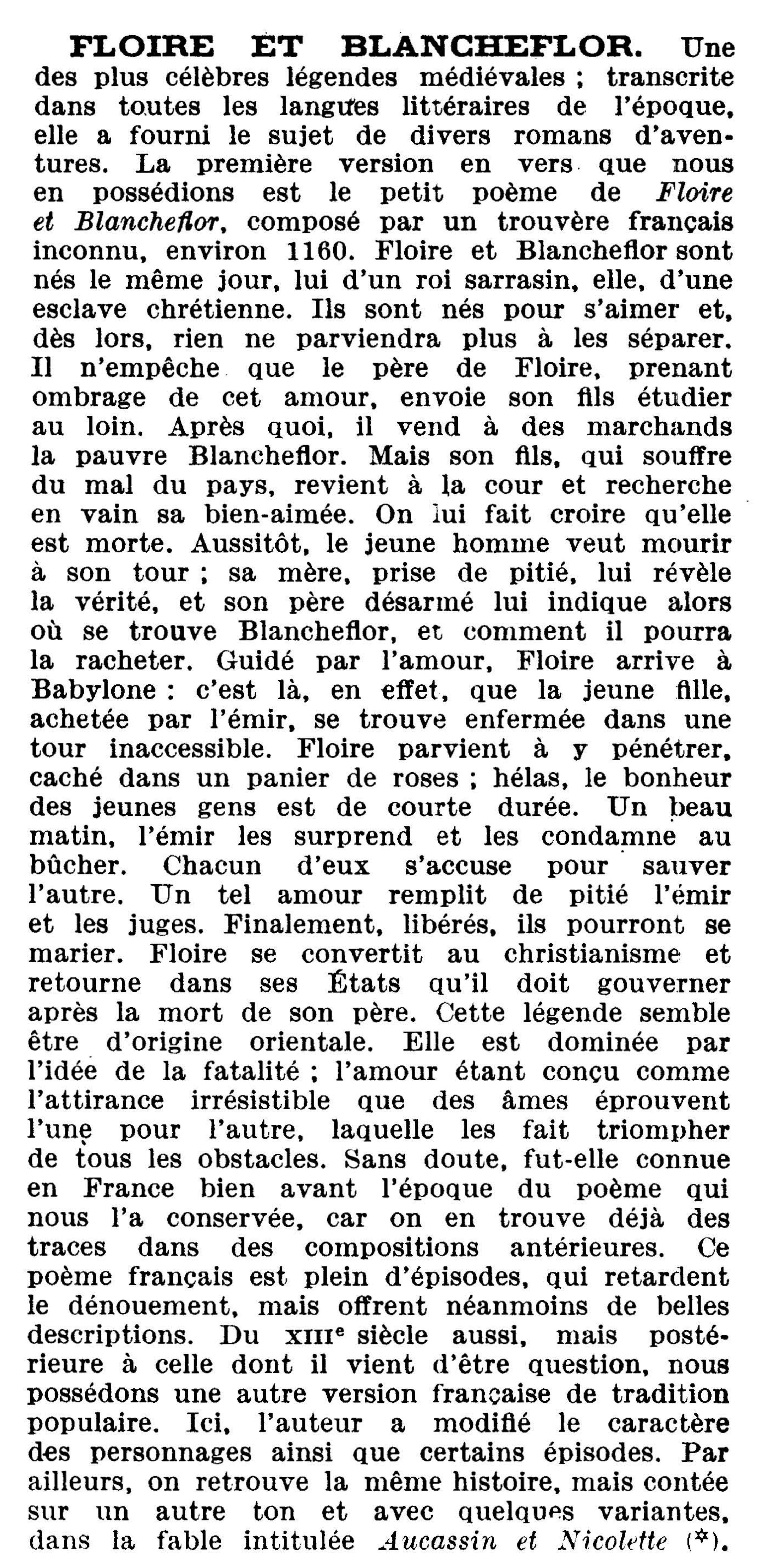FLOIRE ET BLANCHEFLOR
Publié le 06/12/2018
Extrait du document
«
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)'
FLOIRE ET BLANCHEFLOR.
Une
des plus célèbres légendes médiévales : transcrite
dans to.utes les langltes littéraires de l'époque.
elle a fourni le sujet de divers romans d'aven
tures.
La première version en vers .
que nous
en possédions est le petit poème de Floire
et BlanchetlOT, composé par un trouvère frar1cais
inconnu, environ 1160.
Floire et Blanchefl.or sont
nés le même jour, lui d'un roi sarrasin.
elle.
d'une
esclave chrétienne.
Ils sont nés pour s'aimer et.
dès lors, rien ne parviendra plus à les séparer.
Il n'empêche .
que le père de Floire.
prenant
ombrage de cet amour.
envoie son fils étudier
au loin.
Après quoi, il ve11d à des n1arch~tnds
la pauvre Blanchefl.or.
Mais son fils.
qui so111fre
du mal du pays, revient à la cour et recherche
en vain sa bien-aimée.
On lui fait croire qu'elle
est morte.
Aussitôt, le jeune homme veut mc•urir
à son tour : sa mère, prise de pitié, lui révèle
la vérité, et son père désartné lui indique alors
où se trouve Blanche fior, et con1n1ent il po ·urra
la racheter.
Guidé par l'amour, Floire arrive à
Babylone : c'est là.
en effet, que la jeune :fille,
achetée par l'émir, se trouve enfermée dans une
tour inaccessible.
Floire parvient à y pénétrer.
caché dans un panier de roses ; hélas, le bonheur
des jeunes gens est de courte durée.
Un l>eau
•
matin, l'émir les surprend et les condamne au
•
bûcher.
Chacun d'eux s'accuse pour saliver
l'autre.
Un tel amour remplit de pitié l'émir
et les juges.
Finalement, libérés.
ils pourront se
marier.
Floire se convertit au christianisme et
retourne dans ses États qu'il doit gouverner
après la mort de son père.
Cette légende semble
être d'origine orientale.
Elle est dominée par
l'idée de la fatalité ; l'amour étant concu comme
l'attirance irrésistible que des âmes éprouvent
l'une pour l'autre, laquelle les fait triomi>her
'
de tous les obstacles.
Sans doute, fut-elle connue
en France bien avant l'époque du poème qui
nous l'a conservée, car on en trouve déjà des
traces dans des compositions antérieures.
Ce
poème francais est plein d'épisodes, qui retarclent
le dénouement, n1ais offrent néanmoins de belles
descriptions.
Du XIIIe siècle aussi, mais posté
rieure à celle dont il vient d'être question, nous
possédons une autre version francaise de tradition
populaire.
Ici.
l'auteur a modifié le caractère
d-es personnages ainsi que certains épisodes.
Par
ailleurs, on retrouve la n1ên1e histoire, mais C011tée
Stlr tin autre ton et avec QlielquP.s variantes.
(}ans la fable intitt1lée ...
4.ucassi-n et .lvicolette (*)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FLOIRE et BLANCHEFLOR
- FLOIRE ET BLANCHEFLOR.
- L'indifférenciation sexuelle dans le Conte de Floire et Blanchefleur