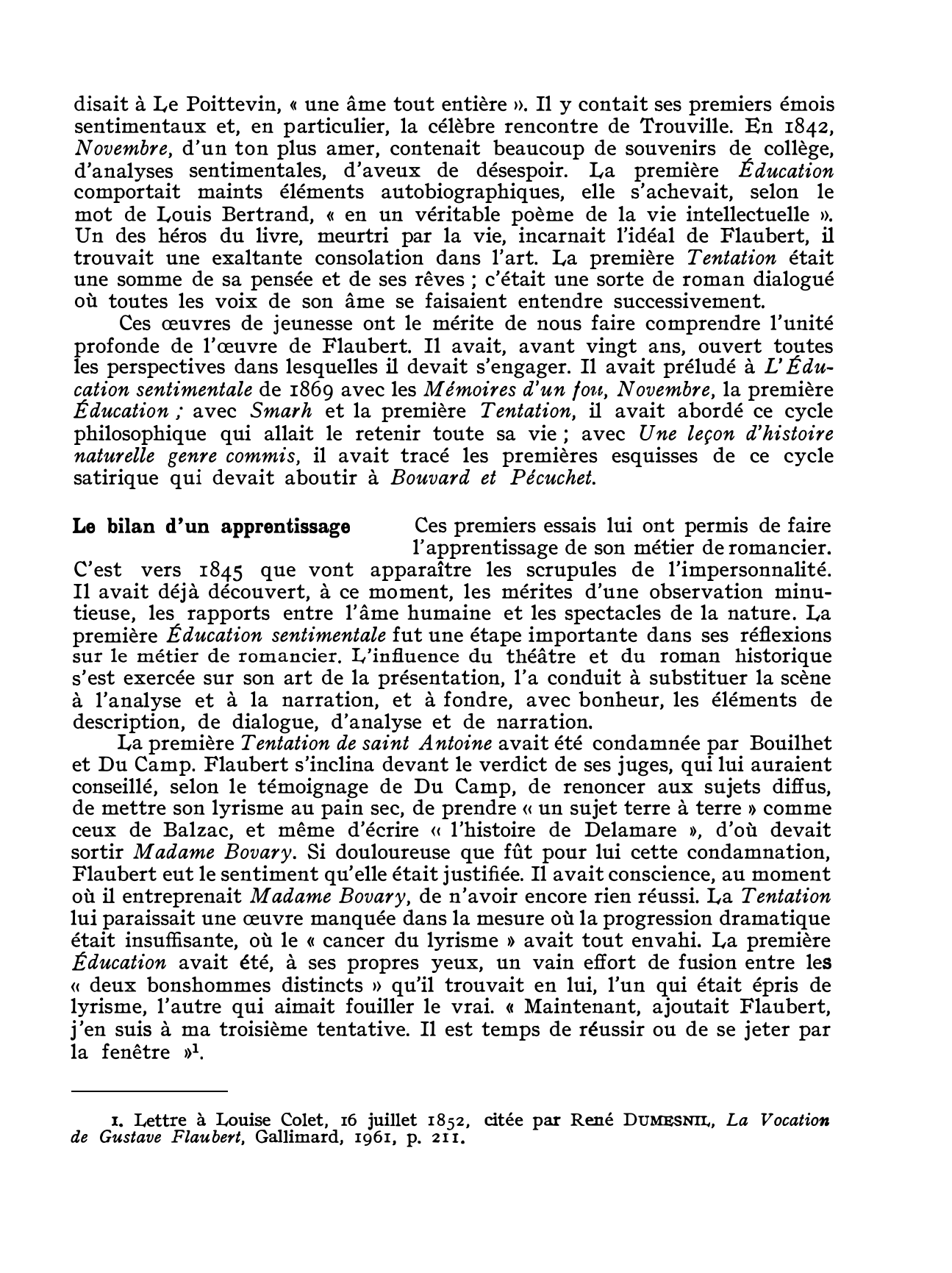Flaubert ou l’envers du romanesque
Publié le 14/01/2018
Extrait du document

LA DOCTRINE DE FLAUBERT
L'élaboration de Madame Bovary dura près de cinq ans, de septembre 1851 à mai 1856. Pendant cette longue et minutieuse construction le rythme du travail de Flaubert n'est plus du tout ce qu'il était encore dans La Tentation de saint Antoine. « L'homme qui se précipitait, observe M. J. Durry1, s'est transformé en celui qui tâche et qui ahane, malgré des flambées d'enthousiasme et d'inspiration. >> Effet des drogues qu'on lui fait absorber depuis qu'il est atteint de sa maladie nerveuse ? Conséquence des exigences minutieuses de Bouilhet, qui fait figure de Boileau impitoyable ? On a pu s'imaginer aussi que Madame Bovary était un pensum auquel Flaubert avait été condamné par ses amis, et dont il ne s'était acquitté qu'avec une sorte de répugnance, dans la mesure où << sujet, personnages, tout était hors de lui >>. Madame Bovary n'était pas seulement une victoire de la volonté sur le tempérament, mais « le résultat des réflexions d'un artiste sur la nature et les conditions de son art >>2 << Je tourne beaucoup à la critique, notait Flaubert ; le roman que j'écris m'aiguise cette faculté, car c'est une œuvre surtout de critique ou plutôt d'anatomie >>3- Flaubert rompait avec le lyrisme romantique ; il se défiait de « cette espèce d'échauffement que l'on appelle l'inspiration >>, de ces << bals masqués de l'imagination >> où l'on n'a << vu que du faux et débité que des sottises >>*•
Le roman, << Tout se passe, écrit Thibaudet, comme
œuvre d’objectivité scientifique si, en ces années cinquante, décisives
pour l'histoire du roman, se développait de Balzac à Flaubert une logique intérieure au roman, comme, de Corneille à Racine, se développe une logique intérieure à la tragédie Madame Bovary devait demeurer, pour de longues années, le modèle du roman français. Balzac était le père du roman moderne ; Flaubert, lui, aménageait l'héritage. Il apportait un grand souci de la vérité minutieuse. Balzac appartenait à la génération des grands imaginatifs, il avait créé La Comédie humaine dans une sorte de fièvre. A ses emportements succédait la méthode de Flaubert. C'était une méthode scientifique. Flaubert était fils de médecin ; il appartenait à un temps pendant lequel se développait la philosophie positive. Avant Taine, Flaubert souhaitait voir la littérature s'inspirer des principes des sciences naturelles et de la biologie. En 1857, Madame Bovary était au roman ce que l'Introduction à l’étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, en 1864, était à la science. Sainte-Beuve ne s'y était pas trompé, lui qui s'était écrié, au lendemain de la parution de Madame Bovary : « Anatomistes et physiologistes, je vous retrouve partout >>. Flaubert avait écrit, dès 1853, dans sa correspondance : « La littérature prendra de
«MADAME BOVARY »
L’envers du romanesque La publication de Madame Bovary, en 1857,
reste une date capitale dans l'histoire du roman français. Depuis la disparition de Balzac, comme l'observait Baudelaire, « toute curiosité relativement au roman s'était apaisée ou endormie >>. L'œuvre frappait les esprits par la dureté de l'analyse, la vérité de la description, le caractère impitoyable d'une sorte de dissection morale. Flaubert était aux antipodes du réalisme de l'école, mais son livre est demeuré, pour les générations suivantes, comme la Bible du roman réaliste. Il apportait plus de scrupule que Balzac dans le culte de la vérité, il débarrassait le roman des scories qui l'avaient encombré, il s'écartait de ce qu'il y avait de romanesque dans les situations et les personnages de Balzac. Les << malices du plan >> et les « combinaisons d'effets » ne lui servaient qu'à atteindre le naturel. Il s'était inspiré d'anecdotes empruntées à la chronique provinciale ; il avait choisi la donnée la plus triviale qui fût : l'adultère. Il présentait son héroïne à travers les événements quotidiens d'une vie platement bourgeoise. Un bourg de province était le décor de cette comédie de la bêtise humaine. Une noce normande, des comices agricoles, l’adultère hebdomadaire dans un hôtel de la ville voisine, les dégoûts, les soupirs et les quelques << pâmoisons fébriles >> d'une « pauvre petite provinciale >>2, telles étaient les données que s'était proposées Flaubert. C'était l'envers du romanesque. Quand l'héroïne de M. de Camors3 se lançait, au galop de sa monture, du haut d'une falaise abrupte, Emma chipait prosaïquement un peu d'arsenic au pharmacien d'en face. Les héros de Balzac avaient, pour la plupart, des existences mouvementées. Il y avait, dans leur échec même, quelque chose de retentissant. Flaubert appartenait à un temps où l'on était devenu plus sensible à la navrante monotonie des existences manquées. Madame Bovary était le roman de la fatalité, le roman des vies médiocres qui se laissent ballotter par les circonstances. La roublardise de Lheureux et le triomphe d'Homais venaient en contrepoint souligner la lente défaite de Charles et d'Emma. Le monde de Balzac était fantasmagorique, animé comme un rêve, mouvementé comme un cauchemar ; l'imagination arrangeait la vie, la faisait plus belle ou plus atroce qu'elle n'est dans la réalité. Flaubert s'acharnait, en revanche, à présenter des existences dénuées de relief. Les rêves d'Emma venaient accuser la monotonie de sa vie, ils n'étaient qu'une dérision du romanesque.
On donnerait de nombreux exemples de cette transfiguration du réel par la vision d'Emma. A la Vaubyessard, elle est sensible aux << fulgurations de l'heure présente. » Quand le prêtre lui donne la communion, pendant la maladie qui l'a terrassée, « les rideaux de son alcôve se gonflaient mollement, autour d'elle, en façon de nuées, et les rayons des deux cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes. Alors, elle laissa retomber sa tête, croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques et apercevoir, en un ciel d'azur, sur un trône d'or ( ...) Dieu le Père tout éclatant de majesté, et qui, d'un signe, faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flamme pour l'emporter dans leurs bras ». Cela est resté, dans sa mémoire, comme une « vision splendide », La description de Rouen est déjà stylisée en un tableau, avec ce mouvement d'ensemble du paysage qui remonte jusqu'à la << base indécise du ciel pâle », avec ces << îles » qui semblaient << de grands poissons noirs arrêtés » ; mais, pour cette femme adultère, la vieille cité normande << s'étalait ( ... ) comme une capitale démesurée, comme une Babylone où elle entrait ». Dans la cathédrale où il lui a donné rendez-vous, Léon a la vision sacrilège d'un immense boudoir. Il y avait chez Flaubert une déformation visionnaire du réel, qui s'alliait avec les minuties d'une stricte observation. La description reflétait l'état d'âme du personnage. Le monde qu'elle avait sous les yeux, Emma le colorait de ses émotions. Le réalisme de Flaubert était déjà un réalisme subjectif ; en tout cas, un réalisme suggestif.
La part du rêve Certaines minutes intenses parviennent
à auréoler la réalité d'un nimbe de clarté magique. Mais les ViSions les plus splendides sont celles que proposent les rêves. Flaubert leur a fait la part belle dans ce roman de l'humble réalité. Il est vrai que le conflit du réel et du rêve était le sujet profond de son livre. On a défini le bovarysme comme le besoin de se concevoir autre qu'on est. C'est dans l'évocation de ces rêves que Flaubert a déversé avec profusion ses hautes facultés de lyrisme et d'ironie. La rêverie d'Emma venait parfois prolonger, comme en pointillé, une amorce de bonheur que la vie avait présentée ; elle permettait de savourer telle scène qu'elle revoyait en imagination << avec cet allongement de perspective que le souvenir donne aux objets », Le plus souvent, les rêveries avaient une valeur compensatoire ; au lendemain de son mariage, Emma songeait à une idéale lune de miel. Dans la chambre conjugale, elle rêvait de départs, de pays lointains, de cathédrales de marbre rose, elle évoquait le parfum des citronniers et la douceur des golfes au bord de la mer. Dans sa vie étriquée, la rêverie perçait une issue. Flaubert recourait à un style indirect libre : l'imparfait donnait accès au contenu d'une conscience. Le monologue intérieur, chez Stendhal, avait souvent la vertu d'une délibération intime ; il était le moment de la lucidité et de la décision. Chez Flaubert, il épousait la durée d'une rêverie, il était la substance même d'une conscience qui cherche à combler, par les séductions de l'imaginaire, les insuffisances du réel. La part du rêve renvoyait à un tragique de l'absence, à un pathétique de l'inaccompli.

«
disait
à Le Poittevin, >.
Il y contait ses premiers émois
sentimentaux et, en particulier, la célèbre rencontre de Trouvil le.
En 1842,
Novembre, d'un ton plus amer, contenait beaucoup de souvenirs de collège,
d'ana lyses sentimentales, d'aveux de désespoir.
La première Éducation
com portait maints éléments autobiographiques, elle s'achevait, selon le
mot de Louis Bertrand, « en un véritable poème de la vie intellectuelle >>.
Un des héros du livre, meurtri par la vie, incarnait l'idéal de Flaubert, il
trouvait une exaltante consolation dans l'art.
La première Tentation était
une somme de sa pensée et de ses rêves ; c'était une sorte de roman dialogué
où toutes les voix de son âme se faisaient entendre successivement.
Ces œuvres de jeunesse ont le mérite de nous faire comprendre l'unité
profonde de l'œuvre de Flaubert.
Il avait, avant vingt ans, ouvert toutes
les perspectives dans lesquelles il devait s'engager.
Il avait préludé à L' Édu
cation sentimentale de r869 avec les Mémoires d'un fou,, Novembre, la première
É ducati on; avec Smarh et la première Tentation, il avait abordé ce cycle
philosophique qui allait le retenir toute sa vie ; avec Une leçon d'histoire
naturelle genre commis, il avait tracé les premières esquisses de ce cycle
satirique qui devait aboutir à Bouvard et Pécuchet.
Le bilan d'un apprentissage Ces
premiers essais lui ont permis de faire
l' apprentissage de son métier de romancier.
C' est vers r845 que vont apparaître les scrupules de l'impersonna lité.
Il avait déjà découvert, à ce moment, les mérites d'une observation minu
tieu se, les rapp orts entre l'âme humaine et les spectacles de la natu re.
La
première Éducation sentimentale fut une étape importante dans ses réflexions
sur le mét ier de romanc ier.
L'i n fluence du théâtre et du roman historique
s' est exercée sur son art de la présentation, l'a conduit à substituer la scène
à l'ana lyse et à la narration, et à fondre, avec bonheur, les éléments de
descript ion, de dialogue, d'analyse et de narration.
La première Tentation de saint Antoine avait été condamnée par Bouilhet
et Du Camp.
Flaubert s'inclina devant le verdict de ses juges, qui lui auraient
conseill é, selon le tém oignage de Du Camp, de renoncer aux sujets diffus,
de mettre son lyrisme au pain sec, de prendre > comme
ceux de Balzac, et même d'écrire avait tout envahi.
La première
É ducation avait été, à ses propres yeux, un vain effort de fusi on entre les
> qu'il trouvait en lui, l'un qui était épris de
lyris me, l'autre qui aimait fouiller le vrai..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame Bovary de Flaubert: Un nouvel art romanesque
- Madame Bovary de Gustave Flaubert : Une structure romanesque de la déception et de la monotonie
- FLAUBERT - Madame Bovary (I, 6) UNE JEUNE FILLE ROMANESQUE
- Dans leur correspondance, Flaubert et George Sand ont discuté sur le roman. Flaubert affirmait que le roman devait être rigoureusement objectif et impersonnel, que rien ne devait y trahir les opinions et sentiments de l'auteur. George Sand répliquait qu'un pareil roman lui paraissait froid et vain et qu'elle ne pouvait écrire que ce qu'elle sentait. Que préférez-vous du roman d'observation objective ou du roman plus ou moins romanesque ou l'auteur veut nous suggérer ses propres émotion
- Flaubert - Un coeur simple