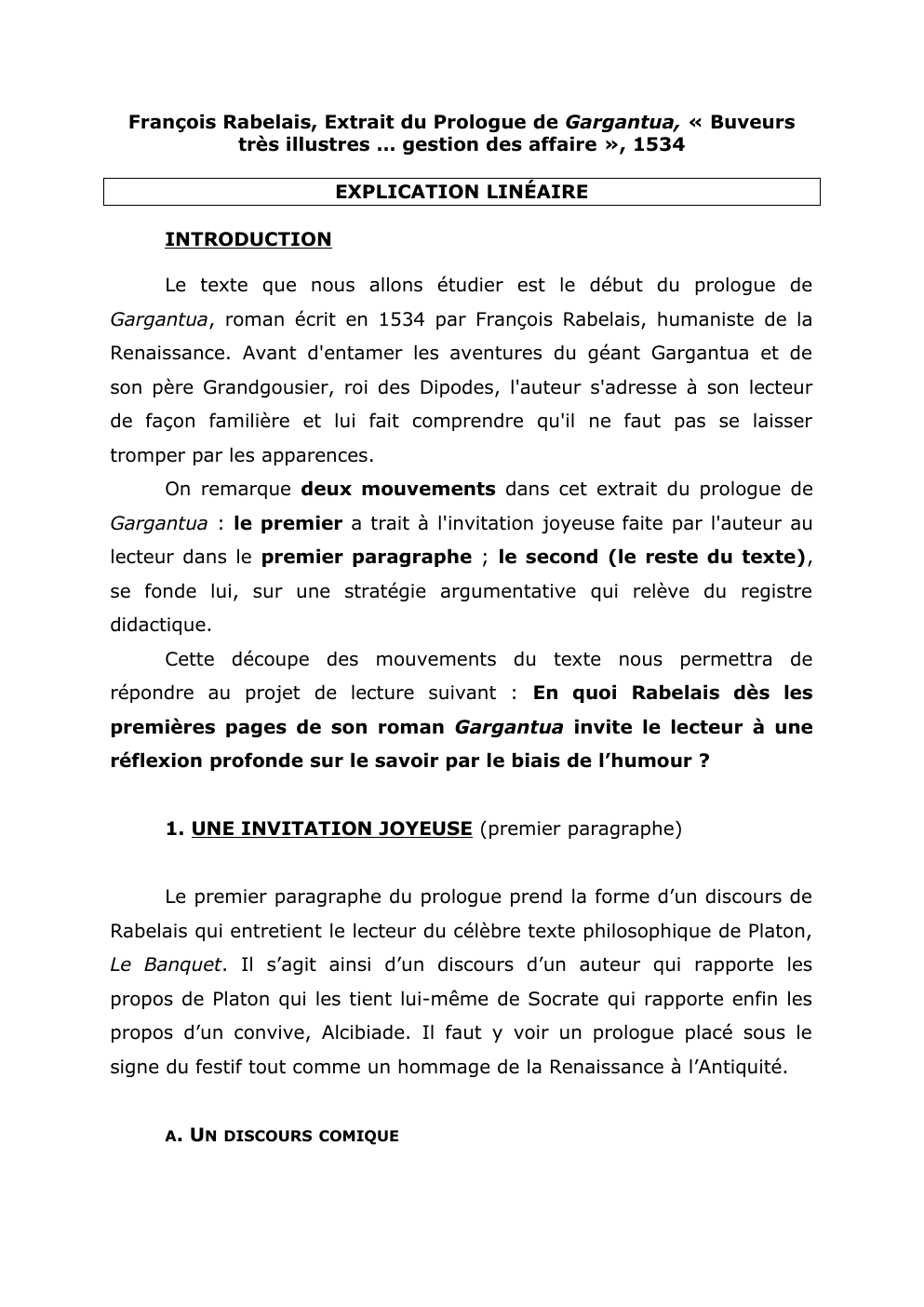Explication linéaire "Prologue, Gargantua, Rabelais
Publié le 08/02/2023
Extrait du document
«
François Rabelais, Extrait du Prologue de Gargantua, « Buveurs
très illustres … gestion des affaire », 1534
EXPLICATION LINÉAIRE
INTRODUCTION
Le texte que nous allons étudier est le début du prologue de
Gargantua, roman écrit en 1534 par François Rabelais, humaniste de la
Renaissance.
Avant d'entamer les aventures du géant Gargantua et de
son père Grandgousier, roi des Dipodes, l'auteur s'adresse à son lecteur
de façon familière et lui fait comprendre qu'il ne faut pas se laisser
tromper par les apparences.
On remarque deux mouvements dans cet extrait du prologue de
Gargantua : le premier a trait à l'invitation joyeuse faite par l'auteur au
lecteur dans le premier paragraphe ; le second (le reste du texte),
se fonde lui, sur une stratégie argumentative qui relève du registre
didactique.
Cette découpe des mouvements du texte nous permettra de
répondre au projet de lecture suivant : En quoi Rabelais dès les
premières pages de son roman Gargantua invite le lecteur à une
réflexion profonde sur le savoir par le biais de l’humour ?
1.
UNE INVITATION JOYEUSE (premier paragraphe)
Le premier paragraphe du prologue prend la forme d’un discours de
Rabelais qui entretient le lecteur du célèbre texte philosophique de Platon,
Le Banquet.
Il s’agit ainsi d’un discours d’un auteur qui rapporte les
propos de Platon qui les tient lui-même de Socrate qui rapporte enfin les
propos d’un convive, Alcibiade.
Il faut y voir un prologue placé sous le
signe du festif tout comme un hommage de la Renaissance à l’Antiquité.
A.
UN
DISCOURS COMIQUE
Ce discours est placé sous les auspices de la fête avec le banquet, la
boisson, la moquerie.
Le discoureur se veut aussi un joyeux convive avec
ses interpellations familières et l’opposition entre vous/je.
Ce n’est pas à
des purs esprits qu’il s’adresse, mais à des humains, vus comme des
jouisseurs de la vie, aimant rire et se divertir (« buveurs très illustres » et
ayant une sexualité avec « vérolés très précieux » c’est-à-dire la syphilis
(maladie à la fois contagieuse et incurable très courante au XVIe siècle).
L’auteur forme ainsi deux oxymores produisant un effet comique.
Le
premier registre se veut aussi comique par le biais de fourmillement de
détails par des adjectifs qualificatifs épithètes hyperboliques.
La longueur des propositions faites d’incises « non aux autres », de
subordonnées « que sont dédiés mes écrits » donne l’apparence d’un
discours non préparé, spontané comme à un banquet où l’on porterait un
toast.
La rhétorique de Rabelais semble aussi laborieuse avec les
nombreuses références données « comme le dit », de jugements
subjectifs « prince des philosophes ».
Cela donne une fausse impression
de lourdeur et d’impréparation comme on le verra par la suite.
B.
UNE
RÉFÉRENCE À L’ANTIQUITÉ
Les propos a priori sans logique partent d’une digression portant sur
une simple boîte avec un couvercle.
Il s’agit en réalité d’une savante
métaphore filée, menant à une véritable démonstration qui part d’un objet
créé par l’homme pour aboutir à un éloge de Socrate.
Rabelais s’appuie
sur un matérialisme prosaïque, une boîte de pharmacie, pour aboutir à
une leçon philosophique tirée de l’Antiquité.
Sur le premier point, on découvre le champ lexical de la médecine
(que pratiquait l’auteur) : « apothicaire » « drogues » « baume » "vérolés
".
Cela revient à dire que le discours peut soigner, c'est-à-dire éduquer
l’homme.
Dans le cadre de sa démonstration joyeuse, Rabelais offre de
nombreuses énumérations donnant un rythme plein de vie et de légèreté
à son discours.
S'agissant de cette vitalité, il recourt à un bestiaire faisant
naître une opposition entre des animaux mythologiques et des animaux
réels amoindris ou recréés.
Le bestiaire est étiré pour faire apparaître le
parallèle incongru entre Socrate et un taureau.
La description physique et
sociale de Socrate se veut aussi comique par son côté exagérément
péjoratif : « fou » « inapte ».
C.
UN
SAVOIR HUMANISTE
On entre ainsi dans un registre moins léger et plus didactique : le
champ lexical du savoir est en effet omniprésent avec « divin savoir », «
écrits », « précepteur ».
On a vu que ce passage adopte un ton qui est en
apparence badin à l’image du sens de la vue, sens trompeur ainsi
convoqué.
On assiste ainsi à une rupture du propos quittant le superficiel avec
la conjonction de coordination « mais » pour conduire à un sujet plus
profond avec le sens du toucher « ouvrant ».
C’est alors que l’opposition
entre l’extérieur et l’intérieur de la boite/philosophe prend tout son sens :
Socrate devient alors l’archétype du sage qui s’oppose par son activité de
la
pensée
traduite
par
des
adjectifs
ou
locutions
laudatives
et
hyperboliques « merveilleuse, invincible, sans pareille, parfait, certain… »
aux hommes perdus dans leurs activités mercantiles et désordonnées «
perdent le sommeil, courent, travaillent, naviguent et bataillent tant.
»
C’est l’occasion pour Rabelais d’user de la rhétorique des contrastes
entre jadis/présent, le corps/âme et Socrate/ les hommes.
Il s’appuie en
outre sur des énumérations, des hyperboles par le truchement de
comparatifs et de superlatifs.
Mais la principale opposition qui sous-tend le
texte, c’est celle du rire face au sérieux.
La rhétorique s’appuie également sur l’usage de différents temps, le
présent de l’interpellation « je dédie » mais aussi de la vérité générale «
veillent, travaillent….
».
L’humanisme de Rabelais convoque les textes de
l’Antiquité dont il fait deux expresses références avec force détails : il a
besoin pour ce faire de recourir à l’imparfait et au plus-que-parfait.
Mais
ce n’est pas pour laisser le lecteur en dehors du propos : il l’interpelle
directement en recourant au mode conditionnel « vous n’en auriez pas
donné ».
Ce premier paragraphe exposé s’éloigne donc en apparence
de l’idée que l’on se fait d’un avant-propos, ainsi que le rappelle
Rabelais dans le deuxième paragraphe.
2.
UNE STRATÉGIE ARGUMENTATIVE (le reste de l’extrait)
Rabelais cherche dans les prochains paragraphes à tirer un
enseignement de ce qu’il vient d’énoncer.
On entre dans un autre registre,
celui didactique, mais qui est toujours savamment lié au registre comique.
A.
UNE
CONNIVENCE AVEC LE LECTEUR
Pour ce faire, il pose une question formelle « à quoi », il nous aide à
chercher le but du discours développé dans le premier paragraphe.
D’ailleurs ce qui précède est vu comme un « prélude » du prologue, à
savoir étymologiquement un avant/jeu, un moment avant le jeu.
On reste
toujours dans le champ lexical du divertissement.
A ce mot, il oppose le «
coup d’essai » : on entre maintenant dans le cadre d’une démonstration à
visée proprement argumentative.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Intro : Nous allons étudier le prologue de Gargantua,l’œuvre de Rabelais.
- Le lecteur que Rabelais souhaite pour son œuvre, dans le Prologue de Gargantua, devra être capable, au cours d’une lecture attentive et approfondie, de «rompre l’os et sucer la substantifique moelle» pour profiter de la vraie richesse de l’ouvrage.
- GARGANTUA – RABELAIS (1535) Situation du passage : Prologue
- RABELAIS: GARGANTUA : Dizain " Aux lecteurs " et prologue (lecture analytique)
- Prologue Gargantua (Rabelais)