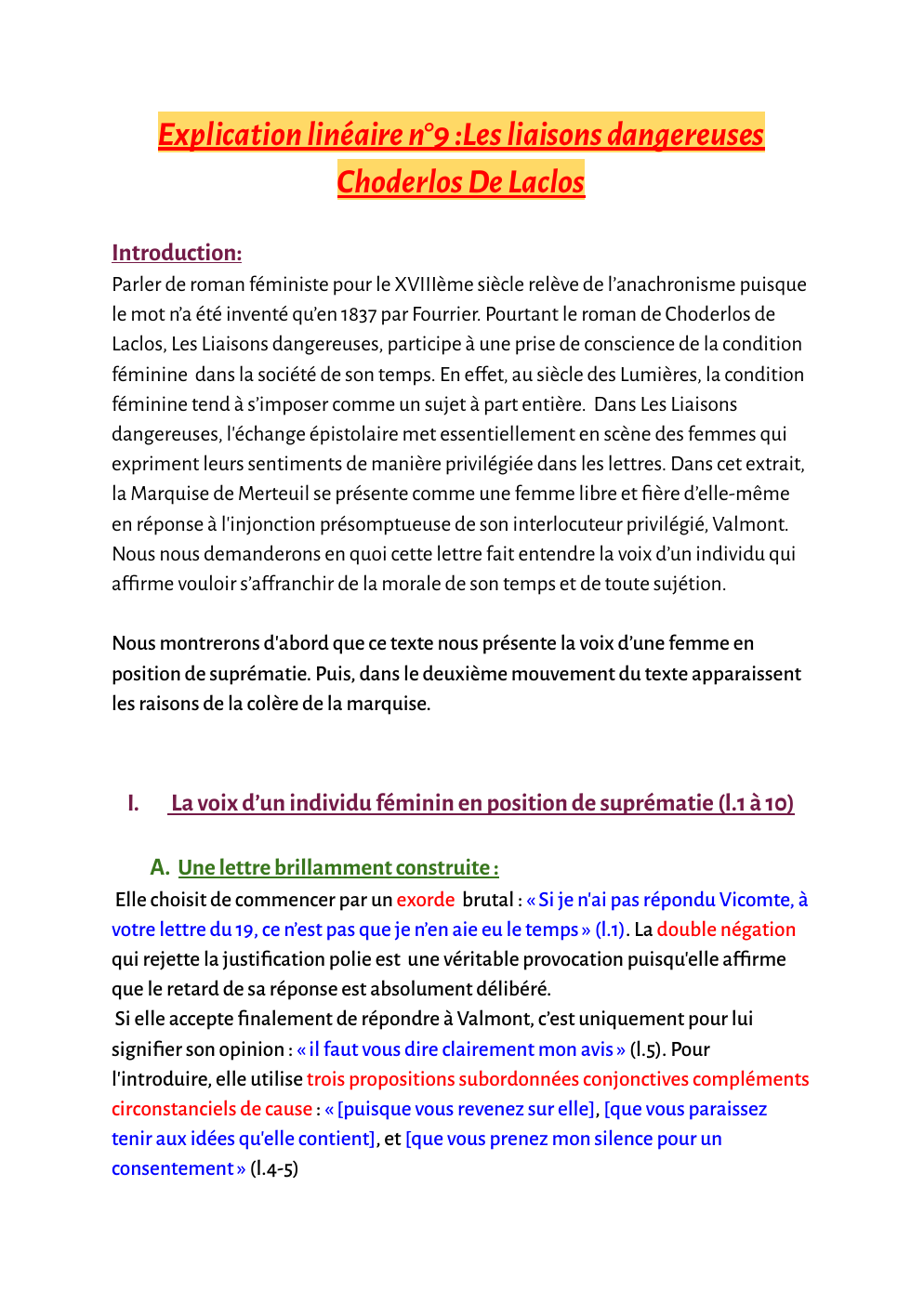Explication linéaire n°9 :Les liaisons dangereuses Choderlos De Laclos
Publié le 07/02/2023
Extrait du document
«
Explication linéaire n°9 :Les liaisons dangereuses
Choderlos De Laclos
Introduction:
Parler de roman féministe pour le XVIIIème siècle relève de l’anachronisme puisque
le mot n’a été inventé qu’en 1837 par Fourrier.
Pourtant le roman de Choderlos de
Laclos, Les Liaisons dangereuses, participe à une prise de conscience de la condition
féminine dans la société de son temps.
En effet, au siècle des Lumières, la condition
féminine tend à s’imposer comme un sujet à part entière.
Dans Les Liaisons
dangereuses, l'échange épistolaire met essentiellement en scène des femmes qui
expriment leurs sentiments de manière privilégiée dans les lettres.
Dans cet extrait,
la Marquise de Merteuil se présente comme une femme libre et fière d’elle-même
en réponse à l'injonction présomptueuse de son interlocuteur privilégié, Valmont.
Nous nous demanderons en quoi cette lettre fait entendre la voix d’un individu qui
affirme vouloir s’affranchir de la morale de son temps et de toute sujétion.
Nous montrerons d'abord que ce texte nous présente la voix d’une femme en
position de suprématie.
Puis, dans le deuxième mouvement du texte apparaissent
les raisons de la colère de la marquise.
I.
La voix d’un individu féminin en position de suprématie (l.1 à 10)
A.
Une lettre brillamment construite :
Elle choisit de commencer par un exorde brutal : « Si je n'ai pas répondu Vicomte, à
votre lettre du 19, ce n’est pas que je n’en aie eu le temps » (l.1).
La double négation
qui rejette la justification polie est une véritable provocation puisqu'elle affirme
que le retard de sa réponse est absolument délibéré.
Si elle accepte finalement de répondre à Valmont, c’est uniquement pour lui
signifier son opinion : « il faut vous dire clairement mon avis » (l.5).
Pour
l'introduire, elle utilise trois propositions subordonnées conjonctives compléments
circonstanciels de cause : « [puisque vous revenez sur elle], [que vous paraissez
tenir aux idées qu'elle contient], et [que vous prenez mon silence pour un
consentement » (l.4-5)
B.
Mme de Merteuil, une femme d’exception (l.6-7)
Contrairement aux schémas de l’époque postulant l’infériorité de la femme dans
tous les domaines, Mme de Merteuil affrme sa supériorité sur Valmont, même
dans le jeu libertin.
Elle écrit avec humour avoir eu « la prétention de remplacer à [elle] seule tout un
sérail; mais » (l.6) refuser d'« en faire partie » (l.7).
La conjonction de coordination
marque bien l’opposition.
Dans cette métaphore du « sérail », elle inverse l'image de la soumission au bon
plaisir masculin en se mettant en position sujet « j'ai pu avoir quelquefois la
prétention ».
Elle invite ainsi Valmont à reconnaître sa singularité en refusant par
une allusion à ses multiples conquêtes d'être réduite à n'être qu'un femme parmi
d'autres.
C.
Le rappel d’une connivence passée, désormais révolue (l.7-10)
Elle rappelle qu’ils étaient complices : « Je croyais que vous saviez cela » (l.7).
L’imparfait renvoie à un passé commun qu'elle met en opposition avec le présent
d’énonciation : « Au moins, à présent, que vous ne pouvez plus l’ignorer » (l.7-8).
L'antithèse entre « savoir » et « ignorer » est mise en valeur par la construction en
parallélisme qui rappelle leur connivence passée, désormais révolue.
Puis, elle enchaîne sur deux questions rhétoriques pour souligner le caractère
choquant des prétentions de Valmont : « qui, moi ! […] pour m’occuper de vous ? »
(l.8-9), « Et pour m'en m’en occuper comment ? » (l.9-10).
Elle emploie la
métonymie, « un goût » pour désigner son jeune amant actuel, Danceny, afin de
souligner que son choix est délibéré et qu'il lui convient davantage.
La répétition
du groupe nominal, renchéri par l'adjectif « nouveau », rabaisse Valmont au....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- explication linéaire lettre 81 dans les liaisons dangereuses de CHODERLOS DE LECLOS
- Texte 4 : Les Liaisons dangereuses (1782), Choderlos de Laclos (1741- 1803) - Lettre 81
- Lettre 81 - Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos,1782
- Fiche de lecture sur les liaisons dangereuses, de Choderlos de Laclos, 1782
- Les Liaisons dangereuses 1782 ou Lettres recueillies dans une société et publiées pour l’instruction de quelques autres Pierre Choderlos de Laclos