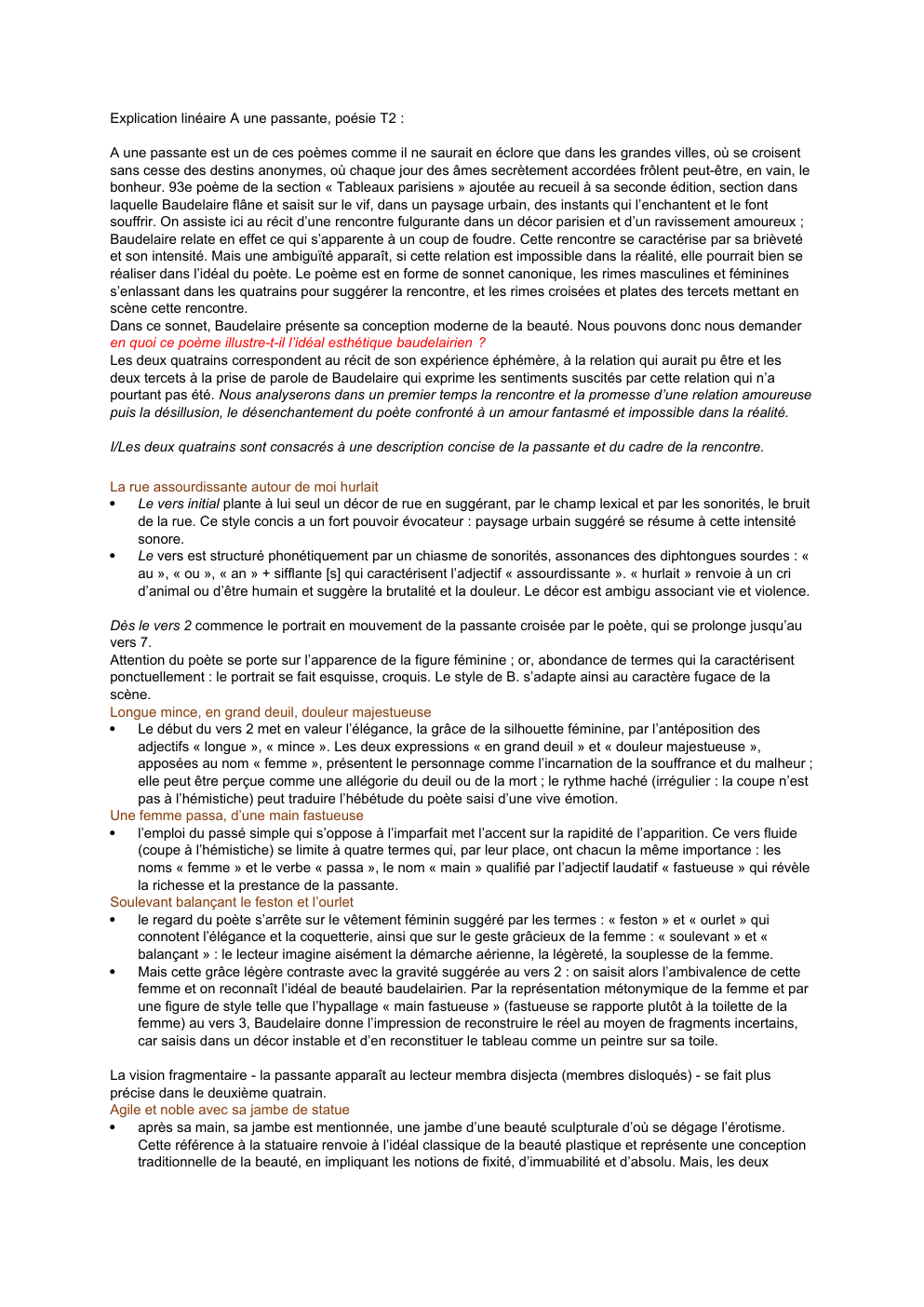explication linéaire A une Passante, Baudelaire
Publié le 03/01/2023
Extrait du document
«
Explication linéaire A une passante, poésie T2 :
A une passante est un de ces poèmes comme il ne saurait en éclore que dans les grandes villes, où se croisent
sans cesse des destins anonymes, où chaque jour des âmes secrètement accordées frôlent peut-être, en vain, le
bonheur.
93e poème de la section « Tableaux parisiens » ajoutée au recueil à sa seconde édition, section dans
laquelle Baudelaire flâne et saisit sur le vif, dans un paysage urbain, des instants qui l’enchantent et le font
souffrir.
On assiste ici au récit d’une rencontre fulgurante dans un décor parisien et d’un ravissement amoureux ;
Baudelaire relate en effet ce qui s’apparente à un coup de foudre.
Cette rencontre se caractérise par sa brièveté
et son intensité.
Mais une ambiguïté apparaît, si cette relation est impossible dans la réalité, elle pourrait bien se
réaliser dans l’idéal du poète.
Le poème est en forme de sonnet canonique, les rimes masculines et féminines
s’enlassant dans les quatrains pour suggérer la rencontre, et les rimes croisées et plates des tercets mettant en
scène cette rencontre.
Dans ce sonnet, Baudelaire présente sa conception moderne de la beauté.
Nous pouvons donc nous demander
en quoi ce poème illustre-t-il l’idéal esthétique baudelairien ?
Les deux quatrains correspondent au récit de son expérience éphémère, à la relation qui aurait pu être et les
deux tercets à la prise de parole de Baudelaire qui exprime les sentiments suscités par cette relation qui n’a
pourtant pas été.
Nous analyserons dans un premier temps la rencontre et la promesse d’une relation amoureuse
puis la désillusion, le désenchantement du poète confronté à un amour fantasmé et impossible dans la réalité.
I/Les deux quatrains sont consacrés à une description concise de la passante et du cadre de la rencontre.
La rue assourdissante autour de moi hurlait
Le vers initial plante à lui seul un décor de rue en suggérant, par le champ lexical et par les sonorités, le bruit
de la rue.
Ce style concis a un fort pouvoir évocateur : paysage urbain suggéré se résume à cette intensité
sonore.
Le vers est structuré phonétiquement par un chiasme de sonorités, assonances des diphtongues sourdes : «
au », « ou », « an » + sifflante [s] qui caractérisent l’adjectif « assourdissante ».
« hurlait » renvoie à un cri
d’animal ou d’être humain et suggère la brutalité et la douleur.
Le décor est ambigu associant vie et violence.
Dès le vers 2 commence le portrait en mouvement de la passante croisée par le poète, qui se prolonge jusqu’au
vers 7.
Attention du poète se porte sur l’apparence de la figure féminine ; or, abondance de termes qui la caractérisent
ponctuellement : le portrait se fait esquisse, croquis.
Le style de B.
s’adapte ainsi au caractère fugace de la
scène.
Longue mince, en grand deuil, douleur majestueuse
Le début du vers 2 met en valeur l’élégance, la grâce de la silhouette féminine, par l’antéposition des
adjectifs « longue », « mince ».
Les deux expressions « en grand deuil » et « douleur majestueuse »,
apposées au nom « femme », présentent le personnage comme l’incarnation de la souffrance et du malheur ;
elle peut être perçue comme une allégorie du deuil ou de la mort ; le rythme haché (irrégulier : la coupe n’est
pas à l’hémistiche) peut traduire l’hébétude du poète saisi d’une vive émotion.
Une femme passa, d’une main fastueuse
l’emploi du passé simple qui s’oppose à l’imparfait met l’accent sur la rapidité de l’apparition.
Ce vers fluide
(coupe à l’hémistiche) se limite à quatre termes qui, par leur place, ont chacun la même importance : les
noms « femme » et le verbe « passa », le nom « main » qualifié par l’adjectif laudatif « fastueuse » qui révèle
la richesse et la prestance de la passante.
Soulevant balançant le feston et l’ourlet
le regard du poète s’arrête sur le vêtement féminin suggéré par les termes : « feston » et « ourlet » qui
connotent l’élégance et la coquetterie, ainsi que sur le geste grâcieux de la femme : « soulevant » et «
balançant » : le lecteur imagine aisément la démarche aérienne, la légèreté, la souplesse de la femme.
Mais cette grâce légère contraste avec la gravité suggérée au vers 2 : on saisit alors l’ambivalence de cette
femme et on reconnaît l’idéal de beauté baudelairien.
Par la représentation métonymique de la femme et par
une figure de style telle que l’hypallage « main fastueuse » (fastueuse se rapporte plutôt à la toilette de la
femme) au vers 3, Baudelaire donne l’impression de reconstruire le réel au moyen de fragments incertains,
car saisis dans un décor instable et d’en reconstituer le tableau comme un peintre sur sa toile.
La vision fragmentaire - la passante apparaît au lecteur membra disjecta (membres disloqués) - se fait plus
précise dans le deuxième quatrain.
Agile et noble avec sa jambe de statue
après sa main, sa jambe est mentionnée, une jambe d’une beauté sculpturale d’où se dégage l’érotisme.
Cette référence à la statuaire renvoie à l’idéal classique de la beauté plastique et représente une conception
traditionnelle de la beauté, en impliquant les notions de fixité, d’immuabilité et d’absolu.
Mais, les deux
adjectifs coordonnés : « agile et noble s’opposent : la beauté classique de la passante est ainsi associée à
sa modernité signifiée par l’idée d’agilité, qui connote la mobilité, l’éphémère, la fugacité.
Cette vision surnaturelle qui relève de l’adunaton (< grec : ce qui est impossible) puisque B.
voit une statue
bouger, traduit la quête poétique d’un idéal à travers la représentation d’une beauté enchanteresse, et rend
compte du processus d’écriture de l’objet poétique, fruit de son inspiration : une passante jette un charme au
poète qui fantasme à partir de la vision fugitive et conçoit son poème.
Moi je buvais crispé comme un extravaguant
souligne l’immobilité du poète subjugué, en extase, présente un nouveau contraste entre la vision fugitive et
le spectateur « buveur » qui s’enivre de cette vision ; il se peint ainsi immobile, « crispé », l’esprit absorbé,
divaguant ; en se comparant à « un extravagant » (du latin extra : en dehors de + vagari : errer), il indique en
effet son entrée dans une rêverie consciente et sa propre transformation une fois tombé....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- explication linéaire charogne baudelaire
- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire
- « L’Albatros » de Baudelaire, explication linéaire
- Analyse linéaire du sonnet: A une passante furtive de Charles Baudelaire