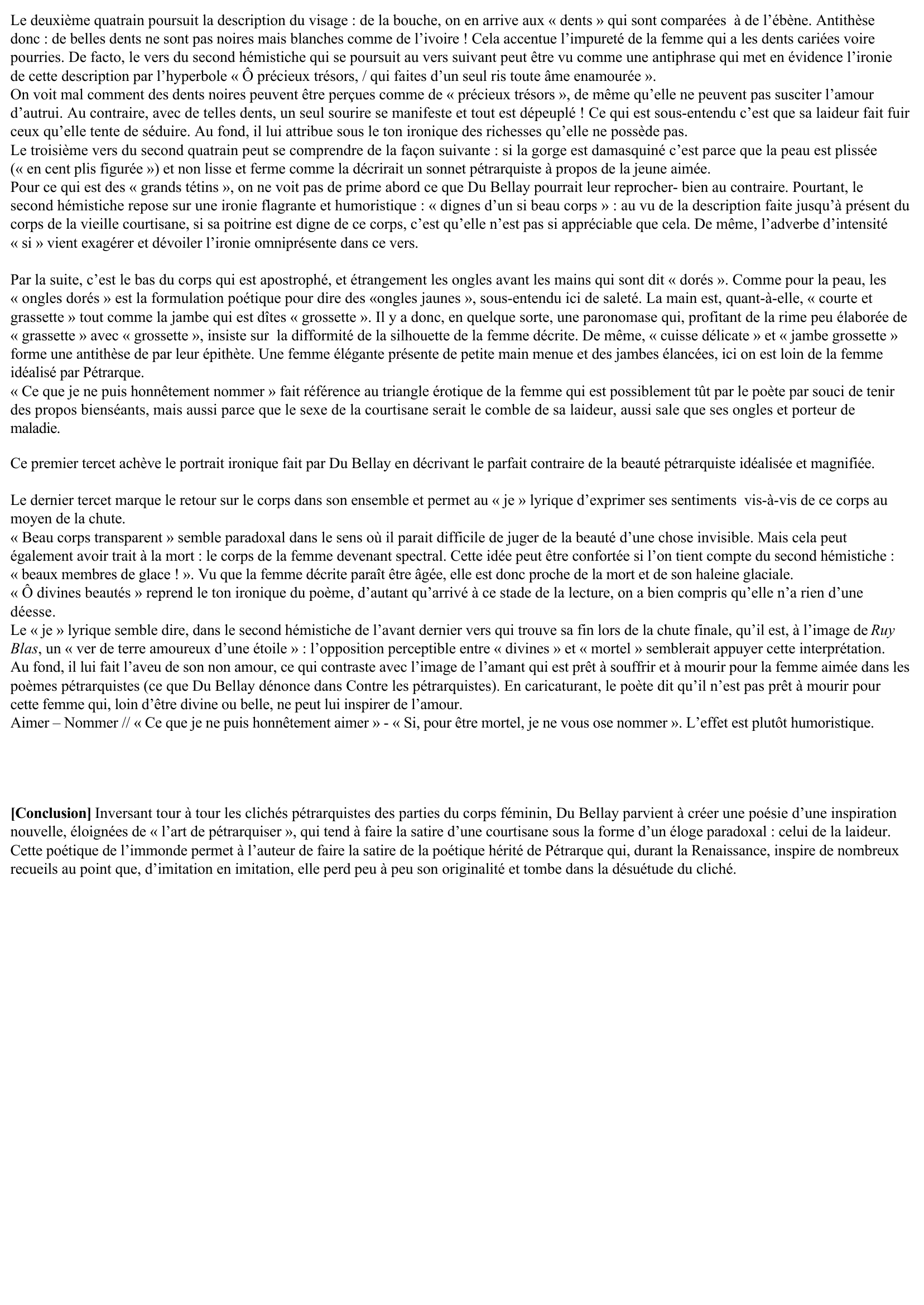Explication de texte : «Ô beaux cheveux d'argent » Les Regrets, 91
Publié le 21/02/2012
Extrait du document
Les regrets est un recueil de poèmes rédigés par Joachim Du Bellay entre 1553 et 1557 lors de sa résidence à Rome, le XVIe siècle étant alors marqué par le courant humaniste. Fondateur de la pléiade au coté de Ronsard, Du Bellay laisse transparaître dans ce recueil l’influence des poètes gréco-latins et italiens, dont Ovide et Pétrarque, tout en s’évertuant à créer une poésie d’inspiration nouvelle et plus personnelle. Les 191 sonnets, qui composent ce recueil, permettent à l’auteur d’exprimer sa nostalgie pour le pays natal ainsi que sa déception vis-à-vis d’une Rome bien différente de celle qu’il s’était imaginé à travers ses lectures. Pouvant être lu comme un « journal de voyage « (ou une compilation de « papiers journaux «), il permet également au poète en exil d’exprimer son dégout profond pour les mœurs romaines tout en faisant l’éloge de ses amis restés en France : ainsi ces poèmes, tour à tour élégiaques, satiriques et encomiastiques, suffisent à justifier l’originalité et la richesse de ce recueil. Le quatre-vingt-onzième sonnet, fortement inspiré du sonnet anti-pétrarquiste « Alla sua donna « du poète italien Berni, énumère successivement les parties du corps d’une femme.
«
Le deuxième quatrain poursuit la description du visage : de la bouche, on en arrive aux « dents » qui sont comparées à de l’ébène.
Antithèsedonc : de belles dents ne sont pas noires mais blanches comme de l’ivoire ! Cela accentue l’impureté de la femme qui a les dents cariées voirepourries.
De facto, le vers du second hémistiche qui se poursuit au vers suivant peut être vu comme une antiphrase qui met en évidence l’ironiede cette description par l’hyperbole « Ô précieux trésors, / qui faites d’un seul ris toute âme enamourée ».
On voit mal comment des dents noires peuvent être perçues comme de « précieux trésors », de même qu’elle ne peuvent pas susciter l’amourd’autrui.
Au contraire, avec de telles dents, un seul sourire se manifeste et tout est dépeuplé ! Ce qui est sous-entendu c’est que sa laideur fait fuirceux qu’elle tente de séduire.
Au fond, il lui attribue sous le ton ironique des richesses qu’elle ne possède pas.
Le troisième vers du second quatrain peut se comprendre de la façon suivante : si la gorge est damasquiné c’est parce que la peau est plissée(« en cent plis figurée ») et non lisse et ferme comme la décrirait un sonnet pétrarquiste à propos de la jeune aimée.
Pour ce qui est des « grands tétins », on ne voit pas de prime abord ce que Du Bellay pourrait leur reprocher- bien au contraire.
Pourtant, lesecond hémistiche repose sur une ironie flagrante et humoristique : « dignes d’un si beau corps » : au vu de la description faite jusqu’à présent ducorps de la vieille courtisane, si sa poitrine est digne de ce corps, c’est qu’elle n’est pas si appréciable que cela.
De même, l’adverbe d’intensité« si » vient exagérer et dévoiler l’ironie omniprésente dans ce vers.
Par la suite, c’est le bas du corps qui est apostrophé, et étrangement les ongles avant les mains qui sont dit « dorés ».
Comme pour la peau, les« ongles dorés » est la formulation poétique pour dire des «ongles jaunes », sous-entendu ici de saleté.
La main est, quant-à-elle, « courte etgrassette » tout comme la jambe qui est dîtes « grossette ».
Il y a donc, en quelque sorte, une paronomase qui, profitant de la rime peu élaborée de« grassette » avec « grossette », insiste sur la difformité de la silhouette de la femme décrite.
De même, « cuisse délicate » et « jambe grossette »forme une antithèse de par leur épithète.
Une femme élégante présente de petite main menue et des jambes élancées, ici on est loin de la femmeidéalisé par Pétrarque.
« Ce que je ne puis honnêtement nommer » fait référence au triangle érotique de la femme qui est possiblement tût par le poète par souci de tenirdes propos bienséants, mais aussi parce que le sexe de la courtisane serait le comble de sa laideur, aussi sale que ses ongles et porteur demaladie.
Ce premier tercet achève le portrait ironique fait par Du Bellay en décrivant le parfait contraire de la beauté pétrarquiste idéalisée et magnifiée.
Le dernier tercet marque le retour sur le corps dans son ensemble et permet au « je » lyrique d’exprimer ses sentiments vis-à-vis de ce corps aumoyen de la chute.
« Beau corps transparent » semble paradoxal dans le sens où il parait difficile de juger de la beauté d’une chose invisible.
Mais cela peutégalement avoir trait à la mort : le corps de la femme devenant spectral.
Cette idée peut être confortée si l’on tient compte du second hémistiche :« beaux membres de glace ! ».
Vu que la femme décrite paraît être âgée, elle est donc proche de la mort et de son haleine glaciale.
« Ô divines beautés » reprend le ton ironique du poème, d’autant qu’arrivé à ce stade de la lecture, on a bien compris qu’elle n’a rien d’unedéesse.
Le « je » lyrique semble dire, dans le second hémistiche de l’avant dernier vers qui trouve sa fin lors de la chute finale, qu’il est, à l’image de Ruy Blas , un « ver de terre amoureux d’une étoile » : l’opposition perceptible entre « divines » et « mortel » semblerait appuyer cette interprétation. Au fond, il lui fait l’aveu de son non amour, ce qui contraste avec l’image de l’amant qui est prêt à souffrir et à mourir pour la femme aimée dans lespoèmes pétrarquistes (ce que Du Bellay dénonce dans Contre les pétrarquistes).
En caricaturant, le poète dit qu’il n’est pas prêt à mourir pourcette femme qui, loin d’être divine ou belle, ne peut lui inspirer de l’amour.
Aimer – Nommer // « Ce que je ne puis honnêtement aimer » - « Si, pour être mortel, je ne vous ose nommer ».
L’effet est plutôt humoristique.
[Conclusion] Inversant tour à tour les clichés pétrarquistes des parties du corps féminin, Du Bellay parvient à créer une poésie d’une inspiration nouvelle, éloignées de « l’art de pétrarquiser », qui tend à faire la satire d’une courtisane sous la forme d’un éloge paradoxal : celui de la laideur.Cette poétique de l’immonde permet à l’auteur de faire la satire de la poétique hérité de Pétrarque qui, durant la Renaissance, inspire de nombreuxrecueils au point que, d’imitation en imitation, elle perd peu à peu son originalité et tombe dans la désuétude du cliché..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication de texte: “Système des beaux-arts” , Alain
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- Explication Regrets, Sonnet 53
- Explication de texte : « Qu’est-ce que le Moi » Pascal
- Explication de texte autour d'un extrait de l'ouvrage Le poète et l'activité de la fantaisie, de Sigmund Freud