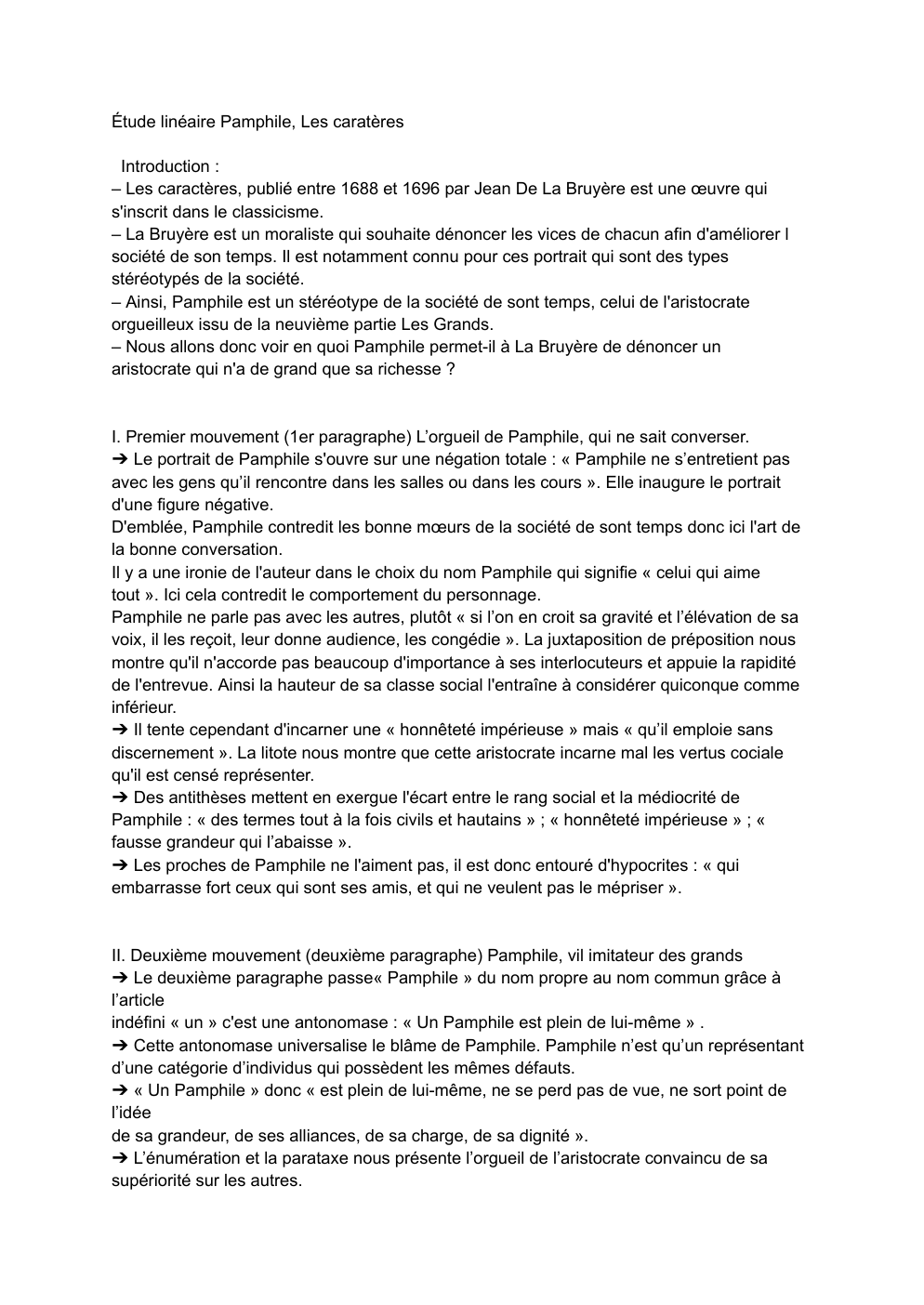Étude linéaire Pamphile in Les caractères
Publié le 23/05/2023
Extrait du document
«
Étude linéaire Pamphile,
Introduction :
– Les caractères, publié entre 1688 et 1696 par Jean De La Bruyère est une œuvre qui
s'inscrit dans le classicisme.
– La Bruyère est un moraliste qui souhaite dénoncer les vices de chacun afin d'améliorer l
société de son temps.
Il est notamment connu pour ces portrait qui sont des types
stéréotypés de la société.
– Ainsi, Pamphile est un stéréotype de la société de sont temps, celui de l'aristocrate
orgueilleux issu de la neuvième partie Les Grands.
– Nous allons donc voir en quoi Pamphile permet-il à La Bruyère de dénoncer un
aristocrate qui n'a de grand que sa richesse ?
I.
Premier mouvement (1er paragraphe) L’orgueil de Pamphile, qui ne sait converser.
➔ Le portrait de Pamphile s'ouvre sur une négation totale : « Pamphile ne s’entretient pas
avec les gens qu’il rencontre dans les salles ou dans les cours ».
Elle inaugure le portrait
d'une figure négative.
D'emblée, Pamphile contredit les bonne mœurs de la société de sont temps donc ici l'art de
la bonne conversation.
Il y a une ironie de l'auteur dans le choix du nom Pamphile qui signifie « celui qui aime
tout ».
Ici cela contredit le comportement du personnage.
Pamphile ne parle pas avec les autres, plutôt « si l’on en croit sa gravité et l’élévation de sa
voix, il les reçoit, leur donne audience, les congédie ».
La juxtaposition de préposition nous
montre qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance à ses interlocuteurs et appuie la rapidité
de l'entrevue.
Ainsi la hauteur de sa classe social l'entraîne à considérer quiconque comme
inférieur.
➔ Il tente cependant d'incarner une « honnêteté impérieuse » mais « qu’il emploie sans
discernement ».
La litote nous montre que cette aristocrate incarne mal les vertus cociale
qu'il est censé représenter.
➔ Des antithèses mettent en exergue l'écart entre le rang social et la médiocrité de
Pamphile : « des termes tout à la fois civils et hautains » ; « honnêteté impérieuse » ; «
fausse grandeur qui l’abaisse ».
➔ Les proches de Pamphile ne l'aiment pas, il est donc entouré d'hypocrites : « qui
embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser ».
II.
Deuxième mouvement (deuxième paragraphe) Pamphile, vil imitateur des grands
➔ Le deuxième paragraphe passe« Pamphile » du nom propre au nom commun grâce à
l’article
indéfini « un » c'est une antonomase : « Un Pamphile est plein de lui-même » .
➔ Cette antonomase universalise le blâme de Pamphile.
Pamphile n’est qu’un représentant
d’une catégorie d’individus qui possèdent les mêmes défauts.
➔ « Un Pamphile » donc « est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne sort point de
l’idée
de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité ».
➔ L’énumération et la parataxe nous présente l’orgueil de l’aristocrate convaincu de sa
supériorité sur les autres.
➔ Afin de mieux convaincre de la hauteur de son rang, Pamphile porte « toutes ses pièces
».
Cette hyperbole désigne les médailles et emblèmes qui prouvent son appartenance à la
haute
aristocratie.
➔ Pamphile déclare ainsi «Mon ordre, mon cordon bleu».
(Le cordon bleu était la marque
des
chevaliers du Saint-Esprit, ordre le plus prestigieux de l’Ancien Régime).
Ce court passage
au discours direct donne plus de vie au portrait.
➔ La répétition du déterminant possessif « mon » associe ces insignes à des objets vidés
de leur sens.
➔ De plus, ce cordon bleu, Pamphile « le cache par ostentation » : l’antithèse satirique
montre l’hypocrisie du personnage véritablement orgueilleux.
➔ Pamphile n’a donc de l’aristocrate que les emblèmes, mais pas le caractère.
➔ Au terme de cette période oratoire (=longue phrase), la Bruyère nous fait un bilan sévère
avec la locution prépositionnelle « en un mot » : Pamphile « veut être grand, il croit l’être ;
il ne l’est pas, il est d’après un grand.
» Sorte de moquerie de l'auteur.
➔ Ce chiasme (structure ABBA) nous montre l'écart qui se dresse entre les valeurs de
l’aristocratie et le caractère de Pamphile (« veut être », « croit être » ) et la réalité (« ne l’est
pas », « est d’après un grand.
» ).
Encore une fois Pamphile n’a de l’aristocratie que les
richesse et les privilèges, et pas la vertu morale.
➔ Ce chiasme dénonce une aristocratie qui a perdu sa....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- analyse linéaire Les caractères Giton et Phédon
- LES caractères lecture linéaire 2: Giton et Phédon
- étude linéaire poème 4 livre 4 les contemplations: Pauca Mea
- analyse linéaire Les Caractères V, 9 (portrait d'Arrias)
- La Bruyère, les Caractères (étude littéraire)