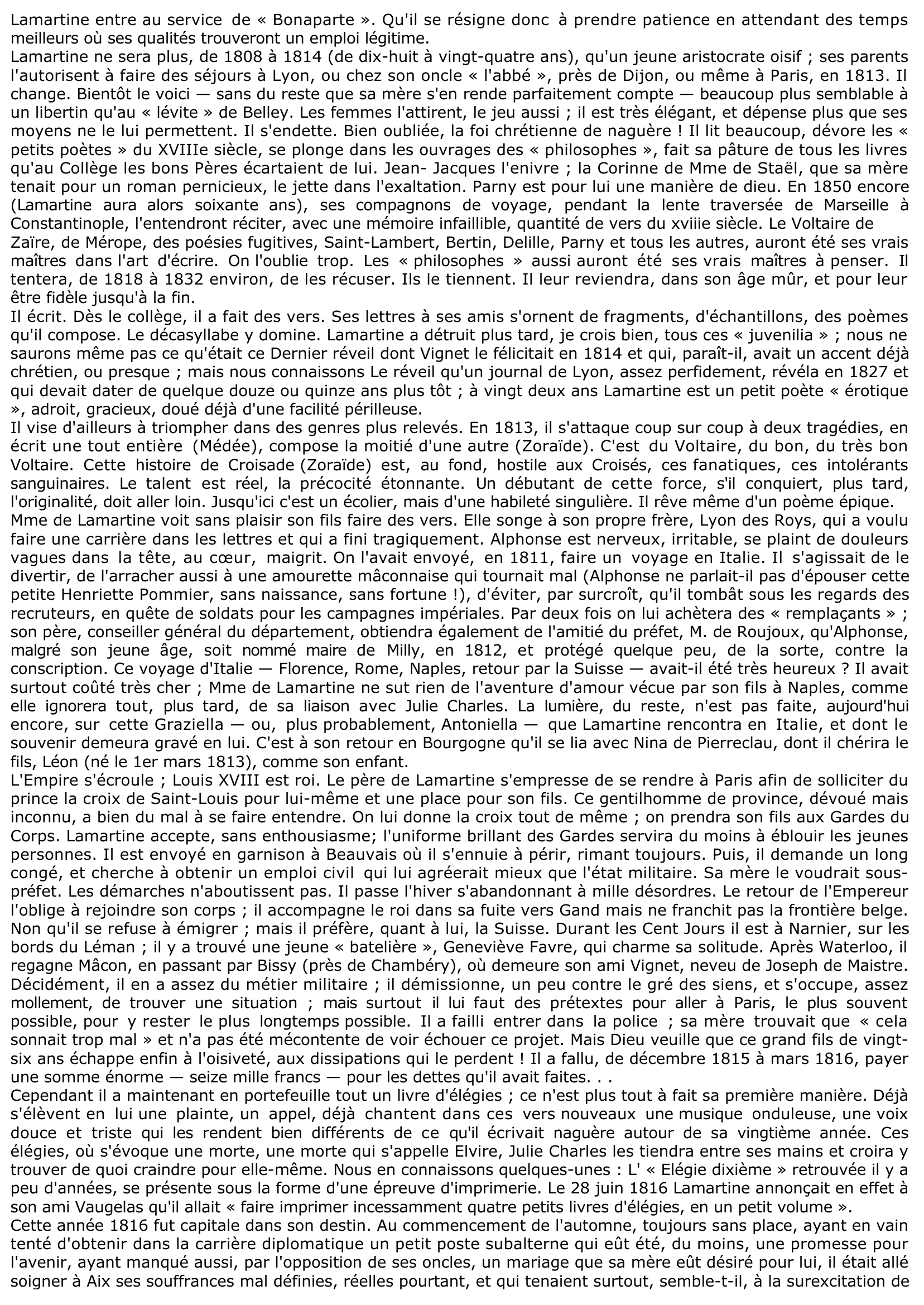ENFANCE ET JEUNESSE DE LAMARTINE
Publié le 30/06/2011
Extrait du document
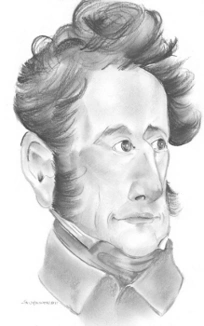
Lamartine, par sa naissance, appartient au xviiie siècle ; il lui appartiendra autrement encore, par plus d'un aspect de sa pensée, ainsi que nous le verrons. Il naît en 1790 (le 21 octobre) à Mâcon ; Milly, en dépit des vers célèbres publiés dans Les Harmonies, n'est pas la « terre natale « du poète ; ce n'est qu'un village très aimé, une chère maison où Lamartine a beaucoup vécu, où il a passé une partie de son enfance. Saisissons, au seuil même de cette étude, l'occasion qui nous est ainsi offerte d'indiquer combien il est nécessaire de n'accueillir qu'avec réserve et de contrôler toutes les fois qu'on le peut les renseignements fournis, sur son œuvre ou sa vie, par le poète lui-même, dans ses « Commentaires «, dans ses Confidences, dans ses Entretiens du Cours Familier, et jusque dans ses Mémoires posthumes, la moins inexacte, pourtant, de ses « confessions « multipliées. Les parents de Lamartine sont des nobles ; petite noblesse de province, très attachée à la monarchie, très pieuse. Son père avait été officier ; il avait quitté l'armée, mais, très courageusement, deux ans après la naissance d'Alphonse, il reprendra l'épée pour aller défendre Louis XVI, au 10 août. Sa mère, née Des Roys, était la fille d'un homme de robe, ancien intendant des Domaines du duc d'Orléans ; la grand'mère maternelle de Lamartine avait un moment veillé sur l'éducation de celui qui sera Louis-Philippe.
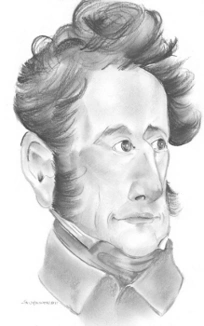
«
Lamartine entre au service de « Bonaparte ».
Qu'il se résigne donc à prendre patience en attendant des tempsmeilleurs où ses qualités trouveront un emploi légitime.Lamartine ne sera plus, de 1808 à 1814 (de dix-huit à vingt-quatre ans), qu'un jeune aristocrate oisif ; ses parentsl'autorisent à faire des séjours à Lyon, ou chez son oncle « l'abbé », près de Dijon, ou même à Paris, en 1813.
Ilchange.
Bientôt le voici — sans du reste que sa mère s'en rende parfaitement compte — beaucoup plus semblable àun libertin qu'au « lévite » de Belley.
Les femmes l'attirent, le jeu aussi ; il est très élégant, et dépense plus que sesmoyens ne le lui permettent.
Il s'endette.
Bien oubliée, la foi chrétienne de naguère ! Il lit beaucoup, dévore les «petits poètes » du XVIIIe siècle, se plonge dans les ouvrages des « philosophes », fait sa pâture de tous les livresqu'au Collège les bons Pères écartaient de lui.
Jean- Jacques l'enivre ; la Corinne de Mme de Staël, que sa mèretenait pour un roman pernicieux, le jette dans l'exaltation.
Parny est pour lui une manière de dieu.
En 1850 encore(Lamartine aura alors soixante ans), ses compagnons de voyage, pendant la lente traversée de Marseille àConstantinople, l'entendront réciter, avec une mémoire infaillible, quantité de vers du xviiie siècle.
Le Voltaire deZaïre, de Mérope, des poésies fugitives, Saint-Lambert, Bertin, Delille, Parny et tous les autres, auront été ses vraismaîtres dans l'art d'écrire.
On l'oublie trop.
Les « philosophes » aussi auront été ses vrais maîtres à penser.
Iltentera, de 1818 à 1832 environ, de les récuser.
Ils le tiennent.
Il leur reviendra, dans son âge mûr, et pour leurêtre fidèle jusqu'à la fin.Il écrit.
Dès le collège, il a fait des vers.
Ses lettres à ses amis s'ornent de fragments, d'échantillons, des poèmesqu'il compose.
Le décasyllabe y domine.
Lamartine a détruit plus tard, je crois bien, tous ces « juvenilia » ; nous nesaurons même pas ce qu'était ce Dernier réveil dont Vignet le félicitait en 1814 et qui, paraît-il, avait un accent déjàchrétien, ou presque ; mais nous connaissons Le réveil qu'un journal de Lyon, assez perfidement, révéla en 1827 etqui devait dater de quelque douze ou quinze ans plus tôt ; à vingt deux ans Lamartine est un petit poète « érotique», adroit, gracieux, doué déjà d'une facilité périlleuse.Il vise d'ailleurs à triompher dans des genres plus relevés.
En 1813, il s'attaque coup sur coup à deux tragédies, enécrit une tout entière (Médée), compose la moitié d'une autre (Zoraïde).
C'est du Voltaire, du bon, du très bonVoltaire.
Cette histoire de Croisade (Zoraïde) est, au fond, hostile aux Croisés, ces fanatiques, ces intolérantssanguinaires.
Le talent est réel, la précocité étonnante.
Un débutant de cette force, s'il conquiert, plus tard,l'originalité, doit aller loin.
Jusqu'ici c'est un écolier, mais d'une habileté singulière.
Il rêve même d'un poème épique.Mme de Lamartine voit sans plaisir son fils faire des vers.
Elle songe à son propre frère, Lyon des Roys, qui a voulufaire une carrière dans les lettres et qui a fini tragiquement.
Alphonse est nerveux, irritable, se plaint de douleursvagues dans la tête, au cœur, maigrit.
On l'avait envoyé, en 1811, faire un voyage en Italie.
Il s'agissait de ledivertir, de l'arracher aussi à une amourette mâconnaise qui tournait mal (Alphonse ne parlait-il pas d'épouser cettepetite Henriette Pommier, sans naissance, sans fortune !), d'éviter, par surcroît, qu'il tombât sous les regards desrecruteurs, en quête de soldats pour les campagnes impériales.
Par deux fois on lui achètera des « remplaçants » ;son père, conseiller général du département, obtiendra également de l'amitié du préfet, M.
de Roujoux, qu'Alphonse,malgré son jeune âge, soit nommé maire de Milly, en 1812, et protégé quelque peu, de la sorte, contre laconscription.
Ce voyage d'Italie — Florence, Rome, Naples, retour par la Suisse — avait-il été très heureux ? Il avaitsurtout coûté très cher ; Mme de Lamartine ne sut rien de l'aventure d'amour vécue par son fils à Naples, commeelle ignorera tout, plus tard, de sa liaison avec Julie Charles.
La lumière, du reste, n'est pas faite, aujourd'huiencore, sur cette Graziella — ou, plus probablement, Antoniella — que Lamartine rencontra en Italie, et dont lesouvenir demeura gravé en lui.
C'est à son retour en Bourgogne qu'il se lia avec Nina de Pierreclau, dont il chérira lefils, Léon (né le 1er mars 1813), comme son enfant.L'Empire s'écroule ; Louis XVIII est roi.
Le père de Lamartine s'empresse de se rendre à Paris afin de solliciter duprince la croix de Saint-Louis pour lui-même et une place pour son fils.
Ce gentilhomme de province, dévoué maisinconnu, a bien du mal à se faire entendre.
On lui donne la croix tout de même ; on prendra son fils aux Gardes duCorps.
Lamartine accepte, sans enthousiasme; l'uniforme brillant des Gardes servira du moins à éblouir les jeunespersonnes.
Il est envoyé en garnison à Beauvais où il s'ennuie à périr, rimant toujours.
Puis, il demande un longcongé, et cherche à obtenir un emploi civil qui lui agréerait mieux que l'état militaire.
Sa mère le voudrait sous-préfet.
Les démarches n'aboutissent pas.
Il passe l'hiver s'abandonnant à mille désordres.
Le retour de l'Empereurl'oblige à rejoindre son corps ; il accompagne le roi dans sa fuite vers Gand mais ne franchit pas la frontière belge.Non qu'il se refuse à émigrer ; mais il préfère, quant à lui, la Suisse.
Durant les Cent Jours il est à Narnier, sur lesbords du Léman ; il y a trouvé une jeune « batelière », Geneviève Favre, qui charme sa solitude.
Après Waterloo, ilregagne Mâcon, en passant par Bissy (près de Chambéry), où demeure son ami Vignet, neveu de Joseph de Maistre.Décidément, il en a assez du métier militaire ; il démissionne, un peu contre le gré des siens, et s'occupe, assezmollement, de trouver une situation ; mais surtout il lui faut des prétextes pour aller à Paris, le plus souventpossible, pour y rester le plus longtemps possible.
Il a failli entrer dans la police ; sa mère trouvait que « celasonnait trop mal » et n'a pas été mécontente de voir échouer ce projet.
Mais Dieu veuille que ce grand fils de vingt-six ans échappe enfin à l'oisiveté, aux dissipations qui le perdent ! Il a fallu, de décembre 1815 à mars 1816, payerune somme énorme — seize mille francs — pour les dettes qu'il avait faites.
.
.Cependant il a maintenant en portefeuille tout un livre d'élégies ; ce n'est plus tout à fait sa première manière.
Déjàs'élèvent en lui une plainte, un appel, déjà chantent dans ces vers nouveaux une musique onduleuse, une voixdouce et triste qui les rendent bien différents de ce qu'il écrivait naguère autour de sa vingtième année.
Cesélégies, où s'évoque une morte, une morte qui s'appelle Elvire, Julie Charles les tiendra entre ses mains et croira ytrouver de quoi craindre pour elle-même.
Nous en connaissons quelques-unes : L' « Elégie dixième » retrouvée il y apeu d'années, se présente sous la forme d'une épreuve d'imprimerie.
Le 28 juin 1816 Lamartine annonçait en effet àson ami Vaugelas qu'il allait « faire imprimer incessamment quatre petits livres d'élégies, en un petit volume ».Cette année 1816 fut capitale dans son destin.
Au commencement de l'automne, toujours sans place, ayant en vaintenté d'obtenir dans la carrière diplomatique un petit poste subalterne qui eût été, du moins, une promesse pourl'avenir, ayant manqué aussi, par l'opposition de ses oncles, un mariage que sa mère eût désiré pour lui, il était allésoigner à Aix ses souffrances mal définies, réelles pourtant, et qui tenaient surtout, semble-t-il, à la surexcitation de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SOUVENIRS D'ENFANCE ET DE JEUNESSE. Essai d'Ernest Renan (résumé & analyse)
- Souvenirs d'enfance et de jeunesse d'Ernest Renan
- SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE JEUNESSE de Ernest Renan : Fiche de lecture
- SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE JEUNESSE d’Ernest Renan (Résumé et analyse)
- Juan José San Martín 1778-1850 Juan José San Martín passe son enfance et sa jeunesse en Espagne, à se préparer à la carrière militaire.