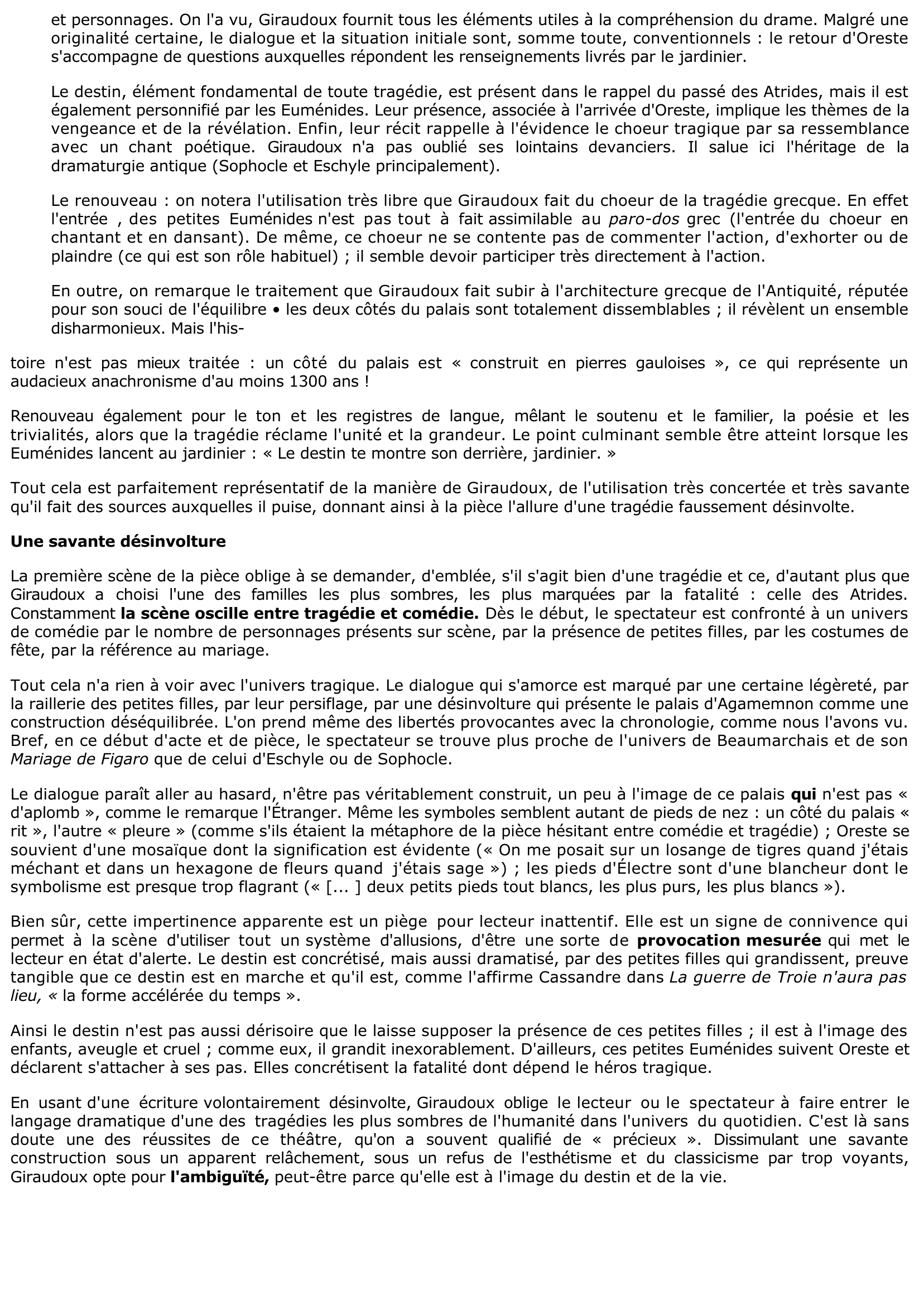Electre de Giraudoux: ACTE I, SCÈNE 1 (commentaire)
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
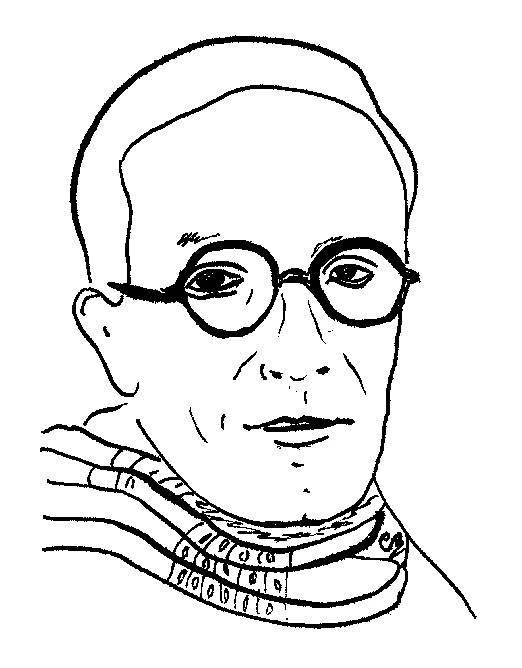
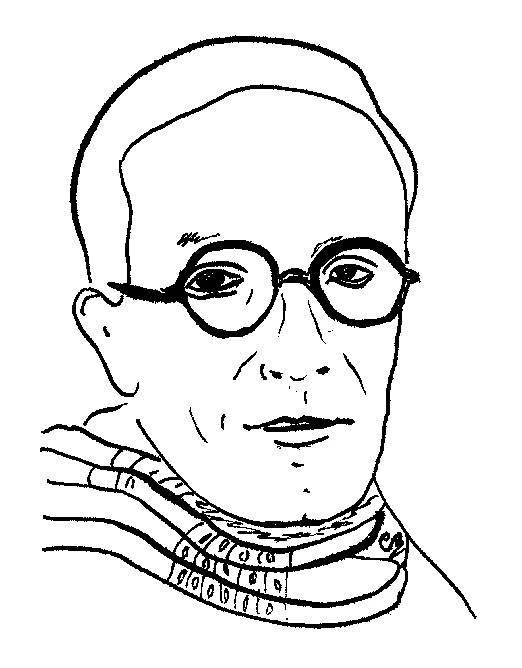
«
et personnages.
On l'a vu, Giraudoux fournit tous les éléments utiles à la compréhension du drame.
Malgré uneoriginalité certaine, le dialogue et la situation initiale sont, somme toute, conventionnels : le retour d'Orestes'accompagne de questions auxquelles répondent les renseignements livrés par le jardinier.
Le destin, élément fondamental de toute tragédie, est présent dans le rappel du passé des Atrides, mais il estégalement personnifié par les Euménides.
Leur présence, associée à l'arrivée d'Oreste, implique les thèmes de lavengeance et de la révélation.
Enfin, leur récit rappelle à l'évidence le choeur tragique par sa ressemblanceavec un chant poétique.
Giraudoux n'a pas oublié ses lointains devanciers.
Il salue ici l'héritage de ladramaturgie antique (Sophocle et Eschyle principalement).
Le renouveau : on notera l'utilisation très libre que Giraudoux fait du choeur de la tragédie grecque.
En effetl'entrée , des petites Euménides n'est pas tout à fait assimilable au paro-dos grec (l'entrée du choeur en chantant et en dansant).
De même, ce choeur ne se contente pas de commenter l'action, d'exhorter ou deplaindre (ce qui est son rôle habituel) ; il semble devoir participer très directement à l'action.
En outre, on remarque le traitement que Giraudoux fait subir à l'architecture grecque de l'Antiquité, réputéepour son souci de l'équilibre • les deux côtés du palais sont totalement dissemblables ; il révèlent un ensembledisharmonieux.
Mais l'his-
toire n'est pas mieux traitée : un côté du palais est « construit en pierres gauloises », ce qui représente unaudacieux anachronisme d'au moins 1300 ans !
Renouveau également pour le ton et les registres de langue, mêlant le soutenu et le familier, la poésie et lestrivialités, alors que la tragédie réclame l'unité et la grandeur.
Le point culminant semble être atteint lorsque lesEuménides lancent au jardinier : « Le destin te montre son derrière, jardinier.
»
Tout cela est parfaitement représentatif de la manière de Giraudoux, de l'utilisation très concertée et très savantequ'il fait des sources auxquelles il puise, donnant ainsi à la pièce l'allure d'une tragédie faussement désinvolte.
Une savante désinvolture
La première scène de la pièce oblige à se demander, d'emblée, s'il s'agit bien d'une tragédie et ce, d'autant plus queGiraudoux a choisi l'une des familles les plus sombres, les plus marquées par la fatalité : celle des Atrides.Constamment la scène oscille entre tragédie et comédie.
Dès le début, le spectateur est confronté à un univers de comédie par le nombre de personnages présents sur scène, par la présence de petites filles, par les costumes defête, par la référence au mariage.
Tout cela n'a rien à voir avec l'univers tragique.
Le dialogue qui s'amorce est marqué par une certaine légèreté, parla raillerie des petites filles, par leur persiflage, par une désinvolture qui présente le palais d'Agamemnon comme uneconstruction déséquilibrée.
L'on prend même des libertés provocantes avec la chronologie, comme nous l'avons vu.Bref, en ce début d'acte et de pièce, le spectateur se trouve plus proche de l'univers de Beaumarchais et de sonMariage de Figaro que de celui d'Eschyle ou de Sophocle.
Le dialogue paraît aller au hasard, n'être pas véritablement construit, un peu à l'image de ce palais qui n'est pas « d'aplomb », comme le remarque l'Étranger.
Même les symboles semblent autant de pieds de nez : un côté du palais «rit », l'autre « pleure » (comme s'ils étaient la métaphore de la pièce hésitant entre comédie et tragédie) ; Oreste sesouvient d'une mosaïque dont la signification est évidente (« On me posait sur un losange de tigres quand j'étaisméchant et dans un hexagone de fleurs quand j'étais sage ») ; les pieds d'Électre sont d'une blancheur dont lesymbolisme est presque trop flagrant (« [...
] deux petits pieds tout blancs, les plus purs, les plus blancs »).
Bien sûr, cette impertinence apparente est un piège pour lecteur inattentif.
Elle est un signe de connivence quipermet à la scène d'utiliser tout un système d'allusions, d'être une sorte de provocation mesurée qui met le lecteur en état d'alerte.
Le destin est concrétisé, mais aussi dramatisé, par des petites filles qui grandissent, preuvetangible que ce destin est en marche et qu'il est, comme l'affirme Cassandre dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, « la forme accélérée du temps ».
Ainsi le destin n'est pas aussi dérisoire que le laisse supposer la présence de ces petites filles ; il est à l'image desenfants, aveugle et cruel ; comme eux, il grandit inexorablement.
D'ailleurs, ces petites Euménides suivent Oreste etdéclarent s'attacher à ses pas.
Elles concrétisent la fatalité dont dépend le héros tragique.
En usant d'une écriture volontairement désinvolte, Giraudoux oblige le lecteur ou le spectateur à faire entrer lelangage dramatique d'une des tragédies les plus sombres de l'humanité dans l'univers du quotidien.
C'est là sansdoute une des réussites de ce théâtre, qu'on a souvent qualifié de « précieux ».
Dissimulant une savanteconstruction sous un apparent relâchement, sous un refus de l'esthétisme et du classicisme par trop voyants,Giraudoux opte pour l'ambiguïté, peut-être parce qu'elle est à l'image du destin et de la vie..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire sur Jean Giraudoux, Electre, Acte II, Scène 9
- Electre Jean Giraudoux - Commentaire de l'acte II scène 9
- Commentaire - Jean Giraudoux, Electre, Acte II, Scène 9
- Acte I, scène 6, pp. 51-52 : la reconnaissance d'Oreste dans Electre de Giraudoux (commentaire)
- Electre de Giraudoux: ACTE I, SCÈNE 13 (commentaire)